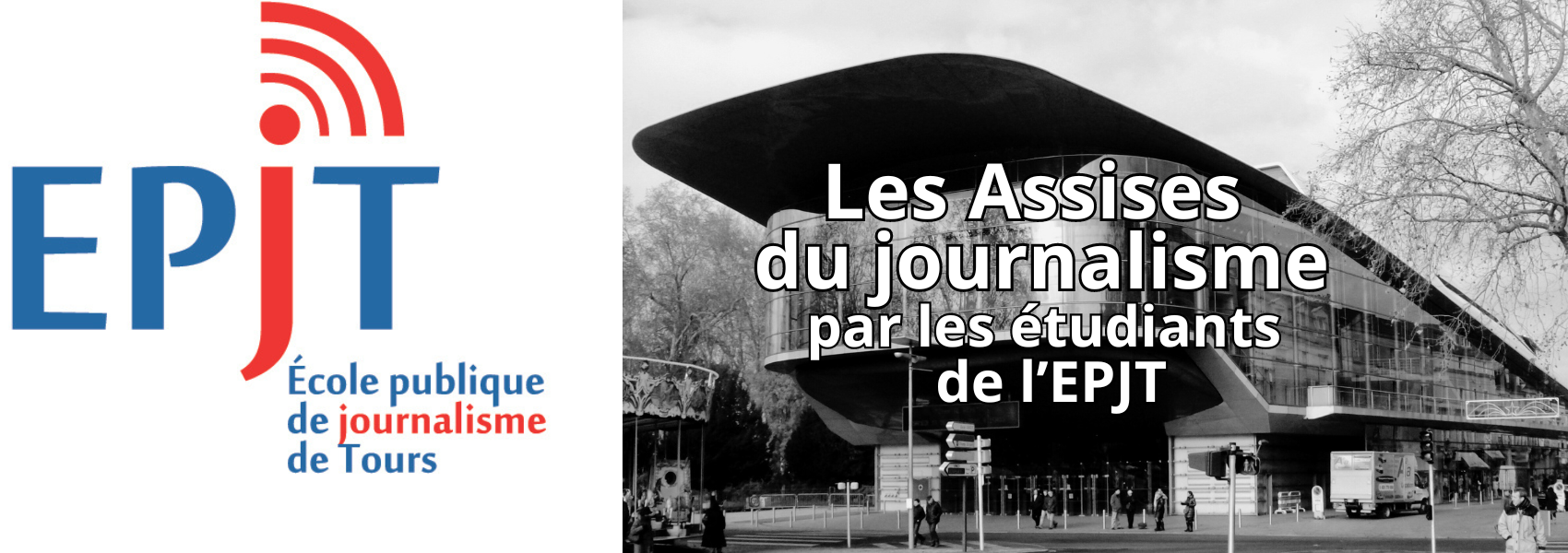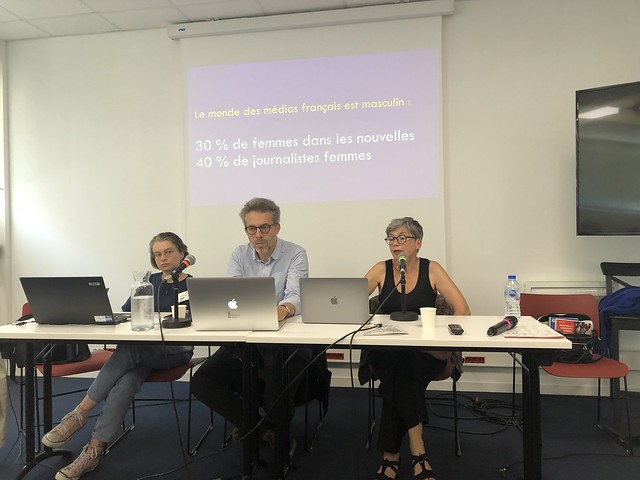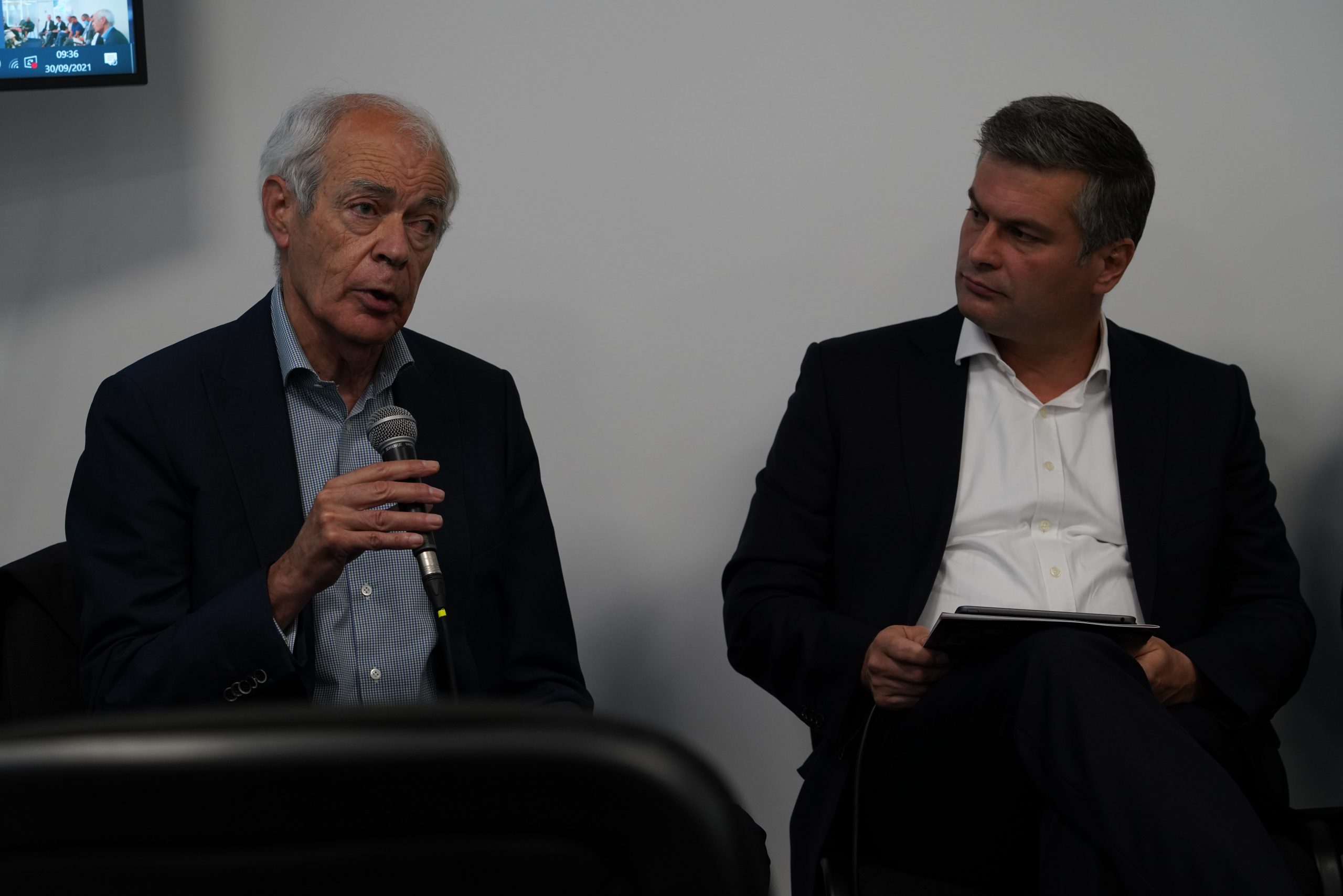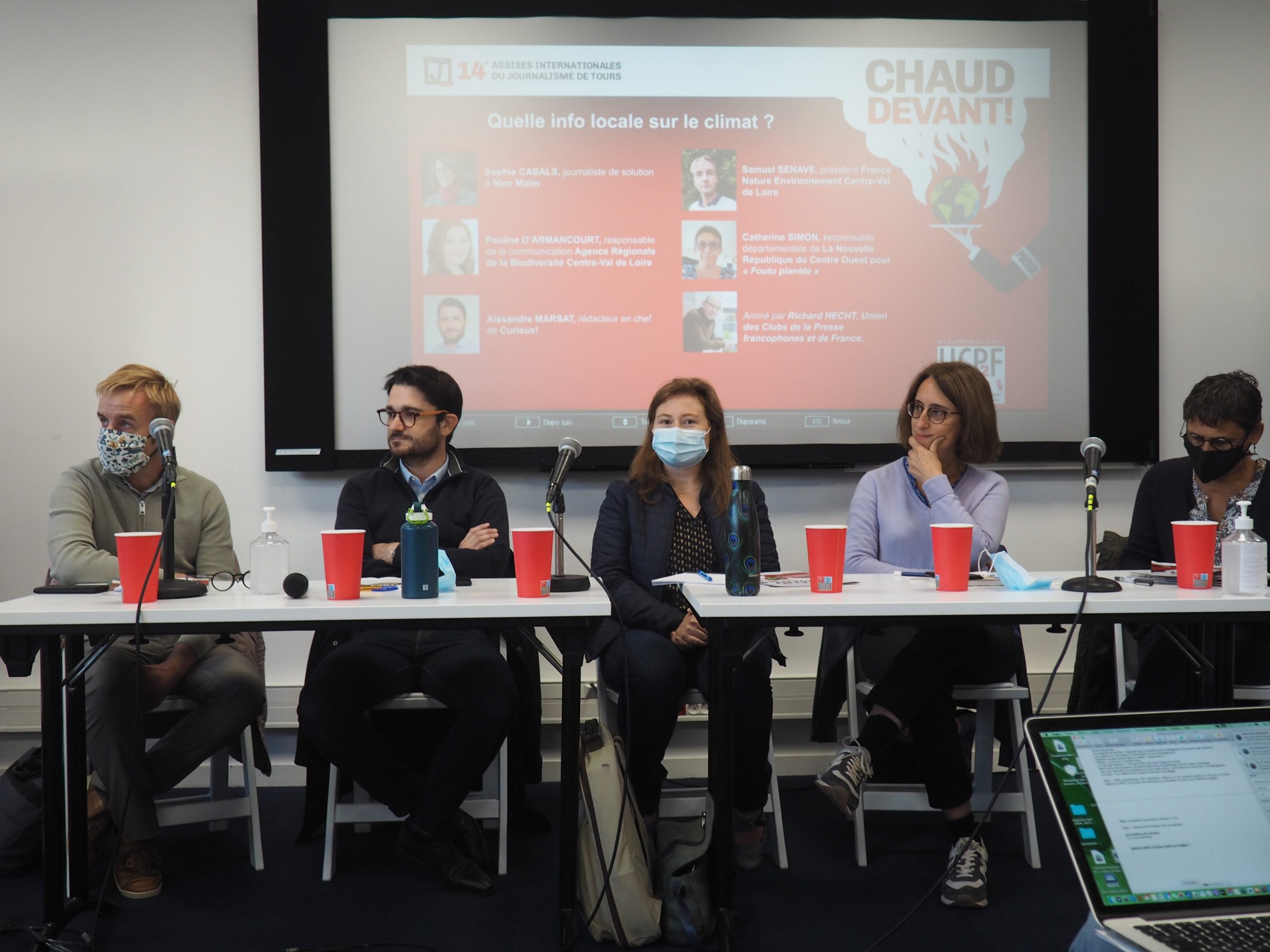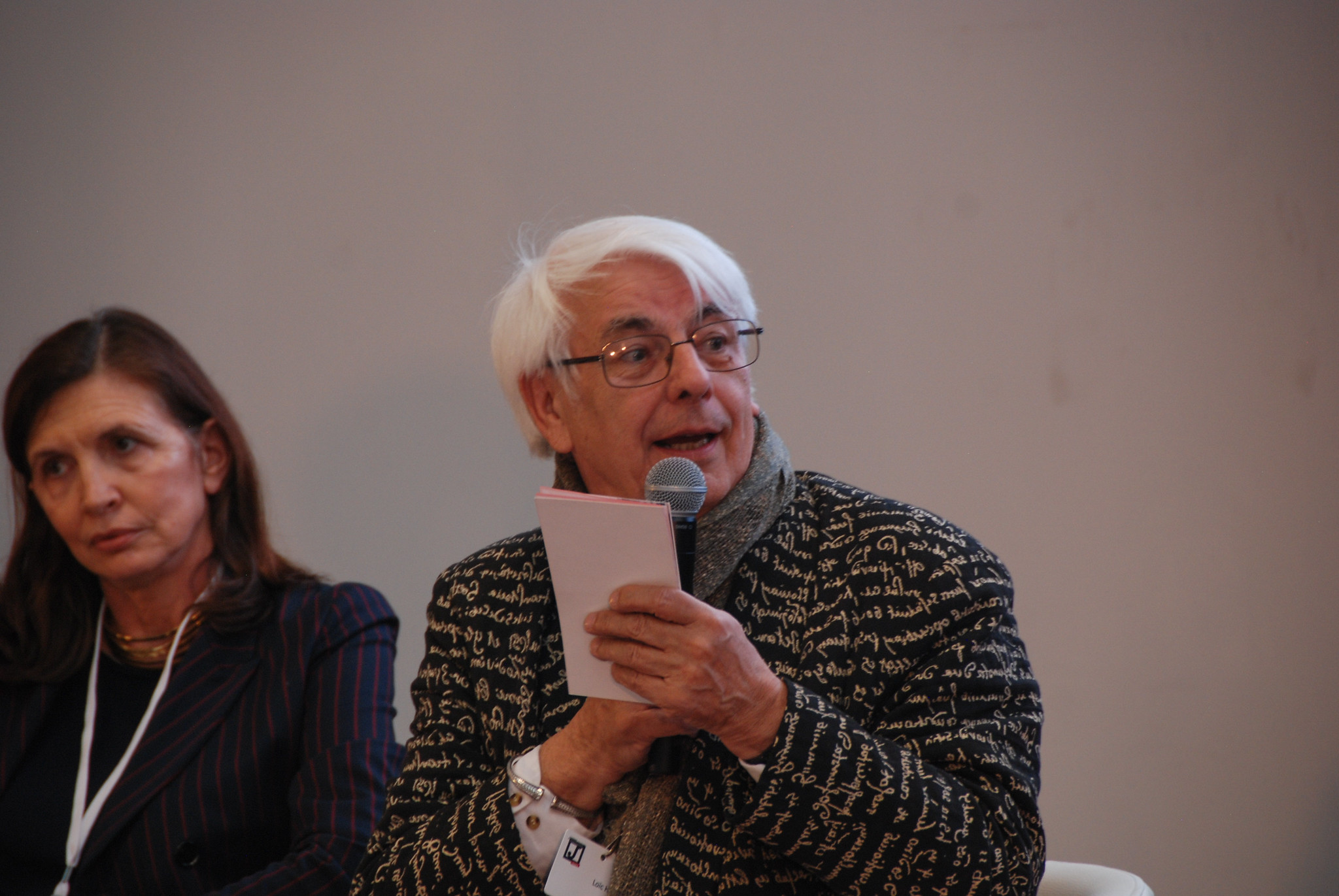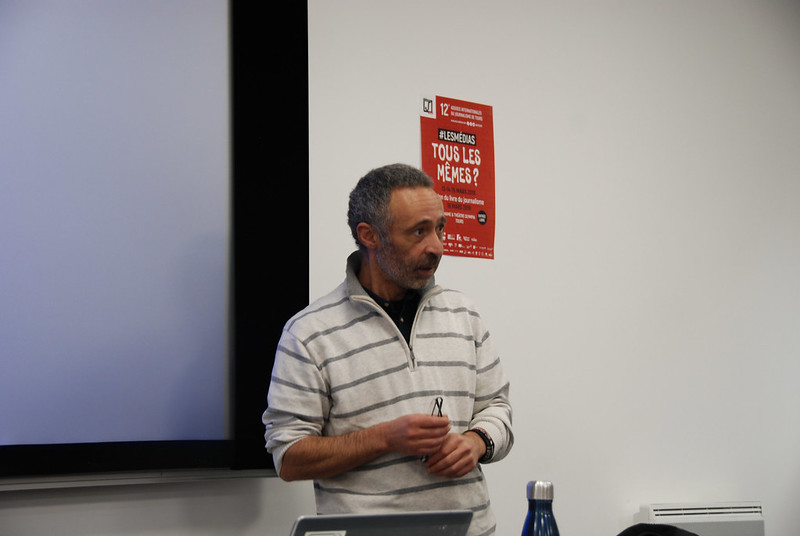12 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Afghanistan, parole aux artistes et aux journalistes en exil ».
Noorwali Khpalwak, Mortaza Behboudi, Darline Cothière, Mariam Mana et Solène Chalvon-Fioriti se sont réunis pour parler des journalistes en Afghanistan. Photo : Marion Galard / EPJT
Animée par Darline Cothière, directrice de la Maison des journalistes, avec
Mortaza Behboudi, journaliste indépendant ;
Solène Chalvon-Fioriti, grande reporter et réalisatrice ;
Noorwali Khpalwak, journaliste afghan réfugié à La Maison des journalistes et
Mariam Mana, correspondante pour Volant Media (Afghanistan International).
Les enjeux
Le 15 août 2021, les Talibans prennent la capitale de l’Afghanistan, Kaboul. De nombreux journalistes et artistes sont sous le choc. Ils subissent alors une répression grandissante et beaucoup cherchent à fuir. Certains d’entre eux arrivent en France. Des mois plus tard, le soir du mercredi 11 mai 2022, des artistes réfugiés afghans présentent pour la première fois sur scène leur spectacle « Kaboul, le 15 août 2021 » au théâtre Olympia de Tours. Mêlant danse, chant, théâtre et poésie, ce spectacle raconte la vie et la fuite des Afghans à partir du 15 août. Après le spectacle, une conférence a eu lieu avec des journalistes afghans sur la situation du journalisme dans leur pays d’origine.
Ce qu’ils ont dit
Noorwali Khpalwak, arrivé en France récemment, il s’exprime en anglais : « J’ai vu la nouvelle de la prise de Kaboul sur mon téléphone le 15 août 2021 quand je me suis réveillé. Je n’ai pas cru ces informations au départ. Je voulais aller voir mes collègues au bureau alors j’y suis allé. Ils étaient terrifiés. On n’aurait pas pu imaginer que vingt ans de progrès allait disparaitre en une minute. »
« Je suis parti de chez moi le lendemain matin avec un habit similaire à ceux des talibans pour passer inaperçu. Jusqu’au 24 août, j’étais caché dans un lieu secret. Je n’ai pas pu dire au revoir à ma femme et mes enfants, il n’y avait pas le temps de se dire au revoir. Ma famille est au Pakistan maintenant. »
Solène Chalvon-Fioriti : « Cela fait dix ans que je travaille en Afghanistan. On dit de nous, les femmes occidentales, que nous sommes le troisième genre. C’est un atout indéniable en tant que journaliste. On pouvait discuter avec des chefs de guerre car ils ne nous prennent pas au sérieux. »
« Maintenant, je peux interviewer un ministre taliban alors que les médias locaux ont du mal à obtenir les autorisations pour exister. »
« Les femmes journalistes et parlementaires étaient avant les talibans mal considérées. C’est une terreur civile de genre : les hommes sont garants de ce qui va arriver aux femmes. Il faut continuer d’accueillir ces femmes journalistes car certaines se cachent actuellement dans des caves à Kaboul et la plupart n’ont pas pu partir en août 2021. »
Mariam Mana : « Pour les journalistes qui travaillent sur l’Afghanistan, les nouvelles sont toujours effrayantes. J’ai peur quand je commence ma journée à 7 heures de regarder les informations. »
« En Afghanistan, il y a un blackout médiatique : tous les médias sont censurés ou les journalistes sont partis. Nous utilisons sur Volant Media les vidéos que les citoyens afghans nous envoient sur WhatsApp, elles représentent peut-être 40 % de nos vidéos. »
Mortaza Behboudi : « Je reçois des appels d’urgence, parfois pendant la nuit à 3 ou 4 heures du matin, pour aider à faire évacuer des journalistes afghans. »
« Je retourne régulièrement en Afghanistan, pour le journalisme surtout. C’est assez dangereux mais je vais y retourner bientôt. »
À retenir
Le journalisme en Afghanistan est en péril. La plupart des journalistes ont fui ou ne peuvent plus travailler. Des journalistes réfugiés ont été accueillis en France mais ceux restés sur place, en particulier les femmes, s’exposent à des risques. Une correspondante de l’AFP en Afghanistan présente dans la salle a d’ailleurs subi plusieurs menaces. L’évacuation des journalistes vers d’autres pays est difficile. Mortaza Behboudi, en France depuis 2015 et qui a obtenu la nationalité française, aide ses confrères à sortir d’Afghanistan. Il a reçu un appel pendant la conférence pour aider une présentatrice à venir en France, une bonne nouvelle qui a provoqué les applaudissements de la salle.
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Conférence sur l’utilité du journalisme et le baromètre Viavoice 2022 »
Stewart Chau, Nathalie Saint-Criqc, Cyril Petit, Nabil Aoudi et Eric Valmir se sont rassemblés pour parler du baromètre 2022 sur l’utilité du journalisme. Photo : Marion Galard/EPJT
Les participants à cette conférence sont Nabil Aouadi, directeur de la coordination éditoriale de France Médias Monde, Stewart Chau, directeur des études politiques et opinions de Viavoice, Nathalie Saint-Cricq, journaliste et éditorialiste du service politique à France Télévisions, Cyril Petit, journaliste, Eric Valmir, secrétaire général de l’information de Radio France.
Les enjeux
90 % des Français trouvent que le journalisme est un métier utile. C’est ce que révèle l’enquête réalisée pour les Assises par l’institut Viavoice, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du dimanche et Radio France. Cette étude dévoile chaque année les attentes des Français envers les journalistes, l’information et les médias. En 2022, elle aborde également l’avis des Français sur le traitement médiatique de la guerre en Ukraine et de la campagne présidentielle.
Ce qu’ils ont dit
Stewart Chau : « 64 % des Français estiment qu’on peut trouver des informations fiables en dehors des médias de référence. C’est un chiffre en baisse de trois points par rapport à octobre 2021. On peut imaginer que les Français comprennent de plus en plus qu’il faut payer pour accéder à une information de qualité car 38 % d’entre eux le pensent. C’est deux points de plus qu’en octobre 2021. »
« Nous pouvons interpréter les chiffres de plusieurs façons. On peut être optimiste en se disant que 47 % des Français ont confiance en la manière dont la politique est traitée par les médias ou être pessimiste car 19 % n’ont pas du tout confiance. »
« Le traitement médiatique de la guerre en Ukraine est perçu comme utile pour 82 % des Français et indispensable pour 78 % d’entre eux. Par contre, certains l’ont trouvé orienté. »
« La télévision apparaît comme le canal d’information principal des Français pour s’informer sur la campagne présidentielle. Les trois quarts d’entre eux l’ont regardée pour s’informer sur ce sujet. La radio (38 % des Français) et la presse écrite (37 %) arrivent en seconde place. »
Nabil Aouadi : « Le baromètre montre que les gens trouvent le journalisme utile pour se forger une opinion. Nous ne formons pas l’opinion mais personne ne sort vierge de la consultation d’une information. »
Cyril Petit : « La règle d’égalité du temps de parole à la télévision s’applique en fait à tous car les lecteurs nous reprochent de ne pas donner la parole à certains candidats. C’est aux journalistes d’expliquer que cette règle ne s’applique pas à la presse écrite. »
Eric Valmir : « Concernant l’Ukraine, on fait un effort considérable sur le terrain pour ne pas être pro-ukrainien. Quand on a découvert Boutcha, on n’a pas dit que c’était la Russie mais que ça l’était peut-être. Nous allons sur le terrain pour vérifier. On peut se sentir insulté par le terme « journalisme orienté » parce qu’on fournit des efforts pour rapporter des faits, surtout sur la guerre en Ukraine. »
Nathalie Saint-Cricq : « Ce qui m’insupporte le plus, c’est le fantasme des journalistes politiques qui sont perçus comme amis avec les politiques. Ce n’est pas le cas : nous ne sommes pas une petite caste de puissants. On ne fait jamais ce genre de reproches aux journalistes de sport ou culturels. On ne leur dit pas qu’ils mettent en avant leurs amis. »
À retenir
Le journalisme est perçu comme un métier utile ; 84 % des Français considèrent par exemple qu’il est indispensable dans une société démocratique. Les Français s’inquiètent aussi de la concentration des médias. Plus de 8 sur 10 considèrent que ce phénomène porte atteinte au débat démocratique. Si le traitement éditorial de la guerre en Ukraine par les journalistes est jugé utile, les résultats ne sont pas les mêmes selon le vote au premier tour de l’élection présidentielle des répondants. Le traitement fait par les journalistes de la guerre en Ukraine est jugé suffisamment neutre et objectif par 80 % des électeurs d’Emmanuel Macron au premier tour mais par seulement 41 % des électeurs d’Eric Zemmour.
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Sondages : drogue dure ou abstinence ? ».
Photo : Agathe Kupfer/EPJT
Animé par Nassira El Moaddem, journaliste indépendante, avec Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop, Françoix-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest-France, et Philippe Morand, rédacteur en chef adjoint du service politique du Groupe TF1.
Les enjeux
Lors de la campagne pour l’élection présidentielle, le quotidien Ouest-France a choisi de ne pas utiliser de sondages d’intentions de vote, indicateurs très prisés. Plus que le fondement même de cette pratique, c’est leur usage qui doit être questionné.
Ce qu’ils ont dit
Frédéric Dabi : « Nous proposons des enquêtes appelés rolling, littéralement des sondages roulants, en continu. C’est moins instantané, spectaculaire et brutal que les enquêtes d’opinion classiques. »
« L’absence des Outre-mer dans nos enquêtes d’intentions de vote pour l’élection présidentielle, faute de temps, ne doit pas masquer nos autres travaux réalisés sur ces territoires. Nous le ferons d’ailleurs dans le cadre des élections législatives. »
François-Xavier Lefranc : « Nous avons pris la décision de ne pas commander de sondages sur la présidentielle au moment où Éric Zemmour était placé en deuxième position des intentions de vote alors qu’il n’était pas encore candidat. Cela déstabilise la démocratie en invisibilisant les « petits candidats ». »
« Dans les sondages d’intentions de vote, les Guadeloupéennes et Guadeloupéens n’existent pas, ils sont considérés comme des sous-citoyens. Il en va de même pour les paysans et les personnes qui n’ont pas Internet. Notre boulot de journaliste, c’est d’aller voir ces gens et de les écouter. »
« L’utilisation des sondages par certains médias n’est pas sérieuse. On part d’un sondage réalisé auprès d’un échantillon de personnes à un moment donné et on le présente comme une réalité pour l’ensemble des Français. En tant que journalistes, nous n’avons pas le droit d’interpréter ces enquêtes comme cela. »
Philippe Morand : « Nous échangeons en permanence avec l’Ifop pour proposer des questions pertinentes aux enquêtés. Nous nous sommes engagés avec l’institut pour les élections régionales, présidentielle et législatives. Ces sondages nous coûtent plusieurs dizaines de milliers d’euros et engagent à la fois la responsabilité de l’Ifop et des rédactions de TF1 et LCI. »
« Nous ne travaillons pas qu’avec les sondages. Grâce à des formats comme « route nationale », diffusés lors de nos journaux télévisés, nous avons fait émerger des thématiques de campagne comme la ruralité ou le pouvoir d’achat. »
À retenir
Plus que l’outil sondage, c’est davantage son utilisation excessive par certaines rédactions qui a été évoquée. L’utilité et le sérieux des enquêtes réalisées sur le temps long ne sont pas remis en cause. La responsabilité de certains journalistes, qui ont tendance à mal les utiliser et les interpréter, doit être interrogée.
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Le journalisme politique en France vu par la presse étrangère »
Photo : Amandine Hivert/EPJT
Animé par
Carolin Lohrenz, cheffe de rubrique France au
Courrier International, avec
Marc Bassets, correspondant pour
El Pais,
Ana Navarro Pedro, correspondante pour
Visão et
Nadia Pantel, correspondante pour
Süddeutsche Zeitung.
Les enjeux
Quelques semaines après l’élection présidentielle française, trois journalistes espagnol, portugais et allemand reviennent sur les spécificités du journalisme politique français. Au coeur de la discussion, la proximité avec les politiques.
Ce qu’ils ont dit
Marc Bassets : « Le grand journal télevisé de 20 heures que tout le monde écoute n’existe plus. Les citoyens ont de multiples sources d’informations. Les médias traditionnels n’ont plus l’autorité qu’ils avaient auparavant. »
« A El Pais, nous autorisons la relecture mais interdisons la modification. Ce qui arrive très souvent en France, c’est d’envoyer une interview à un ministre qui la renvoie avec des modifications. Ce n’est plus une interview. »
Ana Navarro Pedro : « Il y a peut-être une plus grande profondeur dans les débat en France mais il y a aussi un manque de communication avec les français. La proximité avec les arcanes du pouvoir se traduit par une prise de distance avec les lecteurs. »
« La concentration des médias est problématique. Les lois françaises ne sont plus adaptés à cette concentration des médias et sont nuisibles à la démocratie parce qu’elles sont nuisibles à la liberté d’expression. »
« Aujourd’hui il y a de très bon journalistes politiques qui font des enquêtes, qui recoupent les informations, varient leurs sources mais on les trouve aux marges, dans des médias alternatifs. »
Nadia Pantel : « Au moment des gilets jaunes, ce qui m’a marqué c’est la difficulté pour les journalistes à parler de politique avec leurs concitoyens »
«On nous force de plus en plus à devenir auto-entrepreneur. Je trouve ça problématique. Quand j’ai commencé le journalisme il y a 10 ans, on ne savait pas quels étaient les articles les plus lus, lesquels faisaient partie du top 10 des articles du jour. »
À retenir
La proximité entre journalistes et politiques surprend la presse internationale. Selon les journalistes présents à cette table ronde, celle-ci renforce le phénomène de distanciation entre les journalistes et les publics. La concentration, qui n’est pas une spécificité française, a également été évoquée.
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Droits voisins : quelle reconnaissance du travail des auteurs et des journalistes ? ».
Photo : Clémentine Louise/EPJT
Animée par Amaury de Rochegonde, rédacteur en chef adjoint à Stratégies et chroniqueur médias à RFI, avec Pablo Aiquel, secrétaire général adjoint du SNJ-CGT, Jean-Marie Cavada, président de la société des droits voisins de la presse, Olivier Da Lage, responsable du dossier des droits d’auteurs au SNJ, Marie Hedin-Christophe, directrice générale du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) et Hervé Rony, directeur général de la Scam.
Les enjeux
Depuis le développement des médias sur internet, la question des droits voisins fait débat. Les médias reprochent à Google de toucher des revenus publicitaires par le biais de leurs contenus. L’enjeu de cette conférence est de faire le point sur les négociations autour de ces droits voisins et de se questionner sur le poids des Gafam dans la presse française.
Ce qu’ils ont dit
Jean-Marie Cavada : « Actuellement, ce que j’entends à l’intérieur des plateformes c’est : « Le temps que les patrons de presse et les journalistes se mettent d’accord, on a encore de beaux-jours devant nous. » Unissez-vous et essayez de régler vos rapports à l’intérieur de vos entreprises. N’offrez pas aux plateformes le spectacle d’une telle division. »
« La loi sur les droits voisins dit qu’il y a obligation pour les plateformes de négocier avec les médias. L’objectif est de rendre obligatoire le partage de la recette publicitaire. »
Marie Hédin-Christophe : « La loi qui concerne les droits voisins a été votée et la gestion collective n’a pas été rendue obligatoire. C’est une victoire pour Google. »
« La notion de répartition est essentielle. Si on opte pour une gestion collective, on peut décider de cette répartition. Sinon c’est Google qui va continuer de faire la loi. Il faut aussi défendre le fait que les coûts éditoriaux et les cartes de presse soient un critère de répartition. »
Pablo Aiquel : « La reconnaissance du travail c’est d’avoir accès à un cadre social. Il n’y pas de barème de rémunération minimum pour les piges. Je ne comprends pas qu’un syndicat parle de droits voisins quand il ne parle pas de salaires au sein de la branche. »
« Aujourd’hui, je dis au nom du SNJ-CGT que nous allons demander à ce que tous les correspondants locaux de presse soient inclus dans les accords de droits voisins. »
À retenir
Le coeur des négociations porte sur la gestion collective de la répartition. Les différents interlocuteurs affirment qu’il faut une coordination des différentes entreprises de presse.
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « L’Atelier école. Le journalisme politique s’enseigne t-il ? ».
Photo : Zoé Keunebroek/EPJT
Animé par Stéphanie Lebrun, directrice du CFJ Paris, avec Pascale Colisson, responsable pédagogique chargée de l’alternance et de la mission Egalité et lutte contre les discriminations à l’IPJ, avec Maria Santos Sainz, docteur en sciences de l’information et maître de conférences à l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) et Pierre Savary, directeur de l’ESJ Lille.
Les enjeux
Le constat est clair : le journalisme politique ne fait plus rêver. Les écoles cherchent un moyen de se réinventer car si « la politique des petites phrases fait peur », le sujet politique passionne lui toujours les étudiants. Plus encore que la manière de traiter le journalisme politique, c’est la question du militantisme et du journalisme d’opinion qui interroge les élèves.
Ce qu’ils ont dit
Maria Santos Sainz : « A l’IJBA, on essaye de contrecarrer le manque d’appétit pour le journalisme politique. On fait tout pour introduire des nouvelles manières de faire, comme le journalisme politique de proximité. Les étudiants veulent parler de politique autrement, ils veulent être plus près du terrain. »
« Je me permets de citer Albert Camus qui nous disait que « Le goût de la vérité n’empêche pas de prendre parti ». »
Pierre Savary : « Les étudiants s’interrogent sur la question du militantisme, sur la politique mais aussi sur l’environnement. Beaucoup d’entre eux se demandent comment interroger des personnes dont les positions vont parfois à l’encontre de leurs convictions. »
Pascale Colisson : « Les étudiants voient encore le journalisme politique comme un journalisme de déjeuner, de corridor ou de couloir. En fin de compte, le journalisme politique n’est pas seulement une pratique de plateau télé et tous les journalistes peuvent traiter de politique dans leur domaine. Un spécialiste de l’agriculture peut s’emparer de la politique pour traiter ses sujets. »
Stéphanie Lebrun : « C’est ce que vous avez envie de faire avec ce métier qui compte. »
À retenir
C’est en privilégiant les nouveaux formats que l’on peut réussir à intéresser de nouveaux publics au journalisme politique. Le rapport au militantisme doit, lui aussi être repensé. Avoir des convictions et prendre parti ne doit pas empêcher d’avoir une méthodologie journalistique issue des faits. La conférence s’est terminée par une vague d’espoir donnée aux nombreux étudiants en journalisme présents dans la salle, la directrice du CFJ les invitant à innover dans ce qui est « le plus beau métier du monde ».
Zoé Keunebroek et Célio Fioretti (EPJT)
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Journalistes et politiques : l’importance d’une connaissance scientifique partagée »
Photo : Marion Galard / EPJT
Animée par Benoît Tonson, chef de rubrique science de The Conversation, avec Michel Dubois, sociologue des sciences et techniques au CNRS, Aline Richard, rédactrice en chef du magazine Le Figaro Santé, Corinne Vanmerris, directrice adjointe et directrice des études de l’ESJ Lille et Jade Lindgaard, journaliste au pôle écologie de Mediapart.
Les enjeux
Les journalistes et les responsables politiques sont insuffisamment formés aux questions scientifiques. Pour répondre à ce besoin, des formations spécifiques se développent, comme le master 2 de l’ESJ. Comment les journalistes doivent-ils adapter la parole scientifique au grand public ? Réponse avec ces quatre interlocuteurs.
Ce qu’ils ont dit
Aline Richard : « Tout le monde peut être journaliste scientifique. Ça fait peur un peu, les personnes se disent que c’est difficile. Mais avec du travail, tout est possible. Une formation scientifique préalable n’est pas un prérequis. »
« Nous constatons qu’il y a un problème culturel : personne ne remet en cause les statistiques scientifiques car personne ne les comprend, y compris certains journalistes et politiques. Les sujets scientifiques devraient intéresser plus les politiques. »
« Il faut que tous les journalistes jouent le jeu, ils doivent se renseigner pour ne pas raconter n’importe quoi. Il ne faut pas se limiter à interviewer les mêmes experts. La précipitation pour interviewer Didier Raoult pendant la pandémie de Covid-19 a été terrible. »
Corinne Vanmerris : « Je ne sens pas une grande appétence chez les étudiants pour les sciences. Nous avons 15 places dans le master 2 de journalisme scientifique. Il y a seulement une cinquantaine de candidats dans cette filière. »
Michel Dubois : « Nous avons réalisé une enquête nationale sur les Français et la science. Nous avons constaté qu’environ 8 Français sur 10 font confiance aux scientifiques et c’est le cas depuis les années 1970. »
« Toutefois, nous avons aussi constaté qu’environ 60 % des Français considèrent aujourd’hui que la science apporte autant de bien que de mal. C’est un résultat assez nouveau. »
Jade Lindgaard : « Est-ce qu’une Assemblée où les élus auraient tous une thèse en science serait plus démocratique ? Pas forcément. Des députés ont déposé des amendements radicaux sur l’écologie et ils n’ont pas de formation scientifique. »
« C’est un progrès que les écoles de journalisme proposent des formations en sciences mais ce qui fait qu’un média produit une information juste et audacieuse, c’est son modèle économique. »
À retenir
Les journalistes ne peuvent pas être spécialisés sur tous les sujets mais ils doivent avoir suffisamment de connaissances scientifiques pour comprendre les scientifiques. Les hommes et femmes politiques ne peuvent pas être tous des experts non plus mais on constate parfois un manque d’intérêt pour certains sujets scientifiques.
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Les états généraux de la formation des journalistes ».
Des représentants de la Conférence des écoles de journalisme (CEJ) et des étudiants des écoles reconnues par la profession ont débattu des enjeux de la formation des journalistes. Photo : Célio Fioretti/EPJT
Animé par Anne Tezenas, déléguée générale de Conférence des écoles de journalisme (CEJ), avec Arnaud Schwartz, secrétaire général de la CEJ, Cem Taylan et Lilian Ripert (EPJT), Léa Bouvet (EJDG), Héléna Lébely (EJCAM).
Les enjeux
Des représentants de la Conférence des écoles de journalisme (CEJ) et des écoles de journalisme reconnues sont revenus sur les grands enjeux de la formation des jeunes journalistes. Il s’agit notamment de la diversité dans les écoles et les rédactions et des difficultés d’insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail. Ces thématiques seront abordées lors des premiers États généraux de la formation des journalistes, prévus les 3 et 4 octobre 2022.
Ce qu’ils ont dit
Arnaud Schwartz : « Les objectifs de la CEJ et de ces États généraux sont de créer un dialogue entre les jeunes journalistes et les étudiants pour qu’ils partagent leur vision du métier. Ces discussions doivent aboutir à des propositions et des bonnes pratiques en matière de formation et d’emploi. »
« Nos étudiants nous font part de deux affirmations. Leur passion pour le métier de journaliste est aussi forte que celle de leurs prédécesseurs. Mais ils ils ne sont pas non plus prêts à tout sacrifier pour exercer cette profession. »
Anne Tezenas : « Nous avons lancé une enquête qui porte sur les quatre dernières cohortes qui sont sorties des quatorze écoles reconnues. Nous cherchons à savoir où ils en sont sur le plan professionnel et à quels problèmes ils sont confrontés. Une seconde enquête porte sur l’égalité des chances, la diversité et les pratiques des écoles pour aider ses étudiants à s’insérer. »
Héléna Lébely : « La question de la diversité dans les écoles est essentielle, il y a un problème systémique d’homogénéité. Plus on avance dans les cursus, moins il y a de diversité. Dans nos écoles, nous avons songé à mettre en place un référent chargé des discriminations et une charte. Nous avons fait des propositions d’éducation aux médias, de tutorat avec les collèges et d’actions pour élargir la communication des écoles. »
Cem Taylan : « Nous voulons travailler sur l’idée préconstruite de la pige, associée à la précarité. Nous souhaitons mettre en place un module commun d’initiation à la pige, un système de parrainage avec les anciens étudiants et une journée dédiée à la gestion des aspects administratifs de la pige. »
« Nous avons proposé la création d’une carte de presse étudiante. Les étudiants souffrent d’un manque de légitimité de la part des sources qu’ils questionnent et d’interdiction d’accès à certains événements, notamment les manifestations. Cet outil doit nous faire réfléchir à notre posture professionnelle. »
À retenir
Les représentants de la CEJ et des étudiants des écoles de journalisme s’accordent pour dialoguer ensemble sur les enjeux de diversité dans les rédactions et de traiter en profondeur les conditions de travail et de santé mentale. L’ensemble des problématiques évoquées par les étudiants et les écoles seront au cœur des États généraux planifiés les 3 et 4 octobre prochains.
11 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Comment faire de l’écologie un vrai sujet politique ? ».
Photo : Amandine Hivert/EPJT
Animé par Stéphane Frachet, correspondant en région pour Les Echos, avec Jade Lindgaard, journaliste à Mediapart, Anne-Sophie Novel, journaliste pour le média Vert, Cyrille Vanlerberghe, rédacteur en chef Sciences et Médecine du Figaro et Florent Rimbert, membre de l’Alliance pour la Presse d’information générale (APIG)
Les enjeux
L’écologie peine à être au devant de la scène médiatique. Pendant la dernière compagne présidentielle, les candidats ont été peu interrogés sur ces questions par les journalistes. Un constat : l’écologie est encore peu abordée comme un sujet politique par les médias.
Ce qu’ils ont dit
Anne-Sophie Novel : « Je me suis rendue compte qu’on était nombreux à traiter ces questions mais qu’on était considérés comme moins sérieux que les autres journalistes. »
« Ce fait scientifique est réellement devenu un fait social, on observe quotidiennement ces bouleversements. »
« Il y a d’un côté les travaux scientifiques et de l’autre la manière dont on s’en empare. »
Jade Lindgaard : « À Mediapart, l’écologie n’a pas été pensée au départ comme une rubrique mais comme un sujet. »
« Pour moi, le climat n’est pas une question scientifique mais politique. »
« Bien sûr, c’est important d’avoir un apport scientifique mais d’un point de vue journalistique, le champ de bataille n’est plus là. La question, c’est interroger l’inaction notamment celle des politiques. »
Cyrille Vanlerberghe : « Pour imposer mes sujets, je me suis toujours appuyé sur la science. Ça me donne de la force. »
« Sur ces questions, il faut savoir interroger les bonnes personnes sur les bons sujets. »
À retenir
Les articles au sujet de l’écologie sont de plus en plus nombreux dans les médias. Mais pour, certains journalistes, il faut encore que cette question soit traitée de manière transversale dans les rédactions car l’écologie impacte l’ensemble de la société. Pour Jade Lindgaard, il faut, en tant que journaliste, interroger l’inaction des politiques et des citoyens vis-à-vis de ces bouleversements.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Enquêter sur les violences sexistes et sexuelles ».
Plusieurs journalistes se sont réunis mardi 10 mai 2022 aux Assises du journalisme de Tours pour un débat intitulé « Enquêter sur les violences sexistes et sexuelles ».
Photo : Aubin Eymard/EPJT
Avec Lorraine DE FOUCHER, journaliste pour Le Monde ; Giulia FOÏS, journaliste, animatrice de l’émission « Pas son genre » sur France inter ; Nadège IBANEZ, conseillère branches de la communication, des médias et des télécommunications de l’AFDAS ; Marine TURCHI, journaliste pour Médiapart ; Romain VERLEY, journaliste pour l’émission « Complément d’enquête ». Animé par Louise Audibert.
Les enjeux
Cinq ans après l’apparition du mouvement #Metoo, les violences sexistes et sexuelles sont toujours au cœur de l’espace médiatique. Encore récemment, des enquêtes journalistiques révélant des faits d’agressions sexuelles et de viols ont été publiées concernant Eric Zemmour et Patrick Poivre d’Arvor. Les révélations constantes sur ces violences soulignent l’importance du travail des journalistes qui met en lumière un sujet systémique.
Ce qu’ils ont dit
Romain Verley : « Je comprends pourquoi ces femmes n’ont pas parlé. Nous, les médias, sommes les champions des #Metoo dans le sport, dans l’église ou tout autre domaine mais pas chez nous. Il y a un silence radio, un silence télé. »
« J’ai été de suite confronté à mon statut d’homme, je me suis beaucoup documenté. J’étais un petit peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. »
Marine Turchi : « 99% des affaires qu’on sort ne suscitent pas l’étonnement mais elles témoignent des alertes ignorées. »
« Libération de la parole est une expression journalistique paresseuse. La plupart du temps, ces femmes ont déjà parlé à un ami, à un collègue… »
Lorraine De Foucher : « La dénonciation de ces affaires est très peu souvent un problème de connaissance mais surtout de courage et de prise en main des choses. »
« Je pense qu’il faut comprendre que le viol n’a pas grand chose à voir avec le plaisir sexuel mais avec le pouvoir. »
Giulia Foïs : « Comme femme et ex-victime de viol, je suis admirative de ces femmes journalistes qui recueillent la parole des victimes. »
« Le contradictoire est essentiel dans une démocratie, il est donc important d’entendre la victime mais aussi l’auteur. »
À retenir
Les violences sexistes et sexuelles sont systémiques et leur apparition à la une des médias ne signifie pas qu’elles sont nouvelles. Enquêter sur ces faits est essentiel pour éduquer tous les acteurs de la société civile ainsi que les jeunes journalistes.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Ils se sont lancés cette année »
Annabelle Perrin, François De Monnes, Frédéric Courant et Etienne Manchette se sont réunis pour le débat « Ils se sont lancés cette année » animé par Romain Colas. Photo : Nina Chouraqui/EPJT
Avec Frédéric COURANT, cofondateur et rédacteur en chef de L’esprit sorcier ; Annabelle PERRIN et François DE MONNES, cofondateurs de « La disparition » ; Etienne MANCHETTE, responsable Contenus et Partenariats RetroNews BnF ; Jéromine SANTO GAMMAIRE et Franck CELLIER, co-fondateurs du média réunionnais Parallèle Sud. Animé par Romain COLAS, rédacteur en chef adjoint de La Correspondance de la presse.
Les enjeux
Chaque année, les Assises du journalisme de Tours donnent la parole à ceux qui ont fait le pari de créer leur média pour faire vivre un projet éditorial. Pour cette quinzième édition, quatre jeunes médias sont présentés.
Ce qu’ils ont dit
Frédéric Courant : « Nous nous sommes lancés dans un financement participatif pour la liberté. C’est un modèle où le média appartient à ses lecteurs. »
Annabelle Perrin : « Comme la lettre a tendance à disparaître, on s’est dit qu’on allait faire un média épistolaire. Ce sont de longs récits où on parle de disparition de quartiers, de prisons, d’arbres… On voulait que la forme coïncide avec le fond. »
François De Monnes : « On raconte des gens qui luttent, des histoires d’amour, de fraternité et bien d’autres. Les journalistes écrivent dans une lettre que les abonnés reçoivent dans une enveloppe. Ils trouvent à l’intérieur une carte postale qui illustre le récit. On fait également appel à des auteurs pour écrire les lettres. »
« Notre principal enjeu, c’était de nous faire connaître. On a commencé à bâtir une newsletter gratuite avant d’envoyer nos premières lettres. Cela nous a permis d’avoir un premier socle de lecteurs. »
Etienne Manchette : « Les fonds de presse écrite sont gigantesques. On fait des sujets liés à l’actualité, mais on essaie surtout de faire du temps long, en amenant un propos universitaire qui permet de nourrir un peu plus le sujet. »
Franck Cellier : « Après avoir créé le média Parallèle Sud, on est parti à la rencontre des gens qu’on avait croisés lors de nos reportages et qui nous disaient qu’ils avaient besoin d’une presse différente. À La Réunion, il y a une forte envie de retrouver une expression qui concerne les initiatives citoyennes. »
Jéromine Santo Gammaire : « Quand c’est gratuit, les gens soutiennent. Mais après, ils ne payent pas forcément. »
À retenir
Lors de leur lancement, et encore des mois après, les nouveaux médias rencontrent des difficultés similaires. Il faut tout d’abord conquérir une audience et se faire connaître. Ensuite, des fonds économiques sont nécessaires pour financer de jeunes projets éditoriaux. Pour cela, ils misent notamment sur le crowdfunding. Mais parfois, même s’ils récoltent des dons qui leur permettent de développer leur projet, ils ne leur assurent pas pour autant une viabilité.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement : » Quel regard des médias sur les femmes en politique ? »
Photo : Margot Ferreira/EPJT
Avec Marlène Collomb-Gully, professeur à l’Université de Toulouse et autrice ; Rose Lamy, autrice « Défaire le discours sexiste dans les médias », paru aux éditions JC Lattès ; Sandrine Rousseau, économiste membre d’EELV, candidate aux élections législatives. Animé par Pascale Colisson, responsable pédagogique à l’IPJ.
Les enjeux
En France, le traitement médiatique des femmes politiques pose question dans un contexte de médiatisation croissante de la vie politique. À l’image de Sandrine Rousseau dans les médias, qui dénonce une forme de sexisme.
Ce qu’ils ont dit
Rose Lamy : « J’ai des doutes sur le fait que la parité règle tout dans les rédactions. C’est une question de discours. Cela relève de l’effort citoyen. »
Marlène Coulomb-Gully : « Le rapport à l’autorité dans les médias reste une prérogative masculine. »
Sandrine Rousseau : « Une machine de guerre se met en place pour les femmes en politique pour démontrer leur incompétence. »
« La manière dont j’ai été médiatisée pose une question éthique et déontologique. »
À retenir
Les intervenantes ont toutes fait le même constat : les médias français réservent un traitement sexiste aux femmes politiques. Des solutions sont envisagées, telles que la présence de « gender editor » dans les rédactions. Mais cela ne suffit pas, selon Rose Lamy, qui soulève les efforts de déconstruction à faire sur la question féministe.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « ÉCARTS DE REPRÉSENTATION ET STÉRÉOTYPES GENRÉS DANS LES MÉDIAS : OÙ EN SOMMES-NOUS ? »
Photo : Samuel Eyene/EPJT
Animé par Gilles BASTIN, professeur de sociologie à Sciences Po Grenoble/université Grenoble Alpes ; Marlène COULOMB-GULLY, professeure des universités à l’université de Toulouse et Ange RICHARD, doctorante à Sciences Po Grenoble/université Grenoble Alpes.
Les enjeux
Les stéréotypes et le manque de diversité demeurent criants dans les médias d’information. Certaines catégories ne sont pas ou peu représentées. Comme l’indiquent les résultats du Global Média Monitoring Project (GMMP) présentés par Marlène Coulomb-Gully ou encore Ange Richard et Gilles Bastin, représentants de Gendered News, la parité homme et femme peine à être respectée dans les rédactions françaises.
Ce qu’ils ont dit
Marlène Coulomb-Gully : « Nous avons constitué un corpus de médias aussi large que possible : 10 journaux, 10 stations de radios et 10 fils Twitter. »
« Dans les médias français, 30 % des informations traitent de femmes. 70 % traitent donc des hommes. Les médias font preuve d’une inertie préoccupante s’agissant de l’égalité femme et homme au sein de leur représentation. »
« Les femmes progressent vers une plus grande parité mais c’est seulement à travers des thématiques comme le social. »
Ange Richard : « Nous sommes encore loin [de la parité dans les médias]. »
« Il y a des manières genrées de dire “dire” : les femmes ont plus de chance de voir leurs phrases introduites avec les verbes “marteler” ou “rapporter”, tandis que pour les hommes c’est plutôt “alerter”, “avertir” etc. »
Gilles Bastin : « L’objectif de ce site est d’objectiver la réalité. »
À retenir
Les intervenants présents lors de l’atelier “Écarts de représentation et stéréotypes genrés dans les médias : où en sommes-nous ?” ont tenu à rappeler qu’il existe des écarts. Marlène Coulomb-Gully a souligné que « 70 % des nouvelles traitent des hommes ». Qu’il s’agisse du nombre de femmes dans les rédactions ou encore des personnalités au cœur de l’actualité, le traitement médiatique est inégal. Les journaux doivent rendre compte de la diversité de la société à travers leurs sujets sans oublier que celles et ceux qui embrassent la profession doivent venir de tous parts.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Couvrir les élections législatives avec les données et outils Google »
Denis Vannier anime son atelier sur les outils Google. Photo : Léo Berry/EPJT
Présenté par Denis VANNIER, journaliste et formateur indépendant.
Les enjeux
Les élections législatives approchent à grand pas. Pour les traiter en cartes et en infographies, Google met à disposition des journalistes des outils.
Ce qu’il a dit
« Les recherches avancées sont très efficaces. Les opérateurs (site: ; filetype: …) permettent de cibler des types d’informations. Le cache de Google permet également de récupérer des informations qui ont été effacées. »
« L’outil roi pour visionner des données lorsqu’on n’est pas un grand designer est Flourish. L’outil est gratuit pour les journalistes et les rédactions. Tableau s’adresse plutôt aux experts en visualisation de données. »
« My Maps permet de faire une carte rapidement. Par exemple, cela permet d’indiquer où se trouvent les bureaux de vote d’une commune. Il suffit de récupérer les données de géolocalisation sur une plateforme d’opendata. »
À retenir
Les outils Google permettent de couvrir rapidement des informations électorales. Pour produire des visualisations plus élaborées, des outils comme Flourish peuvent être utiles.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « L’info politique dans les médias locaux : privilégier le lien avec le public »
Géraldine Houdayer, Simon Barthelemy, Stéphanie Zorn et Jimmy Darras participaient à la conférence « L’info politique dans les médias locaux : privilégier le lien avec le public » animée par Richard Hecht. Photo : Charlotte Morand/EPJT
Avec Simon BARTHELEMY, journaliste et cofondateur de Rue 89 Bordeaux ; Jimmy DARRAS, chef de projet pour Ouest Medialab ; Géraldine HOUDAYER, journaliste web France Bleu ; Stéphanie ZORN, rédactrice en chef adjointe La voix du Nord. Animé par Richard HECHT, Union des Clubs de la Presse de France et Francophones (UCP2F).
Les enjeux
En cette année électorale, les médias locaux doivent multiplier leurs stratégies pour diffuser l’information politique et espérer toucher les publics. Pour ce faire, ils privilégient le lien avec eux.
Ce qu’ils ont dit
Géraldine Houdayer : « Il y a eu une crise de confiance envers les médias. Dans ce moment de crise, il faut être acteur et forger des liens entre nos publics et ceux qui les représentent. L’idée c’est de dire : nous parlons de ce qui vous concerne. »
Simon Barthélémy : « Chez Rue89, on s’est demandé comment faire pour sortir à la fois de cette culture du clash tout en essayant de traiter localement les sujets qui peuvent intéresser nos lecteurs et nos auditeurs. »
« Nous avons aussi souhaité donner la parole aux gens que l’on n’entend pas trop. Pour cela, nous avons organisé des débats entre des personnes qui ne sont pas forcément le plus en vue médiatiquement. »
Jimmy Darras : « Le local intervient dans des dispositifs d’interaction qui ouvrent la discussion, le débat et la consultation avec le public du territoire et permet aux rédactions d’avoir de nouveaux angles et de nouveaux formats. »
Stéphanie Zorn : « Nous, médias traditionnels, n’avons pas forcément la bonne manière de parler aux jeunes. A La Voix du Nord, on s’est demandé comment mieux parler des élections aux jeunes avec eux. »
« Les thématiques qui intéressent les jeunes ne sont pas les mêmes. Nous avons lancé de nouveaux formats et avons pensé de nouveaux angles pour essayer de nous adapter à leurs codes. »
À retenir
Pour tenter d’informer le public sur la politique, les médias locaux ont lancé plusieurs initiatives. Entre débats participatifs, consultations citoyennes, nouveaux formats, plateformes collaboratives, nouveaux angles et discussions, ils ont décidé de privilégier le lien avec celui-ci. Les intervenants ont également pointé du doigt l’importance de s’adapter à son audience, notamment en ce qui concerne les jeunes en période électorale.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Quand les journalistes se plantent – Du devoir de rectifier ses erreurs ».
Photo : Samuel Eyene/EPJT
Animé par Pierre GANZ, Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), avec Annick DUBIED, professeure ordinaire en journalisme, directrice de l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel et vice-présidente du Conseil de presse suisse ; Loris GUÉMART, rédacteur en chef adjoint pour Arrêt sur images ; Anne KERLOC’H, rédactrice en chef de 20 min ; Gilles VAN KOTE, directeur délégué aux relations avec les publics pour Le Monde.
Les enjeux
La défiance envers les journalistes est un phénomène constant dans la presse, notamment porté par des erreurs dans le traitement de l’information. Au sein des rédactions, se tromper est parfois mal appréhendé par les journalistes. Quatre intervenants apportent leur éclairage sur le sujet.
Ce qu’ils ont dit
Gilles Van Kote : « Nous produisons du contenu éditorial tous les jours, il y a forcément des erreurs qui nous échappent. Nous sommes un quotidien, c’est humain. Un rectificatif s’impose lorsque c’est une erreur factuelle. »
« Nous avons plusieurs niveaux de relecture, avec des éditeurs qui ont aussi un rôle de vérificateurs de l’information. »
Anne Kerloc’h : « Ça commence avant la rédaction, dès l’école où l’on vous apprend des principes. Nous avons aussi nos processus internes, nous avons nos relecteurs puis une fois qu’il y a une erreur, nous faisons un debrief. »
« L’édit c’est une précision, lorsque l’article est en cours d’écriture. Le rectificatif, c’est plutôt lorsqu’il y a une erreur »
Loris Guémart : « J’étais lecteur avant d’être journaliste, le seul moyen de résoudre ça [NDLR : au sujet des erreurs] c’est de les mettre en avant, de les corriger et d’en parler. »
« On essaye de s’astreindre à plus de rigueur dans nos articles. »
Annick Dubied : «Je trouve réjouissant de voir ces initiatives [NDLR : au sujet des mécanismes de rectification des erreurs] se répliquer car il faut permettre aux publics et aux journalistes d’en discuter. »
À retenir
Les quatre acteurs de l’atelier ont exprimé leurs positions respectives en mettant l’accent sur l’importance de la reconnaissance des erreurs commises par les journalistes. Les lecteurs doivent être au courant lorsque les journaux apportent des corrections et des rectifications. Il est important de déconstruire la gêne qui existe autour de ce sujet et de répondre aux erreurs de manière collective. Néanmoins, des mécanismes de correction existent avant la parution d’un article, à l’image du rôle primordial des éditeurs ou des chartes de vérification.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « L’EMI tout au long de la vie ».
À la suite de la conférence, les intervenants ont pu échanger avec le public sur l’avenir de l’EMI. Photo : Sarah Chevalier / EPJT
Animé par Pascal RUFFENACH, P-DG du groupe Bayard et président de l’APEM.
Avec Antoine BAYET, journaliste et directeur éditorial de l’INA, auteur de « Voyage aux pays de la dark information » paru aux éditions Robert Laffont et Marie-Laure CHÉREL, directrice du département des publics à la BNF et Olivier MAGNIN, responsable d’Image’IN du Pole Education à l’image, aux médias et à l’information de la Ligue de l’Enseignement.
Les enjeux
L’EMI (éducation aux médias et à l’information) occupe une place de plus en plus importante dans une société où l’information est omniprésente et où la défiance envers les journalistes est grandissante. L’EMI est souvent associée à l’école et aux enfants, mais cela ne s’arrête pas là. De nombreuses initiatives voient le jour et l’objectif est désormais de partager les connaissances.
Ce qu’ils ont dit
Antoine Bayet : « J’étais face à quelqu’un qui était perdu et noyé dans l’information. En documentant ce décrochage, j’avais envie de faire remonter quelques personnes à bord. »
« La plupart des personnes que j’ai rencontrées ont eu une mauvaise expérience avec un journaliste. »
« L’EMI pour les adultes, je ne sais pas si c’est vraiment une éducation. Dire aux gens que l’on va les éduquer c’est flippant, je ne sais pas si EMI est le bon terme dans ce cas. »
Marie-Laureom Chérel : « La BNF possède 44 km linéaires de collection de presse. Nous essayons de transmettre tout en valorisant nos collections. »
« Nous avons développé un atelier autour de la censure : peut-on tout lire ? Les élèves débattent ensuite sur un ouvrage qui a fait polémique. »
Olivier Magnin : « En 2019, on a lancé un parcours éducatif, « Les veilleurs de l’info », qui s’adresse à des animateurs et des enseignants. Notre idée, c’est d’outiller et de former des gens dont l’information n’est pas le métier. En sachant que tout le monde ne peut pas le faire. »
« Le public pénitentiaire a un rapport passionnel à l’information mais elle est assimilée aux chaînes d’info en continu. »
À retenir
L’EMI ne se résume pas au cadre scolaire. L’idée de travailler également sur l’esprit critique se développe et cela devrait se poursuivre tout au long de la vie. « Il faut désormais savoir comment on peut partager ces savoirs », conclut Pascal Ruffenach.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « La presse régionale peut-elle se passer des correspondants locaux de presse ? »
L’atelier « La presse régionale peut-elle se passer des correspondants locaux de presse ? » ouvrait les assises du journalisme ce mardi 10 mai 2022 à Tours. Photo : Charles Bury/EPJT
Animé par Sophie Massieu, journaliste indépendante, avec Elina Barbereau, correspondante à Ouest-France, Caroline Devos, journaliste à La Nouvelle République, Antoine Comte, journaliste en formation à l’Ecole publique de journalisme de Tours et Loris Guémart, médiateur d’Arrêt sur Images.
Les enjeux
Les correspondants locaux de presse occupent une place centrale dans les journaux régionaux : à Ouest-France par exemple, environ 70 % du journal est réalisé grâce à leur production. Considérés comme de véritables journalistes, ils sont pourtant payés entre 3 et 4 euros de l’heure et leur statut ne leur permet pas de bénéficier des protections au même titre que les journalistes salariés.
Ce qu’ils ont dit
Loris Guémart : « Les correspondants locaux de presse sont considérés comme des journalistes dans les rédactions. Ils sont payés entre trois et quatre euros de l’heure. Et ce n’est pas un salaire, c’est une sorte de rétribution. »
« Il y a des instructions très claires dans les rédactions : si on commence à exiger des sujets, à suggérer des angles, il y a un risque de requalification de la relation de travail. »
Elina Barbereau : « Nous avons réalisé une enquête, sur plus de 600 correspondants locaux de presse répondants : 51 % d’entre eux déclarent avoir besoin de ce travail pour vivre. Chez les femmes correspondantes, ce chiffre monte à 64 % » « En tant que correspondante et concernant les sujets que l’on couvre, il m’arrive d’être en concurrence avec des journalistes des journaux concurrents. A la fin, on sort à peu près la même chose. »
Antoine Comte : « Lors de mon enquête, j’ai constaté que beaucoup de correspondants vivaient de ce travail et ils ne souhaitaient pas donner leur nom de peur que cela leur porte préjudice. Il est important de se rendre compte que ce sont des gens derrière. »
Caroline Devos : « La presse quotidienne régionale cherche un modèle pour se réinventer. La pagination se réduit et se réduira peut-être encore. Les ventes s’effondrent, on ne pourra pas embaucher tous les correspondants qui font un travail de journaliste. »
À retenir
Certains correspondants locaux de presse réalisent le même travail qu’un journaliste professionnel, mais pour moins de cinq euros de l’heure, sans aucune protection sociale. Du côté des rédactions, leur travail constitue une source de contenu journalistique pour un coût peu élevé. Par ailleurs, leur statut ne leur permet pas d’être représenté dans les rédactions.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Les datas pour traiter de la politique »
Quatre intervenants étaient présents pour débattre de la place du journalisme de données dans le traitement de l’actualité politique. Photo : Léo Berry/EPJT
Avec Karen BASTIEN, cofondatrice de Wedodata ; Julien KOSTRECHE, cofondateur de Ouest Medialab ; Simon MALFATTO, datajournaliste à l’AFP.
Animé par Marianne BOUCHART, fondatrice de HEI-DA.
Les enjeux
Les données et leur analyse ont joué un rôle important dans le traitement médiatique de la campagne présidentielle. Des sondages à l’activité des députés en passant par les parrainages, elles ont permis aux journalistes d’aborder des angles originaux. Pourtant, leur utilisation pose de nombreux défis aux journalistes, tant sur le plan analytique que technique.
Ce qu’ils ont dit
Karen Bastien : « Wikipédia a un gros potentiel. Les données sont libres, ouvertes, accessibles à tous. Nous sommes donc allés voir ce qu’il se passait sur les pages des personnalités politiques. Nous avons également utilisé Twitter et les questions au gouvernement. »
« Nous avons lancé un nouveau format hier. Le bot @parlementweets aspire tous les tweets des députés. Nous avons récupéré près de 2 millions de tweets que les utilisateurs peuvent explorer en interagissant avec le compte. »
Simon Malfatto : « Les contraintes à l’AFP sont très fortes. Le temps de production est réduit. Nous produisons une vingtaine de graphiques chaque jour. Il faut réagir à l’actualité et proposer du choix à nos clients pour qu’ils puissent choisir leurs propres angles. »
« Nous avons choisi de publier une série de graphiques thématiques chaque semaine pendant la campagne. Le jour de l’élection, nous avons fait une carte qui se mettait à jour en direct. C’est un travail d’anticipation, il ne faut pas que ça tombe en panne. »
Julien Kostrèche : « Nous faisons travailler des journalistes avec des étudiants en graphisme et en design. Cela nous a permis de développer plusieurs projets ayant pour thème la politique. »
« Un des intérêts est de laisser les jeunes s’emparer de ces données pour raconter la politique. Certains projets fonctionnent très bien, car l’intérêt du public est fort pour ce type de production. »
À retenir
Le journalisme de données a permis de traiter l’actualité politique de manière différente durant la campagne présidentielle et les journalistes développent de nouveaux formats en vue des élections législatives. Les lecteurs sont friands de ce type de contenus, que les rédactions produisent de plus en plus. L’opendata ouvre de plus en plus de possibilités, malgré les difficultés parfois rencontrées pour l’obtention de données à l’échelle locale.
10 Mai 2022 | Les résumés, Tours 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « #metoopolitique, #metoomedias, #metooculture : et maintenant ? ».
Pour cette soirée de lancement au théâtre de l’Olympia, cinq journalistes, autrices et metteuses en scène ont discuté des enjeux du mouvement #MeToo. Photo : Amandine Hivert/EPJT
Animé par Constance Vilanova, journaliste pigiste et co-fondatrice du collectif #DoublePeine.
Avec Cécile Delarue, journaliste et autrice, Hélène Devynck, journaliste, scénariste et autrice, Claire Lasne Darcueil, comédienne, metteuse en scène, autrice et directrice du conservatoire nationale supérieur d’art dramatique, Giulia Foïs, journaliste, autrice et animatrice sur France Inter, Fiona Texeire, collaboratrice d’élus et co-initiatrice du mouvement #MeToopolitique, Titiou Lecocq, journaliste et autrice.
Les enjeux
Depuis 2017, le mouvement #MeToo permet à des femmes victimes de violences sexuelles de prendre la parole. Les témoignages de comédiennes, journalistes et responsables politiques sont venus s’ajouter à ceux d’actrices. Cinq ans après, quelles batailles reste-t-il à mener ?
Ce qu’ils ont dit
Giulia Foïs : « J’étais la première surprise de la longévité de #MeToo, mais si on baisse l’attention, si on s’endort, c’est fini. Dans l’histoire, tous les mouvements féministes se sont arrêtés. La question est de savoir ce qu’on peut changer avant la fin du mouvement. »
« Le viol est le seul crime qui n’empêche pas d’être élu aux législatives. C’est une spécificité française. Au Danemark, le maire de Copenhague a été accusé d’agression sexuelle. Il a quitté ses fonctions, jugeant que ces accusations pouvaient mettre à mal la situation politique de la mairie. En France, la question ne se pose pas. »
Claire Lasne Darcueil : « L’injustice et la discrimination ne concerne pas que la cause féministe. Les minorités opprimées sont une immense majorité. Il suffit qu’un fil se crée entre les personnes opprimées depuis des siècles pour que tout change. »
« Je ne m’explique pas pourquoi #MeTooTheatre est arrivé quatre ans après #MeToo. Il faut dire que la majorité des metteurs en scène sont des hommes blancs. C’est aussi le répertoire national, la culture sur laquelle on est assis, et que l’on aime, qui est dangereuse. »
Hélène Devynck : « Le viol est le seul crime où la honte est basculée sur la victime. D’ailleurs, il est très difficile de se définir quand on a subi une agression sexuelle. Victime renvoie à une image de faiblesse. On parle aussi de victime autoproclamée, ça veut dire menteuse ou victime présumée mais qui présume ? Certaines utilisent le mot survivante mais je n’ai pas l’impression d’avoir risqué ma vie. Il y a encore le mot affranchie, c’est jolie mais ça ne veut pas dire grand chose. Au final, il n’y a que l’agresseur qui est content du mot victime. »
Cécile Delarue « L’intention de PPDA en portant plainte pour dénonciation calomnieuse, c’est de nous faire peur. On aimerait dire qu’on n’a pas peur, mais c’est faux parce que quand on est accusé, il faut trouver un avocat, engager des frais. Porter plainte, ça a un coût professionnel, familial et financier. »
À retenir
Le mouvement #MeToo permet de mettre sur le devant de la scène la question des violences sexistes et sexuelles et de faire face à l’ampleur des chiffres. En moyenne, une femme en France est victime de viol toutes les sept minutes. Aucun milieu n’est épargné. L’enjeu aujourd’hui est de faire perdurer le mouvement pour faire, petit à petit, bouger les lignes.
19 Mar 2022 | En direct, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Violences faites aux femmes, le rôle des journalistes »
Animé par Darline Cothière, directrice de la Maison des Journalistes (France), avec Ahlem Bousserwel, secrétaire générale de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), Kerim Bouzouita, docteur en anthropologie, chercheur spécialiste en médias et communication, Wafa Saleh, journaliste à Neswan Voices (Yémen).
Les enjeux
Vendredi après-midi, la parole était aux femmes. Dans les pays arabes, elles sont très peu représentées dans les contenus mais aussi dans les rédactions. Le cas du traitement médiatique des féminicides a également été évoqué.
Ce qu’ils ont dit
Wafa Saleh : « Avant la guerre au Yémen, les femmes n’avaient pas la parole dans les médias. Après la guerre, la situation a empiré. Il y a très peu de femmes journalistes. Nous avons été chassées de nos rédactions et nous devions rester à la maison. »
« Au Yémen, les femmes ne veulent pas témoigner par peur des autorités. »
« Pendant la guerre, les organes de presse yéménites ont exploité la souffrance des femmes pour incriminer les opposants. »
Ahlem Bousserwel : « Il y a eu du progrès en Tunisie, une prise de conscience. Mais on n’arrive pas à traiter convenablement les violences faites aux femmes. Ce n’était pas un bon sujet car cela fait mal à l’autorité patriarcale présente en haut du pouvoir. »
« La formation ne donne pas de réponses immédiates. Il faut un cycle réfléchi au sein d’une rédaction. Rien ne tolère de fermer les yeux sur les violences faites aux femmes. Il faut donner la parole aux femmes parce qu’elles parlent de leur soucis mieux que les autres. »
« En 2014, moins de 15 % de femmes étaient à la tête de médias. Il y a de nombreuses violences faites aux femmes journalistes. C’est le moment pour elles de s’organiser en tant que journalistes et en tant que femmes. »
Kerim Bouzouita : « Le traitement des violences faites aux femmes représentent moins de 1% des contenus. »
« Les raisons de ce traitement médiatique sont le modèle économique des médias privés qui cherchent le sensationnalisme, la position des journalistes qui sont avant tout des citoyens et la difficile marge de manœuvre de la société civile qui pourrait pousser à une régulation politique. »
À retenir
Ce débat a fait ressortir deux difficultés principales : être femme et être femme journaliste. Au Yémen, le travail de Wafa Saleh est largement entravé. En 2019, elle a participé à la création du réseau Neswan Voices pour diffuser des informations sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière la situation des femmes yéménites. En Tunisie, les contenus qui parlent des femmes et qui leur donnent la parole sont encore très rares, ce que dénonce Ahlem Bousserwel.
18 Mar 2022 | Les articles, Les résumés, Tunis 2022
Find out more about the event « Spotlight on Yemen: state of journalism and media ».
Picture: Shirine Ghaemmaghami /IHECS
Panelists: Basheer Al Dorhai, Project Coordinator for Internews, Ahlam Al Mekhlafi, Freelance Journalist, Sahar Mohammed, Freelance Journalist. Moderated by Saoussen Ben Cheikh, project director for Internews (Tunisia).
Issues
Since 2014, Yemen has been at war resulting in one of the worst humanitarian crises the world has ever faced. The war has impacted the entire civilian population, namely including journalists. They confront many difficulties and numerous dangers as they try to continue their work of informing the local population. And they can only just about get by financially through the completion of their work.
What they said
Basheer Al Dorhai: “I have a colleague who graduated from university and spent six years in prison. He was not even a journalist yet. It turned his life upside down and he left Yemen. Journalists are killed and murdered regularly. A Yemeni journalist was recently killed while pregnant in a bomb attack. It’s incredibly tragic.”
“There was an attempt to create a new law that was supposed to help the media gain greater autonomy in 2013 but unfortunately it failed. As a result, there is no real independent media in Yemen. Media output is mostly politicized and government-controlled.”
Ahlam Al Mekhlafi : “Female journalists face even greater challenges. [We] don’t have the same rights as men as a simple citizen, but journalism is also a male-dominated profession. As women, we don’t have the right to travel, to express ourselves, to dream. (…) If you publish something that people don’t like, you can be attacked in your own home. (…) This is a very sensitive profession in our society.”
“Internet connections are very unreliable. When we are looking for information, it is difficult to communicate with other journalists. Sometimes the internet cuts out for several days.”
Sahar Mohammed: “Few Yemeni journalists speak English and that’s a problem. If a Yemeni wants to meet a person from another country, there is a [language] barrier. This means that the war in Yemen has little international media coverage.”
“I believe that training programs are the primary need for journalists. […] We need quality programs, training reporters who know our communities so that they can reflect locals’ views effectively.”
In brief
Currently, there is no real independence of the media in Yemen. Output is usually government-controlled and highly politicized. The situation is further complicated by the fact that no real law exists to protect the press. Yemeni journalists take huge risks when they decide to express their voices in news-making because censorship and government control are common place. Regarding education, there are only a few regions that offers training programs in journalism and, in general, they don’t offer appropriate education. That’s why Yemen is in need of funding and support to provide better education in the field of journalism.
Shirine Ghaemmaghami (IHECS)
18 Mar 2022 | En direct, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Comment favoriser l’inclusion et la participation citoyenne avec les médias numériques ? ».
Photo : Oujari Lamisse/ISIC
Animé par Inès Khelif, consultante (Erim, France) ; avec notamment Divina Frau-Meigs, titulaire de la chaire « Savoir Devenir » à l’Unesco ; Mouna Trabelsi, présidente de l’Association tunisienne des médias associatifs (ATMA).
Les enjeux
Pour le projet Jamil.net (Jeunesse Active, Médias Inclusifs et Littératie numérique), l’heure est au premier bilan. Cette initiative a pour but de favoriser la participation citoyenne des jeunes tunisiens par le biais des médias. Certaines porteurs du projet, ainsi que des partenaires et des jeunes qui en ont bénéficié, se sont rassemblés pour parler de leurs expériences avec Jamil.net.
Ce qu’ils ont dit
Divina Frau-Meigs : « Les conditions sanitaires ont beaucoup compliqué les choses, mais nos équipes ont su rester efficaces et organisées, ce qu’il est important de souligner. »
Sara Manai (bénéficiaire du programme) : « J’ai vraiment pu développer des compétences et un esprit critique, dans un contexte où les fake news circulent de plus en plus. »
Nada Oueslati, coach en média et information : « Les avancées technologiques en termes de communication sont à la fois une bénédiction et une malédiction. L’environnement médiatique peut être très nocif pour ceux qui n’ont pas une certaine éducation aux médias. »
Riadh Ben Marzou, expert en communication : « Le marché de la publicité est très petit en Tunisie ; toutes les radios privées en souffrent. Diplômé en entreprenariat, je défends cette cause et, à travers Jamil.net, j’essaie de trouver des solutions qui mêlent l’aspect média, l’événementiel et l’aspect digital. Pour moi, c’est la seule issue pour essayer de sauver ces radios. »
Inès Khelif : « Jamil.net, c’est pas juste de l’insertion socio-professionnelle ou de l’éducation aux médias. C’est un programme qui permet à chacun de suivre son propre chemin. Que ce soit pour de l’information, de l’éducation ou avoir un cadre favorable au développement personnel. »
À retenir
Jamil.net est un projet transversal et pluridisciplinaire. Il ne se contente pas de proposer de l’éducation aux médias, il participe également au développement de nombreux projets personnels. Geek Girl Digital en est un excellent exemple : avec un tel accompagnement, sa fondatrice, Rahma Rejab, a pu rendre viable son idée d’entreprise de communication digitale, dans un contexte où il est difficile pour une femme, seule qui plus est, de se faire entendre.
Si l’on a parlé de « bilan » lors de la conférence, Jamil.net n’est pas fini pour autant. Ses membres espèrent pouvoir le faire perdurer jusqu’en 2025 mais ce qui est sûr, c’est qu’il est encore sur les rails jusqu’à la fin de l’année 2023.
Oujari Lamisse (ISIC), Victor Broisson (IHECS)
18 Mar 2022 | Les articles, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Focus Yémen – l’état du journalisme et des médias »
Photo : Quentin Thévignot / IHECS
Animé par Saoussen BEN CHEIKH, directrice de projet pour Internews (Tunisie), avec Basheer AL DORHAI, coordinateur de projet pour Internews ; Ahmal AL MEKHLAFI, journaliste indépendante ; Sahar MOHAMMED, journaliste indépendante
Les enjeux
Cela fait plus de dix ans que la guerre fait rage au Yémen, entre une coalition menée par l’Arabie saoudite soutenant le gouvernement en place et les rebelles houthis. Selon les Nations unies, près de 400 000 personnes ont perdu la vie dans le pays depuis 2014, que ce soit lors des combats ou en raison de la famine et du manque d’eau. 24 millions de Yéménites vivent sous le seuil de pauvreté et dépendent entièrement de l’aide humanitaire.
Dans ce contexte, les journalistes (et particulièrement les femmes) font face à de nombreuses menaces en exerçant leur métier.
Ce qu’ils ont dit
Basheer AL DORHAI : « L’information au Yémen est la propriété des politiques. Nous luttons pour une information indépendante. »
Ahmal AL MEKHLAFI : « « Les souffrances des femmes journalistes sont deux fois plus importantes que celles des hommes. (…) Nous n’avons pas le droit de voyager, de nous exprimer, ni de rêver. »
Sahar MOHAMMED : « Il y a très peu de journalistes qui travaillent à plein temps. Beaucoup abandonnent leur profession car il n’y a pas de pérennité. »
À retenir
Les journalistes yéménites sont constamment sous pression, souvent arrêtés et parfois même menacés de peine de mort. Ils ne peuvent plus vivre entièrement de leur profession, car il est impossible d’avoir un revenu décent en tant que journaliste. Celles et ceux qui n’ont pas abandonné leur métier travaillent à temps partiel et vivent dans une situation très précaire financièrement. Les femmes journalistes font partie des premières victimes du conflit. Elles ont moins de revenus, moins de droits et moins de protection que les hommes. L’accès à l’information dans le pays est extrêmement limité, en raison du faible nombre de journalistes encore en activité et de l’accès à Internet quasiment inexistant dans le pays.
Quentin Thévignot-Dunyach (IHECS)
18 Mar 2022 | En direct, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Éduquer à l’information, ça s’apprend ! ».
Photo : Laure d’Almeida/EPJT
Animé par Étienne Récamier, auteur-conférencier en EMI, avec Khemais Bouali, directeur général et responsable des inspecteurs au ministère de l’Éducation (Tunisie), Bayan Tal, consultante en éducation aux médias et à l’information (Jordanie) et Divina Frau-Meigs, titulaire de la chaire Savoir Devenir à l’Unesco.
Les enjeux
L’Éducation aux médias et à l’information a pour objectif d’aider les citoyens à se repérer dans le flot d’informations et à comprendre comment travaillent les journalistes. Elle est un outil pour rapprocher les citoyens et les médias afin de réduire la défiance. Mais quelles sont concrètement les compétences à acquérir et comment les journalistes peuvent-ils les transmettre ? Plusieurs réponses existent et dépendent autant du public visé que des initiatives d’Éducation aux médias.
Ce qu’ils ont dit
Khemais Bouali : « En Tunisie, nous visons à élaborer un guide d’éducation aux médias pour les élèves et les instituteurs en partenariat avec la Deutsche Welle Akademie. La Tunisie passe par des mutations sociales et politiques qui influencent l’environnement scolaire. L’élaboration d’un programme d’EMI est le meilleur moyen pour construire un vivre-ensemble.»
Bayan Tal : « En 2019, nous avons élaboré une stratégie nationale d’éducation aux médias en Jordanie. Le gouvernement l’a adopté comme priorité nationale. On met l’accent sur la déontologie en contrecarrant les discours de haine misogynes ou racistes. »
« Le rôle des enseignants est capital. Dans les pays arabes, l’éducation a reculé et l’éducation aux médias et à l’information peut être un moyen pour perfectionner l’enseignement. Elle permet de développer un esprit critique face au danger des populistes. »
Divina Frau-Meigs : « La compréhension des images est essentielle pour limiter les risques de désinformation. Dans l’éducation aux médias, on a une approche assez équilibrée entre les opportunités et les prises de risques. Les jeunes aiment bien faire ce rapport bénéfices/risques. »
« Le risque s’apprend. Il faut accompagner les jeunes dans les erreurs qu’ils peuvent faire sur les réseaux sociaux. Mais c’est surtout les enseignants qui doivent être rassurés quand ils abordent des sujets difficiles.»
À retenir
L’éducation aux médias, au-delà du rôle des journalistes, est en train de se faire une place dans les programmes scolaires. Les actions peuvent être menées de concert avec les enseignants et visent surtout à développer l’esprit critique des élèves et à leur apprendre à analyser les images qu’ils voient passer sur les réseaux sociaux.
18 Mar 2022 | En direct, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Les journalistes, acteurs de l’éducation populaire »
Photo : Laure d’Almeida/EPJT
Animé par Hicham Houdaifa, directeur de la collection Enquêtes au sein de la maison d’édition En toutes lettres (Maroc), avec Hamida El Bour, directrice de l’Institut de presse et de sciences de l’information (Ipsi, Tunisie), Françoise Kadri, adjointe au directeur Maghreb pour l’Agence France Presse (AFP, France), Syrine Attia, rédactrice en chef Tunisie Brut (France)
Les enjeux
Vendredi matin, les invités ont débattu de l’éducation aux médias et plus précisément du rôle du journalisme dans l’éducation populaire.
Ce qu’ils ont dit
Hamida El Bour : « Nous menons plusieurs projets à l’IPSI autour de l’éducation aux médias avec différents publics. Nos étudiants vont notamment à la rencontre des citoyens. »
« On a aussi un club d’éducation aux médias lancé par le journaliste Najeh Missaoui qui fait beaucoup d’activités dans les régions pour former les gens sur le fonctionnement des médias et lutter contre les fake news. »
« L’objectif, c’est le public. L’idée est d’en faire un public conscient, une sorte de cinquième pouvoir. »
Françoise Kadri : « Depuis 2010, plus de 230 journalistes de l’AFP et du groupe Le Monde participent au collectif Entre les lignes. On anime des ateliers dans les écoles pour expliquer aux jeunes la hiérarchisation de l’info ou encore le détournement des images. »
« On leur apprend dans les ateliers à développer leur esprit critique, savoir trouver les bonnes sources. Il ne faut pas être passif vis-à-vis de l’information, il faut aller la chercher. C’est ce qu’on essaye d’apprendre à ces enfants. »
Syrine Attia : « Chez Brut, nous tentons de renouer avec l’audience en investissant les réseaux sociaux et en produisant des contenus qui intéressent les jeunes mais qui ouvrent également le dialogue social. »
« Je pense que l’éducation populaire, c’est aussi valoriser les actions qui font partie de notre patrimoine et de notre culture à travers certains parcours de vie. En mettant en avant certaines initiatives, on met en lumière notre culture populaire. »
« L’idée de Brut n’était pas de dire que Facebook n’est pas capable de préserver la circulation d’une information fiable mais d’aller directement sur la plateforme en tant que journalistes pour proposer des informations vérifiées, Je pense que l’éducation populaire, c’est au-delà de l’éducation académique qui est très importante. »
À retenir
Via l’éducation aux médias, les journalistes participent à l’éducation populaire. Deux dimensions essentielles sont apparues au cours du débat : la formation des citoyens pour s’informer correctement mais aussi regagner la confiance du public en faisant du journalisme pour et avec eux.
Salma Sissi (IPSI) et Chloé Plisson (EPJT)
18 Mar 2022 | Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Utiliser l’open data pour lutter contre les inégalités femmes-hommes ».
Photo : Lucas Turci /EPJT
Avec Marianne Bouchart, fondatrice et directrice de HEI-DA et Paul- Joël Kamtchang, secrétaire exécutif d’ADISI-Cameroun (Cameroun).
Les enjeux
L’open data, ce sont des données ouvertes auxquelles tout le monde peut accéder. Utiliser l’open data pour questionner la problématique du genre, c’est visibiliser objectivement les inégalités entre les femmes et les hommes. Marianne Bouchart et Paul-Joël Kamtchang, formateurs pour le projet MediaLab pour elles, rappellent l’importance des principes qui définissent l’open data : accessibilité, disponibilité, universalité et gratuité. Mais accéder aux données reste souvent un défi : les chiffres sont disparates, incomplets ou ne sont simplement pas « genrés ». Face à ce problème et face aux inégalités entre les hommes et les femmes, le data journalisme participe à la solution.
Ce qu’ils ont dit
Marianne Bouchart: « Avoir des données sur le genre, c’est permettre de mesurer l’évolution, visibiliser les disparités et les aberrations. C’est aussi donner une information parce que ça nous concerne tous et parce qu’il faut parler des inégalités femmes-hommes pour ne pas oublier qu’elles existent. »
« Tout n’est pas toujours rose. Les initiatives de collectes de données sont souvent disparates, incomplètes, car la collecte sur le terrain est compliquée.»
« Lutter contre les inégalités femmes-hommes à travers le journalisme, c’est aussi intégrer automatiquement la place de la femme à nos questionnements. »
« La formulation des statistiques est importante pour faire comprendre que les chiffres reflètent une problématique liée au genre.«
Paul-Joël Kamtchang: « Il ne faut pas oublier l’indépendance des organisations qui collectent les données. Leur crédibilité dépend finalement d’un travail consciencieux et indépendant. »
À retenir
Où trouver des données ouvertes?
- portail de data de l’OCDE
- portail de la Banque mondiale
- EIGE (Institut européen pour l’égalité des genres).
- Unicef data
- UN Women
- Plateformes officielles
- Sur le terrain
- Etc.
Comment participer à l’ouverture de données sur les femmes?
- Visibiliser les femmes dans les débats publiques ;
- Lutter pour la parité, à commencer par les rédactions ;
- Traiter de sujets sur les femmes ;
- Intégrer systématiquement la place de la femme à son questionnement.
Comment déconstruire les stéréotypes de genre ?
- Préférer des formulations adéquates (ex : « elle s’est fait agresser », remplacé par « elle a été agressée).
- Utiliser un langage épicène (ex : « droits humains », à la place de « droits de l’Homme »).
Comment peut-on utiliser l’open data pour lutter contre les inégalités femmes-hommes ?
- Appuyer la société civile dans le cadre du plaidoyer consacré au genre ;
- Encourager les médias à se spécialiser dans le traitement des données liées au genre ;
- Encourager les syndicats professionnels à adopter des politiques en faveur du genre.
18 Mar 2022 | Les articles, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Focus Niger: L’État du journalisme et des médias ».
Animé par Ousseina HAROUNA, journaliste pour Canal 3 Niger avec Moussa AMMA, journaliste pour la radio Anfani et rédacteur au journal L’Eclosion, Alhassane ABDOU-MAHAMANE, rédacteur en chef du Studio Kalangou, Amina NIANDOU, présidente de l’Association des Professionnelles Africaines de la Communication (APAC) Section Niger.
Les enjeux
Le Niger, pays secoué par des instabilités et défis sur différents niveaux politiques, médiatiques et sociétaux, essaye de préserver une certaine liberté aux journalistes. Mais les médias nigériens travaillent dans un contexte compliqué et en la présence de financement et mainmise politique sur les associations médiatiques. Les médias nigériens souffrent parfois d’un manque de matériel pour pouvoir offrir au public des productions de qualité alors que le rôle des femmes nigériennes journalistes reste faible.
Ce qu’ils ont dit
Moussa Amma: « On ne peut pas s’attendre à une production d’information de qualité, de liberté et de professionnalisme au Niger puisqu’il y a de plus en plus un manque de formation des journalistes » .
Alhassane Abdou-Mahamane :« Une des choses que les journalistes doivent savoir, c’est connaître le métier, ses droits et devoirs, afin de présenter un travail de qualité » .
« Si un journaliste ne dérange pas en travaillant sur une matière journalistique, il n’est pas journaliste : donner simplement une information ne suffit pas » .
Amina Niandou : « Les organes de presse au Niger sont confrontés à des difficultés car on n’arrive pas à différencier le service d’information et le service commercial. Nous sommes dans une situation mi-figue-mi-raisin : ce qui n’est pas vendable est en train d’être vendu et les médias deviennent des agences de communication. »
« Au Niger, les organisations féminines sont assez fortes mais les femmes n’ont pas assez de droits. La société nigérienne est une société assez conservatrice et les questions liées aux femmes demeurent absentes des médias. »
À retenir
La question du financement des médias privés est importante car seuls les médias publics bénéficient des financements de l’État, ce qui pose problème au niveau de la pluralité. Les organes de presse nigériens aimeraient se réunir et rassembler leurs compétences afin d’améliorer la qualité de leur travail journalistique et d’offrir au public un contenu riche.
Célina Braidy (UL), Joëlle Ghaby (UL) et Océane Ilunga (IHECS)
18 Mar 2022 | Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « DÉONTOLOGIE, ÉTHIQUE ET AUTORÉGULATION : QUELLES BONNES PRATIQUES ?».
Photo :Samia EL ACHRAKI/ ISIC
Animé par Ming Kuok Lim, conseiller à l’information et à la communication au Maghreb à l’Unesco, avec Kathleen Grosset, présidente du Conseil de déontologie journalistique et de Médiation (CDJM, France) ; Jean-Jacques Jespers, membre du Conseil de Déontologie Journalistique Belge (Belgique) ; Chadia Khedir, rédactrice en chef du département culturel Watanyia1 ; Atidel Mejbri, présidente du Conseil de Presse Tunisien (Tunisie).
Les enjeux
Dans une ère ou même les plus grands médias peuvent être victimes de fake news, la déontologie devient un sujet de débat de premier plan. Comment doit-elle s’organiser ? Quelle est sa légitimité ? Comment la financer tout en restant indépendant ? Comment la reconstruire dans un contexte post-révolution ? Autant de questions auxquelles un panel d’acteurs du milieu a tenté de répondre.
Ce qu’ils ont dit
Kathleen Grosset : « Le pluralisme, ce n’est pas la diversité d’une publication, mais la diversité des publications. »
Jean-Jacques Jespers : « Dans une société démocratique, il faut que les médias puissent tout dire, mais ils ne peuvent pas dire n’importe quoi. »
Chadia Khedir : « Le public est un acteur principal, qui doit avoir un rôle conscient. Pas comme un consommateur, mais comme quelqu’un qui a le droit d’être bien informé. »
Atidel Mejbri : « On a l’impression que c’est [le conseil de presse tunisien ] un pouvoir sur les médias . Il faut convaincre, amener au débat, mais il reste beaucoup à faire. »
À retenir
Un maximum d’acteurs impliqués, pas d’interférence des pouvoirs publics et une stabilité financière, voilà la recette d’un conseil d’autorégulation légitime, selon Jean-Jacques Jespers. En Belgique par exemple, où un tel organe existe depuis 10 ans, le financement est assuré de manière égalitaire, d’une part par les médias, et d’autre part via l’Association des Journalistes Professionnels (AJP). De plus, le CDJ reçoit aussi une dotation de l’État, dont l’AJP garantit l’inconditionnalité.
Pour ce qui est du contenu, la plupart des plaintes fondées auprès des conseils de déontologie journalistique concernent le factuel et la véracité des faits. Ce qui n’a pas manqué de susciter des réactions dans le public, certains questionnant la légitimité de ces conseils à établir une vérité. Pour les intervenants, c’est simple : la déontologie se définit hors des tribunaux, et donc au sein de la profession.
Florent Schauss (IHECS)
Samia El Achraki (ISIC)
18 Mar 2022 | En direct, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’atelier « Media Loves Tech : découvrez les start-ups qui veulent changer le journalisme en Tunisie »
Animé par Benoît Faedo et Cyrine Ben Saad, responsable de la Deutsche Welle Akademie et du projet Media Loves Tech, avec les équipes d’Ast’Lab, Blue TN, Econo.brief, FLEN et Malek Khadhraoui, fondateur d’Inkyfada et directeur exécutif de l’ONG Al Khatt (Tunisie)
Les enjeux
Jeudi après-midi, les participants tunisiens du projet Media Loves Tech, organisé par la Deutsche Welle Akademie, ont présenté leurs médias ou outils innovants destinés aux journalistes. Ce projet a été mené en partenariat avec l’ONG Al Khatt qui lutte pour la liberté de la presse en Tunisie.
Ce qu’ils ont dit
Malek Khadhraoui : « La Tunisie manque de nouveaux projets innovants. Media Loves Tech a été l’occasion de mettre nos compétences aux services de start-ups. »
Makrem Dhifalli, chef du projet FLEN : « FLEN est une base de données intelligente pour les journalistes qui trient et regroupent des données juridiques, économiques, scientifiques ainsi que des cartes. »
Yémen Saibi, fondateur d’Econo.brief : « Econo.brief est une newsletter pour les professionnels de la finance qui résume l’actualité de la place de Tunis. Nous voulions créer une parenthèse face à l’avalanche d’informations. »
Mayssa Sandli, fondatrice de Blue TN : « J’ai créé un média 100 % écologique et digital pour sensibiliser la population tunisienne à l’environnement. Nous utilisons des techniques de communication pour créer des contenus créatifs qui interpellent. »
Najla Trabelsi and Nouha Ben Lahbib fondatrices d’AST’Lab : « L’Art science technology lab propose de l’aide aux journalistes, professionnels de la communication et artistes pour produire des contenus créatifs et digitaux comme par exemple des vidéos en 360°. »
À retenir
Media Loves Tech encourage le développement numérique des journalistes. Les participants à ce projet ont partagé leur avis sur cette expérience. En résumé : beaucoup de challenges, des deadlines à respecter mais à la fin des idées plus claires.
17 Mar 2022 | Les résumés, Tunis 2022
Pictures by Lucas Turci/EPJT
Day one of the International Journalism Festival and the discussion took us to the fast spread of fake news as a result, in part, of the Covid-19 pandemic – vaccinating against fake news was at the heart of the debate.
Life is slowly returning to normal following the Covid-19 epidemic. But the evidence is clear, fake news has had a major impact on the debates and on the daily lives of many. Many people have also been concerned about the arrival and spread of fake news. Some journalists have tried to focus on the solutions and the right information they could bring to the population.
In Africa the primary media output is radio, with social media also expanding quickly but equally containing a lot of fake news. The goal of the journalist here was to stay connected and in contact with the public. For example, Miss Godignon from the Hirondelle foundation, noted that a telephone information service proved extremely successful: “We received about 1 million calls per day about medical questions n 4 months”.
Indeed, people want to get informed, and they get so much false news that the real information often is drowned between the fake and propaganda. For Alhassane Abou-Mahamane the key of working in an unstable zone is “balance and editing neutrality”.
“Telling the Nigerians to not go to the mosque is complicated, we have to explain to them that it is a real illness and not only a disease for white people.”
To rid ourselves of fake news, and rumours, it is important to speak the dialect of each region and to be in contact with them: “We have around 52 radio stations and journalists in disguise in the complicated zones.”
In Tunisia, the observation was clear, the absence of fact-checking platforms was noticeable. That’s why the website is here, to ensure independence. For the journalist Ayoub Dhifallah the objective is to remain neutral. Especially after the events that occurred in the Tunisian parliament on 25th July, getting the sources and the right information became more complex.
The work of these journalists and foundations is to make the reception of the news easier for everyone and to ensure objectivity, neutrality, and sharing of knowledge to the population.
Written by Myriam Karrout (IHECS)
17 Mar 2022 | Les résumés, Tunis 2022, Uncategorized
Retrouvez l’essentiel de l’événement « quel impact pour le journalisme collaboratif?».
Photo : Laura Dubois/IHECS
Animé par Sana SBOUAI, journaliste Afrique du Nord pour l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, avec Firas AL TAWEEL, journaliste d’investigation et formateur pour Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) ; Maxime DOMEGNI, éditeur francophone du Global Investigative Journalism Network (GIJN) ; Ignace SOSSOU, journaliste et chargé de communication de la Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme en Afrique de l’Ouest (CENOZO)
Les enjeux
Le journalisme collaboratif, c’est le journalisme d’investigation qui, porté par le partage d’information entre professionnels, traverse nos frontières locales voire internationales. La concurrence des médias laisse place à la collaboration. Dans un climat où la démocratie se montre de plus en plus fragile, le journalisme collaboratif peut renforcer l’indépendance de la profession.
Ce qu’ils ont dit
Maxime Domegni: « Dans le journalisme d’investigation, il n’y a pas de place pour la concurrence, mais plutôt pour la collaboration. »
« Certaines enquêtes n’aboutissent pas forcément à des changements politiques d’envergure, mais toutes ont un impact sur l’opinion publique qui comprend qu’on lui cache quelque chose. Cela aboutit à un changement de mentalité. »
» Le journaliste n’a pas de responsabilité sur ce qui se passe après l’enquête. Sa responsabilité, c’est de révéler l’information cachée ».
Ignace Sossou: « Le plus gros impact qu’une investigation peut avoir, c’est de sortir les citoyens de l’ignorance.»
« Pour bien collaborer, il faut s’entourer de journalistes qui partagent les mêmes valeurs. »
Firas Al Taweel: « Il faut accumuler l’information pour qu’elle ait un impact sur demain. »
À retenir
Le journalisme collaboratif a des impacts tant sur la démocratie que sur les mentalités. Les grandes enquêtes auxquelles il a permis d’aboutir ont suscité des vocations dans la profession.
17 Mar 2022 | Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « journalisme d’investigation : comment gérer le stress, les pressions et les risques ? »
Photo : Irène Prigent/EPJT
Animé par Philippe Couve, fondateur de Samsa.fr et Samsa Africa (France), l’atelier a réuni Rahma Behi, journaliste d’investigation pour Al Qatiba (Tunisie) ; Lyas Hallas, journaliste d’investigation (Algérie) ; Ariane Lavrilleux, journaliste indépendante, spécialiste du Moyen-Orient (France) ; Rana Sabbagh, rédactrice en chef Moyen-Orient et Afrique du Nord pour l’OCCRP (Jordanie).
Les enjeux
Le journalisme d’investigation implique un engagement particulier et les journalistes enquêteurs peuvent être confrontés au stress et au sentiment de solitude. Victimes aussi parfois de pressions et sous la menace d’emprisonnement, le quotidien des journalistes d’investigation est fait d’une multitude de risques. Ils apprennent à s’y préparer davantage pour mieux les gérer et se protéger physiquement et moralement.
Ce qu’ils ont dit
Ariane Lavrilleux : « Avec Disclose, on a enquêté sur une opération militaire française en Egypte. Révéler des informations militaires peut être puni d’emprisonnement. J’ai quitté l’Égypte avant la publication de cette enquête. C’était trop dangereux pour moi ou mes proches de rester correspondante là-bas. Je le savais depuis le début. C’était moi ou le sujet. »
« Après l’enquête, j’ai eu besoin de faire une pause quelques semaines. Je n’ai pas repris les enquêtes tout de suite pour préserver ma santé. Il faut penser à autre chose que la mort, la torture etc…il y a une sorte de désintox à mener après avoir travaillé sur un sujet sensible. »
Rahma Behi : « Il y a toujours des risques ou des menaces quand on travaille sur des personnes puissantes. Il faut être prêt à tout pour pouvoir les gérer. »
« Quand on doit aller dans une zone à risque pour une enquête, on part souvent à deux. Ou bien on partage notre position à quelqu’un… »
Lyas Hallas : « Travailler en réseau (réseaux internationaux ou d’un même pays) nous permet d’économiser du temps et de l’argent. Enquêter sur un sujet dans une région que l’on ne connait pas entraîne souvent un résultat aléatoire, d’où l’importance de bien s’entourer. »
Rana Sabbagh : « Il ne faut pas hésiter à aller voir son patron. On n’est pas dieu, on ne peut pas tout faire. Il faut absolument prendre des pauses. Il faut aussi que les rédacteurs en chef prennent ça en considération, qu’ils laissent leurs journalistes couper pour qu’ils puissent s’extraire de situations épuisantes. »
À retenir
Le travail d’investigation est éprouvant. Lorsqu’ils enquêtent sur des sujets sensibles, les journalistes s’exposent à des risques physiques et exposent également leurs proches et leur santé mentale. Pourtant, informer reste une absolue nécessité, impliquant un certains sens du sacrifice. Travailler en réseau ou en équipe facilite le travail et permet de décharger en partie le journaliste du poids de l’enquête.
17 Mar 2022 | Les articles, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Focus Liban : l’état du journalisme et des médias »
Animé par Jad Shahrour, chargé de communication pour Sheyes avec Caroline Hayek, grand reporter pour L’Orient-le Jour (Prix Albert Londres 2021), Alia Ibrahim, co-fondatrice de CEO et de Daraj.com, et Marc Saikali, PDG d’Ici Beyrouth.
Les enjeux
Entre 2020 et 2021, le Liban a dégringolé de cinq places dans le classement annuel de Reporters sans frontière. Derrière la crise socio-économique qui fissure le pays, se cache une deuxième guerre : celle des médias pour leur liberté. Un climat de tension qui a atteint son paroxysme en février 2021, avec l’assassinat de l’éditeur et commentateur politique, Lokam Slim. Dans de telles conditions, et alors que la jeunesse libanaise fuit le pays vers d’autres horizons, comment les médias libanais parviennent-ils à maintenir leur indépendance et se renouveler ?
Ce qu’ils ont dit
Caroline Hayek : « Ce qui est important pour nous, c’est de modifier notre image d’élite de droite chrétienne. On s’est engouffré dans d’autres brèches pour bousculer notre lectorat. Notre enquête sur la pédophilie n’aurait pas été possible il y a quelques années, par crainte des critiques. Mais aujourd’hui, on arrive à capter de nouveaux lecteurs. »
« L’Orient-le Jour a su se remettre en question et penser contre lui-même pour attirer les jeunes. Ce qui est très important pour nous, c’est cette indépendance, rompre avec cette image d’un média élitiste et recomposer toute notre équipe. »
Alia Ibrahim : « Nous faisons confiance aux lecteurs. Ils savent la limite entre l’opinion et l’enquête. La distinction entre le journalisme et l’activisme est très importante pour la crédibilité de l’organe de presse. Elle touche à la confiance des publics dans les médias. »
Marc Saikali : « Aujourd’hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais on a la prétention de penser que dans un océan d’informations partielles et de fake news, quand vous êtes un média crédible, les jeunes font le tri. »
« La presse libanaise est parfois partisane mais elle reste libre (…) La guerre en Ukraine montre que la presse ne peut avoir une ligne éditoriale objective comme le souhaiteraient les médias anglo-saxons. Cette ligne éditoriale n’est pas objective, mais elle est honnête, et n’est pas financée par des politiques, ni de grosses ONG internationales. »
À retenir
La question de la déontologie journalistique se pose tout particulièrement au Liban, marqué par une importante crise économique et sociale. Les reportages d’investigation menés par les médias libanais sont plébiscités, de même que les nouveaux formats journalistiques permettent d’attirer le jeune lectorat. Si une presse indépendante est possible au Liban, les journalistes se heurtent à des problèmes budgétaires au sein de leur rédaction et souffrent du départ de la jeunesse pour renouveler les contenus.
Clara Jaeger et Irène Prigent (EPJT)
17 Mar 2022 | En direct, Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Les journalistes face au cyberharcèlement : Quels outils ? Quelles stratégies ? ».
Photo : Lamisse Oujari /ISIC
Animé par Tatiana Mossot, journaliste et fondatrice de MaMaProject (Côte d’Ivoire) et Elodie Vialle, consultante pour PEN America (France).
Les enjeux
En 2020, l’Unesco a publié une enquête internationale à propos des violences en ligne contre les femmes journalistes. Les résultats indiquent que 73% d’entre elles y ont fait face dans l’exercice de leur métier. Pour 20% de celles-ci, il y a une connexion entre les violences en ligne et hors ligne. Le cyberharcèlement a donc un impact dans l’espace numérique, mais également dans la vie réelle.
Ce qu’elles ont dit
Elodie Vialle : « C’est un risque professionnel inhérent à la pratique journalistique et donc il y a une obligation pour les rédactions d’y faire quelque chose. (…) On leur demande de reconnaître ce qu’il se passe, d’évaluer le problème (…) et puis ensuite de discuter du protocole à suivre. »
Tatiana Mossot : « C’est un défi de réussir à garder des femmes dans la profession quand elles sont sujettes à des pressions aussi fortes. (…) Réussir à surmonter des pressions, des menaces, déjà pour les journalistes masculins, c’est difficile. Et chez une femme, la pression sociale va s’ajouter et elle va quitter le métier. »
« Ne pas prendre en compte ces menaces potentielles de cybersécurité et de harcèlement, ça a un impact sur la production. A partir du moment où vous avez un, deux, trois journalistes harcelés dans votre rédaction, ce sont des journalistes qui ne peuvent pas être productifs. (…) Ça touche donc à l’économie du média. S’il faut aujourd’hui convaincre les médias que c’est une question qu’ils doivent intégrer pleinement dans leur fonctionnement, c’est en leur parlant de leur portefeuille. »
À retenir
Le cyberharcèlement a un impact conséquent sur les femmes journalistes, les menant parfois à s’autocensurer et à disparaître de l’espace numérique. Pour contrer cette tendance, des associations s’organisent pour soutenir et accompagner les journalistes victimes de violences en ligne. PEN America a d’ailleurs mis en place un manuel de défense contre le cyberharcèlement, traduit en plusieurs langues, dont l’espagnol et le français. Différentes ressources sont actuellement disponibles sur https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/fr/ pour faire face au cyberharcèlement, pour soutenir une personne victime et pour s’informer sur les bonnes pratiques à avoir au sein des rédactions.
Shirine Ghaemmaghami (IHECS)
17 Mar 2022 | Les résumés, Tunis 2022
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Quel vaccin contre les Fake News? ».
Animé par Sandra FONTAINE, chargée de programme à la Fondation Hirondelle (France), avec Alhassane ABDOU-MAHAMANE, rédacteur en chef du Studio Kalangou (Niger) ; Julie GODIGNON, experte programme Covid-19 de la Fondation Hirondelle (France) ; Ayoub DFIHALLAH, journaliste de TuniFact (Tunisie)
Les enjeux
L’information est devenue le reflet de notre société : plus rapide, plus captivante, elle s’aligne sur l’urgence de notre impatience. Internet et les médias sociaux peuvent parfois laisser la place aux fake news : cette information non vérifiée qui intervient inévitablement dans les périodes conjointes à l’incertitude. La crise du COVID-19 n’a pas été épargnée par cette nouvelle culture de la désinformation. La Fondation Hirondelle nous rappelle qu’une bonne information commence avant tout avec un droit à l’information.
Ce qu’ils ont dit
Sandra Fontaine : « Le droit à l’information est l’une des bases pour lutter contre la désinformation. Au moindre changement politique, à la moindre instabilité, ce droit peut être fragilisé.«
« L’information est le reflet de notre société : on est face à une libéralisation de la parole moins cadrée, moins modérée.«
« Une Fake News est 70% plus susceptible d’être retweetée. »
Alhassane ABDOUMAHAMANE: « Au Niger, l’Internet s’est développé et on ne s’attendait pas à une telle flambée de la désinformation concernant la Covid-19. Face à elle, il fallait expliquer à la population que ce n’était pas qu’une simple maladie de blanc »
« Utiliser les langues minoritaires pour communiquer, c’est permettre le droit à l’information et ce droit est fondamental pour lutter contre la désinformation.»
Julie GODIGNON: « Nous sommes dans une culture du fast food : on est face à une information de plus en plus courte et de plus en plus sensationnelle. C’est la porte ouverte à la désinformation.»
À retenir
Il n’y a pas de remède miracle contre les fake news. Lutter contre la désinformation commence par un journalisme rigoureux, une bonne vérification des faits, une neutralité bien maniée et le respect du droit à l’information.
17 Mar 2022 | Les articles, Les résumés, Tunis 2022
De gauche à droite Taoufik MJAIED, Jérôme BOUVIER, Thierry VALLAT, Francisco ACOSTA, Amira MOHAMED
Photo : Lucas Turci/EPJT
Les Assises internationales du journalisme de Tunis promettent dès leur ouverture une programmation riche et fructueuse. A l’ordre du jour de cet événement : cinq focus pays, des débats, des ateliers, des concerts et des expositions, rassemblés autour du thème « l’urgence du journalisme ».
Future capitale du journalisme dans la Méditerranée – en tout cas quelques-uns l’espèrent –, Tunis accueille sa 2e édition des Assises du journalisme. Les travaux ont démarré ce jeudi 17 mars à la Cité de la culture et s’étendront jusqu’au 19 mars. Créé par l’association Journalisme et Citoyenneté, cet événement international est, selon son président Jérôme Bouvier, le fruit d’une aventure collective. Un programme soutenu par l’Union européenne, en partenariat avec l’ambassade de France, le CFI et d’autres médias internationaux.
Au moment où l’étau se resserre sur les journalistes un peu partout dans le monde, des professionnels des médias, des chercheurs, des institutionnels et des étudiants se réunissent pendant trois jours, pour penser à voix haute à la situation de cette profession dans la Méditerranée, en particulier, et dans le monde puisque les défis qui se présentent sont universels. Un panel pour rendre au journalisme ses lettres de noblesse, d’où le choix de la thématique « l’urgence du journalisme ».
La question de l’indépendance de la presse
Les intervenants ont insisté sur l’importance du journalisme et son utilité, plus importantes que jamais vu le contexte actuel marqué par la double crise sanitaire et sécuritaire. Dans la même veine, le chef de délégation adjoint de l’Union européenne en Tunisie, Francisco Acosta, a exprimé son soutien – et celui de l’UE – à l’indépendance du journalisme. Une « profession fabuleuse », à ses yeux. Il a par ailleurs mis en avant « l’utilité démocratique » du métier du journaliste, qui facilite l’accès du citoyen à l’information.
Sans surprise, le conflit russo-ukrainien, qui domine l’actualité internationale, s’est invité à la cérémonie d’inauguration des Assises. Le PDG de CFI n’a pas manqué de rappeler la nécessité de contre-carrer les fake news et de vérifier les sources, en faisant référence au traitement médiatique du conflit en Ukraine.
Si la galanterie n’a pas été respectée, la dernière intervention d’Amira Mohammed n’a pas été moins intéressante. Poignante, elle a impressionné l’auditoire. La vice-présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) s’est alarmée de la situation de la liberté d’expression en Tunisie en particulier, pays hôte. Une liberté qui se trouve menacée, selon elle.
La syndicaliste reproche le déclin de la liberté d’expression dans le journalisme aux autorités tunisiennes et pointe du doigt les deux gouvernements précédents et le gouvernement actuel. Amira Mohammed estime par ailleurs que le président de la République participe à la précarité du journalisme indépendant.
On peut se demander si s’interroger sur la question de la liberté d’expression, en dénonçant haut et fort les « responsables » ne serait pas en soi une forme de liberté. Une question à laquelle les participants aux Assises du journalisme pourraient répondre éventuellement, au cours des débats, des « focus » pays et des ateliers programmés tout au long de ces trois jours.
Adnane BOULAHIA de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (Rabat)
17 Mar 2022 | Les résumés, Tunis 2022
Photo : Chloé Plisson/EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Le journalisme face à l’urgence sanitaire : quel dialogue entre journalistes et scientifiques ? »
Animé par Nouha Belaid, fondatrice du Réseau arabe du journalisme scientifique (Tunisie), avec Ruba Anabtawi, journaliste d’investigation et consultante pour l’Afaq environnemental (Palestine) et Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis (Tunisie).
Les enjeux
Alors que le monde est bouleversé par l’épidémie de Covid-19 depuis deux ans, Ruba Anabtawi, journaliste d’investigation en Palestine et Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis ont confronté leurs expériences sur le traitement journalistique de la pandémie et leur vision du journalisme scientifique.
Ce qu’ils ont dit
Ruba Anabtawi : « Avant la pandémie, l’intérêt des Palestiniens pour l’environnement était très faible. La crise sanitaire a été une aubaine pour mettre en avant le journalisme scientifique. »
« Dans mon pays, il est très difficile d’avoir accès aux informations. Pendant la pandémie, les autorités locales diffusaient des messages pour dire que tout était sous contrôle. Après la publication de plusieurs de mes enquêtes, une circulaire interne a ordonné aux fonctionnaires de ne plus collaborer avec moi. »
« Pour être un bon journaliste scientifique, il faut avoir les connaissances, la passion mais aussi toujours relier les informations à la réalité des gens. Lorsque j’évoque le changement climatique, je parle par exemple de l’impact du recul de la saison des pluies sur le travail d’agriculteurs en Palestine. »
Hechmi Louzir : « Il a fallu attendre la crise pour que les journalistes s’intéressent aux sciences. Mais cette couverture s’est accompagnée de diffusion de fausses informations. Les journalistes doivent être mieux formés sur ces questions. »
« Pour une meilleure collaboration entre les chercheurs et les journalistes, les efforts sont à faire dans les deux sens. Les scientifiques doivent être plus à l’écoute de la société et doivent transmettre plus d’informations à la population. De leur côté, les journalistes doivent être plus impliqués dans les sujets scientifiques. »
À retenir
Le journalisme scientifique a de beaux jours devant lui. La pandémie a permis son essor et a ouvert la réflexion sur une meilleure collaboration entre chercheurs et journalistes.
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Météo et Climat : Les présentateurs météo en première ligne »,en partenariat avec Radio France.
(Photo : Irène Prigent/EPJT)
Animé par Laetitia Gayet, le débat a réuni Evelyne Dhéliat, présentatrice météo sur TF1 ; Ilyes Ghouil, créateur de la Météo Franc-Comtoise ; Dominique Marbouty, vice-président de Météo et Climat ; Marie-Pierre Planchon, productrice et présentatrice de la météo sur France Inter ; Laurent Romejko, présentateur météo sur France 3 ; David Salas Y Melia, chercheur chez Météo France.
Les enjeux
À mesure que les prévisions se précisent, les bulletins météo ont gagné en crédibilité. Avec le dérèglement climatique, il n’est plus seulement question de pluie et de beau temps mais de sensibiliser à l’urgence climatique, sans céder à l’alarmisme. En parallèle des bulletins télévisés et radiophoniques, des initiatives émergent sur les réseaux sociaux à l’échelle locale et permettent de toucher la jeune génération. En même temps, les réseaux sociaux sont aussi utilisés comme des systèmes d’observation des intempéries.
Ce qu’ils ont dit
Evelyne Dhéliat : « L’information, c’est du spectacle. Mais la priorité reste d’informer. Il faut qu’on comprenne du premier coup d’œil ce qui se passe. »
« On a un rôle compliqué car on a une responsabilité économique. J’ai reçu une fois un appel d’un hôtelier furieux parce que ses réservations avaient été annulées après un bulletin météo…»
Dominique Marbouty : « Aujourd’hui, la température moyenne du globe a augmenté d’un degré Celsius. Avec les feux de forêt en Grèce, aux États-Unis, en Australie, tout le monde en voit déjà les effets. Et on imagine bien les conséquences d’un réchauffement de deux degrés Celsius. »
Marie-Pierre Planchon : « En une minute, c’est très difficile d’arriver à satisfaire tout le monde, de créer du lien en restant crédible. »
« Je fais très attention au vocabulaire que j’emploie, à dire le terme le plus exacte. Il ne faut pas dire « il va faire beau ! « , mais « il va faire chaud ! » Pour les touristes, un temps ensoleillé est positif, mais pour les agriculteurs, se sera peut-être catastrophique…»
Laurent Romejko : « J’aime bien créer un véritable récit pour présenter la météo. Il y a une certaine poésie. On parle de la France, des régions, des petits coins que l’on évoque pas forcément dans les JT. »
« On a l’impression que les exceptions commencent à devenir la norme. On se rend compte que les phénomènes de tempête reviennent de plus en plus régulièrement, de même que les normales de saison augmentent. »
« Il faut être extrêmement prudent et avoir du recul. On ne peut pas tout relier au changement climatique. »
« Notre rôle n’est pas d’apprécier le temps qu’il va faire, mais de dire le temps qu’il va faire. »
Ilyes Ghouil : « Sur les réseaux sociaux, tout passe par l’écrit et le visuel. On peut se permettre de détailler, d’apporter des précisions. »
« J’ai remarqué un réel emballement au niveau des intempéries en Franche-Comte à partir de 2017. J’ai aussi constaté une certaine disparition du froid. »
« Sensibiliser le jeune public dès la primaire est important. Les enfants ramènent pleins d’informations à leurs parents. »
David Salas Y Melia : « La météo a changé, le temps qu’il fait a changé. Si on regarde les bulletins des années 1990, on ne prévoit plus les mêmes choses. »
« Parmi les cyclones, on observe une proportion plus importante de cyclones intenses. Les pluies extrêmes montent aussi en intensité, y compris dans le Sud-Est de la France. On estime que l’intensité maximale des précipitations a augmenté d’une vingtaine de pourcentages par rapport aux années 1960. »
À Retenir
Les bulletins météos sont les reflets du dérèglement climatique. Si les manières de présenter la météo varient selon les temps d’antenne et les supports (télévision, radio, réseaux sociaux), les journalistes ont pris conscience de l’importance d’informer les citoyens sur le climat. Dans le vocabulaire, il n’est plus question d’apprécier la pluie ou le beau temps, mais d’exposer les faits. Une dimension plus pédagogique des bulletins a vu le jour ces dernières années. Évoquer les catastrophe naturelles, expliquer la formation des intempéries, parler de la qualité de l’air ou des stocks d’eau douce permettent de prendre de la hauteur sur les simples prévisions.
Irène Prigent
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Manuela Thonnel /EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Solidarité Afghanistan : les Assises donnent la parole aux journalistes afghans exilés »
Animé par Catherine MONET, rédactrice en chef à Reporters sans frontières avec Akbar Khan ARYOBWAL, fixeur et interprète des médias français ; Darline COTHIERE, directrice de la Maison des journalistes ; Ricardo GUTIERREZ, président de la Fédération européenne des journalistes (FEJ) ; Mariam MANA, journaliste afghane réfugiée ; Najiba NOORI, journaliste afghane réfugiée ; Rateb NOORI, directeur vidéo du bureau de l’AFP à Kaboul ; Solène CHALVON, grand reporter, correspondante en Afghanistan ; Lotfullah NAJAFIZADA, directeur de Tolo News.
LES ENJEUX
Depuis le 15 août et la chute de Kaboul, de nombreux journalistes ont quitté le pays et ont rejoint en France les Afghans déjà réfugiés. Il reste cependant des centaines de journalistes inscrits sur des listes d’évacuation.
CE QU’ILS ONT DIT
Akbar Khan ARYOBWAL : « Quand j’ai appris ce qui se passait à Kaboul, je n’ai pas pleuré dans un coin. Je suis parti direct à l’aéroport pour essayer de faire quelque chose. Il faut donner de l’espoir aux gens qui quittent le pays. Il faut leur montrer les bons chemins. »
Darline COTHIERE : « Depuis cette année, plus de 400 journalistes ont été accueillis à la Maison des journalistes, venus de 70 pays dont l’Afghanistan. Ils arrivent en catastrophe pour fuir la répression et parce que leur vie est en danger. »
Ricardo GUTIERREZ : « Des milliers de journalistes afghans sont toujours dans leur pays. Pour ceux présents sur liste d’attente, il y a des États qui ont des plans avec des corridors humanitaires comme par exemple l’Allemagne qui réalise toujours des évacuations. »
Mariam MANA : « Pour les réfugiés il y a deux types d’exil. Celui où vous n’êtes plus dans votre pays physiquement et l’autre, c’est l’exil de la langue. C’est ce dernier qui a été le plus dur pour moi. Pour les écrivains et les journalistes, la langue est notre outil de travail, nous gagnons notre vie grâce à elle. »
Najiba NOORI : « Avant le 15 août, on a vu se développer les assassinats ciblés contre les journalistes, le nombre de violences croître, mais on continuait de travailler. Mais quand les talibans ont marché devant chez moi, j’ai décidé de partir. »
Rateb NOORI : « Avec mon organisation, et toute la communauté, nous essayons de poursuivre le travail, de continuer à couvrir ce qui se passe. »
Solène CHALVON : « Il y a un vrai besoin de se coordonner. Les gens de l’ambassade de France sont des gens que l’on connaît depuis des années car il y a une communauté française très restreinte. »
Lotfullah NAJAFIZADA : « La différence entre l’avant, le pendant et l’après 15 août, c’est la même qu’entre le jour et la nuit. Avec une privation de liberté, aucun accès à l’information ni critique du gouvernement et les talibans qui demandent à être consultés au préalable avant toute diffusion. »
À RETENIR
Il y a beaucoup d’axes d’aide aujourd’hui pour les journalistes afghans. Il faut penser à ceux qui sont arrivés, mais aussi à ceux qui restent. Il faut maintenir la pression sur les chancelleries occidentales et donner des fonds aux organismes qui peuvent aider comme la Maison des journalistes, la Fédération européenne des journalistes ou Reporters sans frontières. Ils ont aussi un besoin de transfert de compétences, d’enseignement ou de matériel.
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Élea N’Guyen Van-Ky / EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Le débat : Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France / Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT ».
Animé par Dorothée Moisan, journaliste, avec Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France et Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Les enjeux
Vendredi après-midi, Jean-François Julliard, ancien journaliste et militant écologiste ainsi que Philippe Martinez, syndicaliste, se sont retrouvés pour un débat : Conjuguer fin de mois et fin du monde. En mai 2020, plusieurs syndicats et militants dont la CGT et Greenpeace France avaient sorti ensemble le plan « Plus jamais ça ! » Il proposait 34 mesures pour sortir de la crise.
Ce qu’ils ont dit
Philippe Martinez : « La CGT, contrairement à sa réputation, s’inquiète des questions du climat depuis une quinzaine d’années, en conjuguant questions sociales et environnementales. Nous nous interrogeons sur comment agir pour la préservation de la planète, sans perdre son boulot. »
« Nous réfléchissons à une autre forme de croissance. C’est pas « on abandonne toutes les industries et l’ancien monde ». Nous réfléchissons ensemble. Et les salariés ont plein d’idées. »
« [Avec Greenpeace], on essaye de nous éloigner mais on discute pour savoir ce qui nous éloigne et surtout ce qui nous rapproche. »
« Ce sur quoi on est pas d’accord, c’est le nucléaire. Nous on est pour, on pense que c’est une solution. Ça ne nous empêche pas de réfléchir sur la question des déchets, de l’extraction pour alimenter les centrales ou du refroidissement. »
Jean-François Julliard : « On arrive à dépasser les clichés qu’on peut avoir les uns envers les autres. On a des intérêts communs. »
« Il y a des sujets sur lesquels on n’est pas d’accord. On a beaucoup travaillé sur l’impact du secteur aérien ou automobile sur le climat. On n’a pas la même vision des réponses à apporter. Ça ne bloque pas la discussion. On a à cœur d’essayer de trouver des solutions. Sur la question de l’aérien, je suis enthousiasme sur comment on peut transformer le secteur afin de réinventer l’aéronautique de demain et permettre de faire vivre les salariés du secteur. »
Au sujet de la responsabilité des journalistes : « Il y a beaucoup de journalistes qui voudraient traiter des questions environnementales mais qui ont du mal à trouver des postes. Travailler dans la presse sur des sujets environnementaux, c’est difficile. »
À retenir
La CGT et Greenpeace font de l’environnement et des droits sociaux un combat commun. Le syndicat et l’ONG travaillent ensemble pour proposer des solutions en matière d’emploi et d’écologie. Le nucléaire reste cependant un de leur principaux désaccords.
Héloïse Weisz
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
(Photo : Manuela Thonnel/EPJT)
Retrouvez l’essentiel du débat entre Franck Annese et Fabrice Arfi.
Animé par Jérôme Bouvier, le débat a réuni Fabrice Arfi, co-responsable du pôle enquête chez Médiapart, et Franck Annese, P.D-G du groupe So Press.
Les enjeux
L’un multiplie les titres de magazines et les reportages, l’autre prospère en ligne et s’illustre par ses enquêtes. Tous deux sont à la recherche du meilleur modèle médiatique pour transmettre à leurs lecteurs une information indépendante, avec un impact environnemental moindre. Fabrice Arfi et Franck Annese exposent les choix qu’ont fait leur média pour concilier le fond et la forme.
Ce qu’ils ont dit
Fabrice Arfi : « En acier, en papier, en bambou, ce qui compte ce n’est pas l’assiette mais ce qu’il y a dedans. Internet a ses propriétés, mais ce qui compte c’est de transmettre une information utile aux citoyens. La question du médium n’est pas la plus importante. »
« La Santé publique est devenue pour nous un problème centrale, de sorte que l’intégralité de la rédaction s’est réorganisée autour de la pandémie. Comme toute crise majeure, la pandémie a redéfini la vérité factuelle. On a bien vu l’effacement de la frontière entre le vrai et le faux. Le journalisme a été requis pour ne pas succomber à des émotions tribales. »
« Dans l’ancien monde, on disait qu’une bonne rédaction était une rédaction vide, parce que les journalistes étaient sur le terrain en train d’enquêter. Mais quand les journalistes se retrouvent, c’est dans ces interstices là que naissent les meilleurs moments. On est toujours plus fort quand on fait une enquête à plusieurs, je crois à l’intelligence collective. Avec le distanciel, de fait, les gens reviennent moins dans les rédactions. Si les gens se sentent mieux chez eux pour travailler et qu’ils ont de bonnes idées, on ne va pas les forcer à venir. »
« Quand on est un citoyen consommateur d’information, on n’a pas toujours conscience de l’impact qu’ a le modèle économique sur la production. La gratuité a aussi des conséquences. On est plus dans une logique de public, on est dans une logique d’audimat. On va faire davantage de papiers, plus courts. On va faire plus de clics et on a moins de temps pour faire des papiers longs et sortir du blabla. Pour beaucoup de gens l’information est utile, mais on a du mal à se dire qu’il faut la payer. »
« Nous n’avons aucune étude sur le succès d’un article. Ce qu’on sait au regard de ce qui se dit sur les forums, c’est que l’écologie est un sujet majeur dans les préoccupations de ceux qui nous lisent. »
Franck Annese : « Les habitudes de télétravail sont rapidement prises et il faut essayer de raisonner ces habitudes qui sont assez peu favorables à un travail journalistique. Il n’y a jamais eu de présence obligatoire chez So press. Puis la présence a été interdite. Les gens venaient beaucoup et maintenant ils viennent moins. »
« Je ne crois pas plus au papier qu’au digital. Ce que je sais, c’est que quand on n’a pas beaucoup d’argent, c’est plus facile de lancer un magazine papier. On a une connaissance du kiosque, qui fait qu’aujourd hui on prend moins de risques avec le papier. Exister dans l’océan Google, c’est compliqué, il faut savoir se distinguer. La différence entre les supports n’est pas très flagrante. Ce qui est important, c’est que les gens payent pour de l’information, que ce soit en digital ou en papier. »
« Si on n’avait pas lancé So good, on serait beaucoup moins vertueux sur le plan environnemental aujourd’hui qu’on ne l’est. La colle, le papier, le blister, on a innové avec plus ou moins de succès en faisant une partie des impressions sans utiliser d’emballage. Il y a des magazines qui arrivent défectueux, une bonne partie des gens qui signalent le problème ne souhaitent pas se faire renvoyer le numéro. Il y a trois ans, on n’aurait eu que des insultes. On sent que les mentalités évoluent peu à peu. »
À Retenir
Papier ou web, l’information se monnaye. C’est du moins le point de vue partagé par Franck Annese et Fabrice Arfi. Pour proposer des contenus de qualité et regagner la confiance des lecteurs, les entreprises de presse doivent conquérir une forme d’indépendance économique qui passe par le financement des citoyens.
Manuela Thonnel
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Quatre initiatives en faveur de la diversité dans les médias ».
Animé par Anne Bocandé, journaliste indépendante et cheffe de projet incubation médias au Medialab 93, avec Maxime Daridan, BFM TV, L’annuaire vu des quartiers ; Marc Epstein, président de La chance, pour la diversité dans les médias ; Ryad Maouche, rédacteur en chef du média en ligne Frictions.co ; Claudia Rahola, responsable du comité « diversité » de l’AFP.
Les enjeux
Les gilets jaunes, le mouvement Black Lives Matter, l’élection de Donald Trump, le Brexit… Ces dernières années, de nombreux événements de grande ampleur sont venus surprendre les médias. Ces pressions populaires interrogent sur le traitement de l’information par les journalistes, leurs biais mais aussi leur représentativité. Comment les médias peuvent-ils sortir de cette ornière et afficher un visage plus pluraliste ?
Ce qu’ils ont dit
Maxime Daridan : « L’annuaire des quartiers regroupe plus de 1500 Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). C’est un outil de facilitation entre habitants de quartiers populaires, dans le modèle du manuel des expertes. Il permet aux journalistes de mieux comprendre les sujets liés aux quartiers et de générer de nouvelles idées. Le succès, on l’aura quand les marronniers seront traités avec des publics bien plus diversifiés dans ces quartiers défavorisés. »
Marc Epstein : « Le chiffre dont on est le plus fier, c’est celui des anciens de notre formation La chance qui deviennent journalistes : 75 %. »
« C’est très important que des jeunes journalistes soient issus de milieux divers pour enrichir la conversation le matin en conférence de rédaction, quand on discute du traitement des angles, des sources… Représenter la diversité de la population, c’est notre travail. »
Ryad Maouche : « Pour Frictions, nous sommes partis d’un constat assez simple : les sujets de conversation sont devenus mondiaux, dépassent les frontières, mais leur perception change selon le lieu où l’on vit. On veut documenter ces différentes perception. C’est un travail de PQR à l’échelle mondiale. »
Claudia Rahola : « On se rend compte que le profil des journalistes est un peu le même. Nous avons monté le comité « diversité » pour diversifier les profils. »
« Aller plus loin, ça veut dire aussi faire beaucoup plus de mentoring, aller à la recherche de gens qui ne sont pas dans les écoles, qui ont eu une expérience professionnelle avant qui n’a rien à voir avec le journalisme. »
À retenir
Le baromètre du CSA mesure depuis 2009 la diversité dans les médias audiovisuels. Son dernier rapport dresse un portrait robot du journaliste à la télévision : un homme blanc, valide, âgé de 35 à 49 ans, vivant en ville et issu d’une catégorie socio-professionnelle supérieure. Face au manque de diversité dans les rédactions et aux biais que cela crée, de nombreux médias cherchent à aller vers plus de pluralisme. Les défis sont nombreux mais les initiatives aussi.
Lucas Turci
1 Oct 2021 | Les résumés, Tours 2021, Uncategorized
Aux Assises, Christophe Agnus, Sandra De Bailliencourt, Sophie Roland et Camille Sarazin questionnent l’approche du journalisme de solutions. (Photo : Irène Prigent/EPJT)
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Climat : quelle approche pour le journalisme de solutions ».
Animé par Sophie Massieu, journaliste et membre de l’Association des Journalistes de l’Information Sociale (AJIS). Avec Christophe Agnus, président de Reporters d’espoirs ; Sandra De Bailliencourt, directrice générale des SPARKNEWS ; Sophie Roland, journaliste-réalisatrice et formatrice pour Solutions Journalism Network ; Camille Sarazin, journaliste pour EntR (France Médias Monde).
LES ENJEUX
La crise climatique a fait émerger un nouveau genre du journalisme. Il ne s’agit plus seulement d’exposer les problèmes mais de montrer les réponses possibles et concrètes. Le journalisme de solution met en avant les initiatives citoyennes en faveur d’une meilleure gestion de l’environnement et pour luter contre le dérèglement climatique. Mais attention à la facilité du journalisme de « goodnews ». Le but n’est pas simplement d’aborder les succès des initiatives mais d’en révéler parfois les limites ou les dysfonctionnements dans un souci critique et de crédibilité journalistique.
CE QU’ILS ONT DIT
Christophe Agnus : « Si on ne fait qu’énumérer les problèmes, on crée une sorte de déprime et les gens n’ont plus envie d’agir. »
« Je m’oppose au journalisme de « goodnews », ou « bisounours ». On fait du journalisme intégral avec à la fois le problème, l’analyse et la solution. On ne fait pas un inventaire des bonnes nouvelles ou des initiatives. »
Sandra De Bailliencourt : « Cela ne suffit plus de montrer les solutions car cela ne met plus les gens en mouvement. Notre but, c’est que les lecteurs se posent des questions sur leur mode de vie. On fait du récit pour replacer l’homme au cœur du vivant, »
Sophie Roland : « 59% des Français attendent de notre part beaucoup plus de couverture des solutions sur la thématique du climat. »
« On n’est pas le porte-parole d’une cause, on ne fait pas du militantisme. C’est important de garder du recul, de l’esprit critique à travers nos reportages et nos enquêtes. L’idée serait qu’on ne parle plus de journalisme de solution mais de journalisme tout court. »
« Décrypter les fausses solutions, c’est aussi du journalisme de solution. »
Camille Sarazin : « Parfois, c’est dur de suivre l’actualité et de voir uniquement les mauvaises nouvelles. Le ton catastrophique peut être paralysant. Les jeunes ont besoin de se projeter dans l’avenir et de voir les solutions. »
« On a essayé de casser les codes des médias traditionnels avec des nouveaux formats. »
À RETENIR
La discussion a mis en lumière l’importance de ne pas confondre journalisme de bonnes nouvelles et journalisme de solutions. Un vrai travail investigation est requis pour aborder les enjeux environnementaux dans leur globalité, de l’exposition de la gravité des problèmes au questionnement sur la pertinence des solutions. Ce nouveau genre au sein de la profession peut permettre de recréer du lien entre les médias et les lecteurs. Ce journalisme intégral peut donner envie aux gens de s’impliquer, d’agir en faveur de l’environnement. La conférence a également pointé la nécessité de former les journalistes pour mieux traiter les questions climatiques.
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
(Photo : Manuela Thonnel/EPJT)
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Climat, biodiversité : de la nécessité de travailler en réseau ».
Animé par Sophie ROLAND, journaliste-réalisatrice et formatrice pour Solutions Journalism Network, l’atelier a réuni Anne HENRY-CASTELBOU, journaliste Radio RCF Hauts de France et presse économique régionale, responsable du réseau régional des Journalistes pour la Nature et l’Ecologie (JNE), Kristen FALC’HON, membre fondateur de Splann! et Laurent RICHARD, fondateur de Forbidden Stories. Leila MINANO, secrétaire générale de Disclose, aurait également dû être présente, mais s’est décommandée en apprenant la participation de Nicolas Hulot à l’événement, précise Sophie Roland.
Les enjeux
Les journalistes qui traitent des questions écologiques se retrouvent souvent isolés, indépendants ou au sein des rédactions. Ils subissent les pressions de la part des politiques, des industriels, des mafias… En apprennant à travailler en équipe, les journalistes mettent en commun leurs compétences et leurs ressources. Par la collaboration, ils espèrent donner un nouvel écho à leurs sujets et peser davantage dans la balance.
Ce qu’ils ont dit
Laurent Richard : « Cela fait une bonne trentaine d’années que le journalisme collaboratif se développe. On a besoin de ressources de talents d’expertises dans tous les pays du monde. Cela serait dommage de faire ça tout seul mais cela va à l’encontre de toutes nos expériences personnelles précédentes. On est souvent des loups solitaires, à la recherche du scoop qu’on veut sortir et qu’on ne veut pas partager avec d’autres. »
« On essai de composer une équipe de rêve à chaque fois et c’est assez fabuleux comme aventure. Chacun met son ego au vestiaire. On sait que l’on enquête sur des histoires extrêmement dangereuses, c’est aussi le sens de la collaboration, car ça ne sert à rien de tuer un journaliste s’il y en a 30 autres qui arrivent derrière. On est un espèce d’énorme éléphant qui se déplace. C’est aussi une aventure humaine, nous n’avons pas la même culture, la même façon de communiquer, des approches et des lois différentes. »
« Toute enquête ne se prête pas à la collaboration, mais juridiquement, en termes de sécurité ou économique, ça a du sens. Je trouve ça dommage que ce ne soit pas enseigné comme un socle dans les écoles de journalisme. C’est une façon de redéfinir la profession, de s’enrichir des autres cultures. Il y a plein d’obstacles, de contraintes à gérer, mais je pense que le journalisme collaboratif est l’avenir et devrait être un peu plus pris en considération. »
Kristen Falc’hon : « Nous avons vocation à travailler, à chaque fois, avec d’autres médias. Lancer un média tout seul, c’est prendre le risque de parler dans le vide. Pour chaque enquête que l’on ouvre, on travaille avec d’autres médias qui s’engagent à publier eux-aussi l’enquête. À partir du moment où les médias nationaux s’intéressent à des questions, ça change la donne. Il y a tout de suite des pressions supplémentaires sur les acteurs locaux. »
« On n’a pas les mêmes infos quand on est à Brest que quand on est en Centre-Bretagne. En travaillant ensemble, on a par exemple donné une dimension systémique à la pollution à l’ammoniaque dans notre dernière enquête. »
« Ce sont des réunions téléphoniques à n’en plus finir, pendant des heures et des nuits. C’est assez éprouvant. On a quand même besoin de se retrouver physiquement. On a envie de cette euphorie collective. On voit chacun sur nos écrans que les choses bougent, mais on a envie de le partager à plusieurs. »
Anne Henry-Castelbou : « Les journalistes en région qui travaillent sur les sujets écologiques sont souvent seuls dans leur rédaction ou lorsqu’ils sont indépendants. On se voit comme des concurrents lorsqu’on ne se connait pas. »
« Nous avons intérêt à travailler ensemble pour sortir des discours institutionnels et de l’actualité chaude. Les journalistes échangent entre eux au sein des rédactions. C’est aussi ça le travail collaboratif. Il y a plein de moyens de le faire émerger, mais on peut tous monter en compétence. »
À retenir
Mettre en commun les ressources, se nourrir d’autres cultures et collaborer semble être l’une des clés pour donner une nouvelle profondeur à l’investigation. En faisant front commun, les journalistes entendent lutter contre les pressions dont ils sont victimes, mais aussi donner une nouvelle profondeur à leur enquête. Pour cela, ils doivent mettre de côté leur ego, dépasser le sentiment de concurrence. Ce n’est plus la signature qui compte mais bien transmettre une information globale et approfondie.
Manuela Thonnel
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Paul Vuillemin /EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Média et climat, une perspective historique en partenariat avec le GIS journalisme »
Animé par Claire BLANDIN, professeure des universités à la Sorbonne avec Anne-Claude AMBROISE-RENDU, professeure d’histoire contemporaine à l’UVSQ/Université Paris Saclay ; Michel DUPUY, chercheur associé à l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine ; Nathalie TORDJMAN, membre des Journalistes écrivains pour la nature et l’Ecologie (JNE).
LES ENJEUX
L’étude historique de la presse permet de cerner les évolutions des articles sur l’écologie. Des premiers sujets au XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, l’analyse des archives, comme celles du JNE, et le travail des historiens, est un apport majeur pour comprendre le sujet.
CE QU’ILS ONT DIT
Anne-Claude AMBROISE-RENDU : « En 1969, on a un bouillonnement de la presse alternative autour de nouvelles questions, dont la presse écologiste »
« Les préoccupations sur l’environnement ne datent pas des années 1970. Elles datent des débuts des ennuis, donc de la Révolution industrielle, avec une émergence dès la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. En France, on a dès la fin du XIXe siècle les premiers articles sur la pollution des rivières dans la presse généraliste »
Michel DUPUY : « Les catastrophes naturelles amènent de la recherche. Les désastres locaux touchent surtout les personnes des régions concernées, mais la canicule de 2003 a été un révélateur. Elle a touché l’ensemble du territoire français, donc elle a été un marqueur. »
« En Allemagne, il y a eu de grandes tempêtes et chez eux la catastrophe agit comme un révélateur du réchauffement climatique. Elle permet une prise de conscience et amène des mesures concrètes. C’est la même chose en Suède. En revanche, en Italie, les incendies de forêts ne participent pas à une prise de conscience du changement climatique. »
Nathalie TORDJMAN : « Des études médias ont été faites chez les JNE en 1997, 2002 et 2005. Elles ont montré que l’’association permettait aux confrères et consœurs d’avoir un poids plus important dans leur rédaction. Ils arrivaient à faire passer plus de sujets. »
À RETENIR
Les années 1970 ont représenté un moment clé pour le développement de l’écologie dans les médias. Une presse écologiste émane de la contre-culture avec des titres militants. Des associations comme la JNE ont aussi permis aux journalistes de davantage s’exprimer sur ces sujets, et de pousser l’écologie au premier plan en poussant notamment la candidature du premier candidat écologiste lors de l’élection présidentielle de 1974, René Dumont. L’étude historique de la presse permet de voir les spécificités françaises et son évolution au fil du temps.
1 Oct 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Lisa Morisseau/EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Fake news, climat et pandémie »
Animé par Benjamin JULLIEN, responsable communication de la European Climate Fondation, avec David SALAS Y MELIA, chercheur chez Météo France et Yves SCIAMA, président de l’Association des Journalistes Scientifiques Professionnels d’Information (AJSPI).
LES ENJEUX
La crise climatique ainsi que la crise pandémitfque font l’objet de nombreuses fake news. Des informations trompeuses sèment le doute sur la gravité des risques écologique et sanitaire. Vendredi matin, l’atelier a notamment montré que les journalistes jouaient un rôle majeur dans cette chasse aux fausses informations et plus généralement dans la couverture du dérèglement climatique.
CE QU’ILS ONT DIT
Yves SCIAMA : « Dans les années 2000, on nous disait qu’il n’y avait pas de réchauffement climatique. C’était la faute du Soleil. Il y avait un champ scientifique traversé par les fake news. Finalement, aujourd’hui nous sommes dans une situation différente, dans une société climatosceptique de fait. On dit qu’on croit au réchauffement climatique mais en pratique, on se comporte comme s’il n’existait pas. Les fake news sont originales, différentes. C’est un espèce de silence devant l’inaction. »
« Il y a un problème d’illettrisme scientifique de la machine médiatique. Les journalistes ont besoin de se former. »
David SALAS Y MELIA : « Les courbes augmentent. L’an dernier, à cause des mesures de la pandémie, il y a eu une réduction brutale de 7 % des émissions de CO2. Cette baisse, c’est ce qu’il faudrait tous les ans jusqu’en 2030 pour atteindre les objectifs de la COP 21. »
Un journaliste présent dans le public a pris part au débat : « Le raisonnement, décroître pour résoudre le problème est faux. Philosophiquement, ce n’est pas possible de se mettre dans cet état d’esprit. »
Une journaliste indépendante a quant a elle affirmé : « Le problème du climat, c’est générationnel. La plupart des jeunes diplômés ont cette idée de sobriété, de moins consommer. Mes parents par exemple nous taxent de pessimiste. Il y deux visions différentes dues à l’imaginaire dans lequel on a été élevés. »
À RETENIR
Le réchauffement climatique n’est pas seulement un sujet de curiosité journalistique. Les journalistes doivent se former à la parole scientifique pour couvrir avec rigueur l’actualité liée à l’environnement et au climat. Et être en mesure de contredire, ou d’éclairer les déclarations des candidats à l’élection présidentielle par exemple.
Héloïse Weisz
30 Sep 2021 | En direct, Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Romain Leloutre/EPJT
Les prix des Assises 2021 ont été remis ce jeudi 30 octobre par le journaliste Patrick Cohen, président du jury. Le magazine scientifique Epsiloon et la dessinatrice COCO ont notamment été récompensés.
Les prix des Assises internationales du journalisme de Tours récompensent chaque année les publications des douze derniers mois qui interrogent le mieux le journalisme et éclairent la pratique du métier. Patrick Cohen, président du jury, a récompensé les différents journalistes et auteurs jeudi 30 octobre 2021.
Retrouvez tous les nommés aux différents prix ici.
Le Grand prix du journalisme Michèle Léridon
Le grand prix du journalisme des Assises distingue la ou le journaliste, le média, le collectif ou l’action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs du journalisme lors de l’année écoulée. Le magazine scientifique Epsiloon remporte le prix.
Epsiloon, c’est une aventure menée par douze journalistes qui ont préféré quitter le journal autrefois référent mais aujourd’hui malmené Sciences & vie afin de créer un magazine d’information scientifique indépendant et rigoureux.
«Ce prix et cette reconnaissance de la profession ont une importance pour nous car si nous avons eu l’envie et l’énergie de relancer un magazine papier juste après le Covid et plus encore au XIXe siècle, c’est parce que l’on aime profondément notre métier et qu’on y croit », a déclaré Mathilde Fontez, corédactrice en cheffe d’Epsiloon.
Le prix du livre du journalisme
La dessinatrice de presse COCO est distinguée pour Dessiner encore, sa première bande dessinée, sortie en mars 2021, où elle raconte sa vie depuis l’attentat à Charlie Hebdo de janvier 2015.
« Je suis très heureuse. Mais pour être très honnête, j’ai toujours du mal à me réjouir car ce livre n’aurait jamais dû exister. Mais, finalement, il existe car il faut pouvoir raconter et témoigner pour que la mort n’ait pas le dernier mot. Moi j’ai choisi de me tourner vers le journalisme et le dessin. Ce livre c’est un livre sur la solitude, l’esprit d’équipe, l’esprit d’une rédaction mais surtout l’esprit Charlie qui était représenté par des gens formidables et engagés qui défendaient des valeurs fondamentales », a témoigné COCO, la voix tremblante.
Le prix Recherche
Ce prix récompense le meilleur livre de recherche sur le journalisme et sa pratique. Il est remis par un collège de sept chercheurs. Marie-Noëlle Doutreix en est la grande gagnante avec son livre 2020, Wikipédia et l’actualité. Qualité de l’information et normes collaboratives d’un média en ligne.
Le prix Enquête et reportage
Ce prix est remis par vingt-huit étudiants issus des quatorze écoles de journalisme reconnues par la CEJ (Conférence des écoles de journalisme) dont l’EPJT fait partie. Le documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » sur le sexisme et la place des femmes dans le journalisme sportif a conquis les futurs journalistes.
« Ce qui me touche particulièrement c’est que ce sont des étudiants qui ont décerné le prix donc j’ai un peu l’impression de les avoir aidé », a souligné émue Marie Portolano. Guillaume Priou, coréalisateur du documentaire, a ajouté : « Si nous avons pu faire un peu avancer les choses, nous en sommes très fiers. »
30 Sep 2021 | En direct, Les résumés, Tours 2021
Photo : Romain Leloutre/EPJT
RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ÉVÉNEMENT « CONJUGUER FIN DE MOIS ET FIN DU MONDE »
Animé par Catherine Boullay, journaliste spécialiste des médias à L’Opinion, avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT ; Patrick Cohen, président du jury 2021, journaliste-présentateur sur France Culture et chroniqueur dans l’émission « C à vous » sur France 5 ; Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du Giec.
LES ENJEUX
Les préoccupations sociales peuvent parfois s’opposer à celles liées au réchauffement climatique. Concilier justice sociale et écologique n’est pas une mince affaire. Des initiatives ont vu le jour comme celle portée par Nicolas Hulot et Laurent Berger. Ces derniers proposent un « pacte du pouvoir de vivre » pour lutter contre le dérèglement climatique tout en améliorant le quotidien des citoyens. Les trois intervenants apportent leur éclairage au débat public lié au pouvoir d’achat et à la défense de l’environnement.
CE QU’ILS ONT DIT
Laurent Berger : « Aucun sujet n’est superflu lorsque l’on veut traiter de la fin du monde et de la fin de mois. La principale erreur, c’est de les opposer. Il faut regarder les choses avec une ambition de transition écologique à hauteur de femmes et d’hommes. On peut de plus en plus porter l’idée que la transition écologique devra être une transition juste. Il faut socialement accompagner cette transition pour aider ceux qui seront le plus impactés. »
« Ces questions demandent du temps pour les traiter. Or, j’ai le sentiment que les journalistes ont de moins en moins de temps et de moyens pour faire ce travail. Quand les rapports du GIEC sortent, on en parle pendant deux jours. Mais on pourrait feuilletonner dessus pendant des semaines entières vu leur épaisseur. »
Patrick Cohen : « La fin de mois et la fin du monde s’opposent en permanence dans l’actualité. C’est difficile de saisir les enjeux et de comprendre les bons scénarios à retenir vis-à-vis de l’actualité environnementale. »
« Heureusement, il n’y a plus de climatosceptiques qui le disent ouvertement. Là où il y a de la complexité, c’est sur le chemin à trouver pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, nous sommes dans un paysage médiatique où la simplicité est bien plus utilisée. »
Valérie Masson-Delmotte : « Quand je regarde le journal de 20H, il y a une forme de dissonance cognitive car on retrouve souvent des éléments contradictoires. Les enjeux du changement climatique ne sont plus niés mais on retrouve des discours d’inaction. Les journalistes ont de vraies difficultés à le comprendre. »
« Est-ce que les médias donnent suffisamment d’informations pour que les Français puissent comprendre ce qui pèsent ou non sur leur empreinte carbone ? Ce n’est pas le cas à mes yeux. Je ne suis pas sûr que les grands médias parviennent à créer des récits qui expliquent cela. Les chaînes d’informations cherchent ce qui est clivant et c’est très différent de ce qui constitue une information scientifique crédible et robuste. »
À RETENIR
Les trois acteurs du grand débat des Assises ont exprimé leurs positions respectives tout en mettant en avant l’intérêt des Français vis-à-vis des questions climatiques. Mais les solutions qui permettraient de lutter contre le réchauffement climatique tout en aidant les plus fragiles demeurent complexes. S’il n’y a pas de chemin univoque pour concilier ces objectifs, il apparaît néanmoins primordial que la classe journalistique s’empare de ces sujets en y consacrant plus de moyens techniques et économiques. L’actualité devrait être plus globalement traitée sous le prisme de l’écologie avec des reportages didactiques.
Alexis Gaucher
30 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Comme chaque année, le traditionnel baromètre social des assises a été présenté par Jean-Marie Charon, sociologue des médias et chercheur au CNRS et à l’EHESS.
En 2020, 34 182 journalistes étaient détenteurs de la carte de presse. Depuis vingt ans, ce chiffre ne cesse de baisser. Dans « Hier, journalistes, ils ont quitté la profession« , Jean-Marie Charon et la chercheuse Adénora Pigeolat poursuivent l’enquête sur les raisons pour lesquelles il y a de moins en moins de journalistes en France. Pour la présentation de cette recherche, la co-directrice de l’Ecole Universitaire de Journalisme de Bruxelles, Florence Le Cam, était présente aux côtés du sociologue. L’occasion pour elle de présenter les conclusions de son travail de recherche sur la situation des journalistes belges.
Quinze ans : c’est la durée moyenne de la carrière d’un journaliste en France. Si le chiffre avait déjà suscité la surprise et l’émotion lors des 11e Assises du journalisme en 2018, plusieurs explications ont été mises en avant pour comprendre la situation.
-
Des jeunes journalistes formés
Sur un panel de 55 personnes, la moitié est âgée de 35 ans ou moins, soit à peine une dizaine d’années d’exercice du métier. Dans la très grande majorité, ces personnes avaient suivi une formation au journalisme. Parmi elles, les deux tiers sont diplômés d’une école « reconnue » par la profession.
Une majorité des journalistes qui ont quitté la profession ont connu des périodes de précarité (statut de pigiste, CDD, autoentrepreneuriat, chômage, etc.). Parmi ces professionnels précaires, les femmes sont surreprésentées.
Les journalistes qui quittent la profession sont en majorité des femmes. Sur un panel de 55 personnes, elles représentent deux personnes sur trois. Un chiffre étonnant notamment dans un pays où l’on approche la parité chez les journalistes détenteurs de cartes de presse (en 2020, les femmes représentaient 47,5 % des cartes de presse).
-
Un désenchantement et une perte de sens
« ‘Ce n’est pas le métier que nous voulions faire« . C’est l’une des phrases qui revient de façon récurrente chez les personnes interviewées. Selon Jean-Marie Charon, un ensemble de facteurs permet d’entrevoir ces départs mais l’élément premier concerne les valeurs. Les journalistes arrivent dans le métier avec une idée bien précise mais ne s’y retrouve finalement pas. « Plusieurs personnes du panel ont confié avoir voulu faire ce métier au service des autres, de la société et explique avoir un sentiment de lassitude, d’effectuer un travail superficiel et redondant« , explique Jean-Marie Charon.
-
Souffrance au travail, burn-out et discriminations
La dureté et la pression excessive du travail de journaliste conduisent à des situations de souffrance au travail pouvant aller jusqu’au burn-out. Aussi, pour le sociologue Jean-Marie Charon, tout ce qui entoure les violences et le harcèlement est « extrêmement massif ». Le deuxième grand registre des facteurs spécifiques intervenant dans le départ des femmes est celui des discriminations liées au genre.
30 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
(Photo : Romain Leloutre/EPJT)
Animé par Jacques Trentesaux, directeur de la rédaction et co-fondateur de Médiacités. Avec Juliette Duquesne, journaliste et autrice ; Morgan Large, journaliste chez Radio Kreiz Breizh ; Michel Lepape, vice-président en charge de la coordination à la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricole du Centre-Val de Loire (FDSEA), céréalier à Saint-Flovier ; Samuel Petit, rédacteur en chef du Télégramme.
LES ENJEUX
La société se transforme et le regard change sur l’agriculture, en lien avec les questions environnementales. Les agriculteurs incarnent le rapport à la terre mais sont aussi critiqués selon le type d’agriculture qu’ils exercent. Eux dénoncent la vision donnée par les journalistes dans les médias. Ceux-ci ont parfois du mal à traiter des questions agricoles, par manque de temps, de connaissances ou à cause des pressions qu’ils peuvent subir.
CE QU’ILS ONT DIT
Samuel Petit : « On est de plus en plus éloigné du milieu agricole, on a une image fantasmée. C’est l’un des problèmes entre les médias et l’agriculture. »
« Quoiqu’on écrive, les agriculteurs nous le reprochent et les environnementalistes aussi. »
Michel Lepape : « On est des paysans, certains sont des taiseux. On aime rencontrer des gens, mais on a l’impression que les journalistes ne peuvent pas creuser les sujets, qu’ils n’ont pas le temps. »
« Il y a un discours qui est dicté, c’est sûr, c’est dommage. À l’image de la société, est-ce qu’on a gardé un sens critique ? C’est pareil dans l’agriculture, peut-être qu’on a perdu notre sens critique car on a perdu notre indépendance intellectuelle. »
Morgan Large : « On a dépossédé les agriculteurs de la capacité à communiquer eux-mêmes. La communication est pilotée par l’agroalimentaire. »
« Je ne suis pas persuadée que ce soit aux journalistes d’apporter des solutions. »
Juliette Duquesne : « Il y a des difficultés pour traiter le sujet agricole. À un moment, je me suis épuisée à pousser ces sujets à l’antenne donc j’ai décidé de faire du journalisme autrement : je suis maintenant journaliste indépendante. C’est révélateur du financement des médias et du débat médiatique actuel. »
À RETENIR
La discussion a mis en lumière des divergences sur la manière d’informer sur l’agriculture, entre les journalistes eux-mêmes. Certains type d’articles ou certains sujets peuvent faire craindre un agribashing mais c’est l’agriculture et non les agriculteurs qui sont au cœur des critiques.
Camille Granjard
30 Sep 2021 | Les résumés, présidentielle, Tours 2021
Photo : Romain Leloutre /EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Élections présidentielles, des médias sous influence ? »
Animé par Nassira EL MOADDEM, journaliste et autrice avec ; Raphael GARRIGOS et Isabelle ROBERTS, cofondateurs du média en ligne Les jours ; Antoine GENTON, rédacteur en chef adjoint de TV5 Monde ; Alexis LEVRIER, historien de la presse.
LES ENJEUX
À chaque scrutin dont les prévisions sont démenties, une même question hante le débat public : les médias influencent-ils les élections ? Un débat qui ne date pas d’hier, conséquence directe de la défiance grandissante du public à l’encontre des journalistes. La controverse a le mérite d’interroger les limites de la liberté de la presse. Mais peut se révéler plus problématique lorsqu’elle remet en cause la capacité de jugement des électeurs et par extension, faire douter du modèle démocratique.
CE QU’ILS ONT DIT
Isabelle ROBERTS : « Quant on revient sur la grève d’I-Télé, le mécanisme est très clair. Vincent Bolloré a fait partir la quasi-totalité de la rédaction et il était déjà question d’Éric Zemmour. C’est à partir de ce moment-là que naît CNews avec, en plateau, des chroniqueurs en provenance de Valeurs actuelles ou encore Boulevard Voltaire. C’est le tapis brun qui était déroulé. »
Antoine GENTON « Ce qui est très inquiétant dans ce que font les dirigeants de Canal +, c’est qu’ils portent atteinte aux pratiques journalistiques, pour des questions d’argent, d’audience, d’où l’éviction progressive du reportage. Les débats en plateau coûtent effectivement moins cher. »
Alexis LEVRIER : « La « Bollorisation » traduit le fait que l’on a rarement vu, au moment des présidentielles, un patron de presse prendre autant de place, qu’il s’agisse du groupe Canal ou de CNews. Il est aussi présent à la radio avec Europe 1 et enfin Prisma. On peut aussi se demander si la ligne éditoriale ne déteint pas sur les autres médias avec la montée en puissance des médias d’opinion. »
« Il faudrait revenir sur le système d’aides à la presse mais cette question est totalement absente de la campagne présidentielle. »
Raphael GARRIGOS : « CNews est devenu la maison mère d’Europe 1 depuis l’OPA de Vivendi et la moitié de la rédaction est partie. Le seul journal invité plus de deux fois depuis a été Valeurs actuelles donc on a vraiment ce phénomène d’opinion et d’influence qui se vérifie. »
À RETENIR
La dimension économique est cruciale dans la montée en puissance de l’extrême droite sur nos écrans écrans. La concentration des titres de presse, détenus par de grands groupes, tend à affaiblir la presse traditionnelle et accentue ainsi la prédominance du journalisme d’opinion. La « Bollorisation » de la presse est une émanation de cette nouvelle tendance qui déteint, de plus en plus, sur les pratiques journalistique : les débats en plateau peuvent désormais supplanter le reportage.
30 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Biodiversité et Climat, même combat ? ».
Animé par Dominique Martin-Ferrari, journaliste spécialisée et autrice du coffret multimédia « mémoires RIO+20, 1992/2012 », avec Pascale Larmande, animatrice régionale de l’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire ; Chaymaa Deb, journaliste environnement au sein du média en ligne de l’écologie et du climat Natura Sciences ; Christophe Cassoux, directeur de recherche au CNRS (en distanciel) et François Gemmene, chercheur en sciences politiques, rattaché à l’université de Liège et enseignant à Sciences Po (en distanciel).
LES ENJEUX
Depuis plus de trente ans, le GIEC travaille à la compréhension des risques liés au changement climatique. Mais qu’en est-il de la biodiversité ? Créée en 2012, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) travaille spécifiquement sur ces sujets. Ensemble, journalistes, chercheurs et scientifiques se sont questionné sur le traitement médiatique de ces deux phénomènes intimement liés et sur les actions à mener pour faire face à ce double défi.
CE QU’ILS ET ELLES ONT DIT
Christophe Cassou : « Le 6e rapport du GIEC a été présenté sur une chaîne TV comme écrit par deux personnes. En réalité, il y a derrière ce rapport 234 scientifiques de 64 pays. Le processus de relecture a conduit à 78 000 commentaires et 32 000 commentaires des gouvernements, aujourd’hui accessibles au public. »
« L’un des faits établis de ce nouveau rapport est le suivant : il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les océans et les continents.»
François Gemmene : « Au vu de toute l’expertise rassemblée au sein du GIEC, je pense que nous avons une responsabilité collective pour tenter d’améliorer la communication de la science vers le grand public mais aussi vers les décideurs. A force de donner l’alerte, celle-ci va finir par remplacer l’action. Il faut que la science explique l’action autrement. »
Pascale Larmande : « La biodiversité, c’est un peu un mot de technicien. Dans la conscience collective, le mot le plus simple c’est la nature. Le premier constat, c’est que cette nature n’a pas besoin de nous. En revanche, nous on ne peut pas s’en passer : pour s’alimenter, pour s’habiller, pour se loger, pour notre santé. Nous nous sommes au fil du temps éloignés de cette évidence. »
Chaymaa Deb : « Est-ce qu’on met la question climatique et la question de la biodiversité sur le même point ? Oui et non car il y a des problématiques qui doivent être prises en compte par le public pour tendre vers ce monde dans lequel il serait plus désirable de vivre. Et non, parce qu’il y a dans la biodiversité un caractère de résilience. Nous, êtres humains, avons besoin de la nature contrairement à elle, qui n’a pas besoin de nous. »
À RETENIR
S’il semble essentiel de mener un combat global concernant l’urgence climatique et l’anthropocène, il est important de ne pas mettre de côté le combat de la biodiversité. Particulièrement locale et écosystémique, la biodiversité est, de par sa résilience, une source de solution au dérèglement climatique. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les urgences non plus. Pour autant, l’international ne peut être déconnecté des problèmes locaux. Les professionnels présents ont évoqué la nécessité pour les journalistes de faire preuve de pédagogie en traitant de ces deux crises, mais également de l’importance de la formation des journalistes à ces questions scientifiques, particulièrement complexes.
Romane Lhériau
30 Sep 2021 | En direct, Les résumés, Tours 2021
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Police et journalisme, après le rapport Delarue quelles avancées ? »
Photo : Romain Leloutre/EPJT
Animé par Loïc HERVOUET, journaliste, formateur pour l’ONG Actions Médias Francophones avec : le colonel Nicolas BENEVENT, directeur de la communication de la Gendarmerie Nationale ; Pierre-Henri BRANDET, directeur de la communication du ministère de l’Intérieur : Fabrice CASADEBAIG, conseiller spécial (DGMIC) du ministère de la Culture ; Jean-Marie DELARUE, conseiller d’Etat honoraire, président de la commission indépendante sur les relations entre les journalistes et forces de l’ordre ; Alain MORVAN, responsable CFDT Grand-Est ; Vincent LANIER, secrétaire général SNJ ; Emmanuel VIRE, secrétaire général SNJ-CGT.
LES ENJEUX
En pleine contestation de la loi « sécurité globale » le rapport Delarue voit le jour. Ce texte vise à l’amélioration des relations entre la presse et les agents de sécurité. À l’heure où les incidents avec les journalistes se multiplient et où les forces de l’ordre intègrent des services de communication de plus en plus hermétiques aux professionnels de la presse, comment pacifier la relation entre journalisme et police ?
CE QU’ILS ONT DIT
Pierre-Henri BRANDET : « L’équilibre est difficile à trouver entre l’ordre public et le respect des libertés. La transformation du paysage médiatique mais aussi des manifestations, qui ont connu dans leur violence et leur structuration des bouleversements majeurs, ont considérablement modifié les stratégies de maintien de l’ordre. »
« Les forces de sécurité, surtout dans les situations de haute intensité, doivent pouvoir faire preuve de discernement pour faire la part des choses entre ceux qui exercent une activité de journaliste et les manifestants. »
Jean-Marie DELARUE : « Il faut des signes pour que les journalistes soient identifiables auprès des forces de l’ordre : une attestation d’employeur, faite sur un modèle à peu près uniforme par exemple. Car la carte de presse ne couvre pas toutes les situations d’emploi des journalistes. »
« Il importe au gouvernement de se saisir de l’état d’esprit des forces de sécurité. Le métier du maintien de l’ordre est un métier extrêmement difficile et aider à l’identification des journalistes est un moyen de les aider. Je n’impose pas les moyens mais j’invite les journalistes à travailler sur la question pour que les agressions cessent et que vous puissiez exercer votre métier en toute quiétude. »
Fabrice CASADEBAIG : « Une partie des journalistes n’ont pas nécessairement la carte de presse et une partie d’entre eux n’ont pas d’employeur non plus. Peut-être qu’il faudrait imaginer un système de déclaration, génératrice d’une attestation qui pourrait être présentée aux forces de l’ordre. »
Nicolas BENEVENT : « En tant qu’agent du service public, nous avons le devoir d’expliquer comment nous travaillons, d’où l’idée d’une formation en lien avec les médias. Le déploiement des caméras piétons a également commencé cet été, de même que celui des équipes de liaisons et formations qui ont vocation à guider, renseigner et échanger avec le public. »
Vincent LANIER : « Les journalistes sont devenus un problème. Maintenant, il va falloir présenter la carte de presse, un formulaire, une auto attestation, tout ça ressemble à une usine à gaz. On a recensé plus de 200 cas de journalistes qui ont été molestés ou empêchés de travailler par les forces de l’ordre et dans 99% des cas, ils étaient clairement identifiés comme journalistes, avec un dossard presse ou du matériel. Cela n’a pas empêché qu’ils soient matraqués. Pour moi, le problème il ne vient pas des journalistes. »
Emmanuel VIRE : « Nous avons en France une stratégie de maintien de l’ordre, matérialisée par le Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) qui a profondément évolué, comme le phénomène des nasses par exemple. La situation, on la connaît : il est de plus en plus difficile pour n’importe quel citoyen de manifester. Ce que l’on veut, c’est que le SNMO soit réécrit le plus rapidement rapidement possible. »
Pavol SZALAI : « La France est deuxième en matière de violences sur les journalistes. Ce chiffre n’est pas digne d’un pays membre de l’Union européenne qui va bientôt présider le Conseil de l’Union. La France doit se montrer exemplaire. Les sanctions disciplinaires peinent par ailleurs à aboutir. Il faut aussi une réconciliation entre forces de l’ordre et journalistes mais il n’y a pas de réconciliation sans justice. »
Alain MORVAN : « L’accès à l’information ne peut pas être conditionnable. Pour moi, restreindre l’accès à l’espace public est contradictoire avec le travail de journaliste. Aujourd’hui, le débat est de contrôler une profession qui a justement besoin de liberté. Il faudrait peut-être prévoir dans la loi des circonstances aggravantes pour compléter la protection juridique des journalistes.»
À RETENIR
La tension était palpable sur les conclusions tirées du rapport Delarue. Les solutions proposées sont jugées insuffisantes par Emmanuel Vire, Vincent Lanier et Pavol Szalai. Le point de crispation : l’identification des journalistes, considérée comme une restriction trop importante de la liberté de la presse mais aussi de l’accès à l’espace public. L’élaboration du Schéma national du maintien de l’ordre, rédigé par le ministère de l’Intérieur, a aussi été pointé du doigt à l’instar des gardes à vue abusives à l’œuvre dans les manifestations, notamment au moment de la dispersion des foules. Du côté des représentants de la police et de la gendarmerie, des progrès ont été, à contrario, soulignés comme la surveillance de l’activité des agents de sécurité ou le déploiement de nouvelles technologies. Une problématique cependant persiste : aucune statistique institutionnelle ne permet aujourd’hui de rendre compte de l’ampleur des violences perpétrées à l’encontre des journalistes mais aussi des suites judiciaires et des condamnations de leurs auteurs.
Anne-Charlotte Le Marec
30 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Quelle info locale sur le climat ? »
Animé par Richard HECHT, Union des Clubs de la Presse francophones et de France, l’atelier a réuni Sophie CASALS, journaliste de solution à Nice Matin ; Pauline D’ARMANCOURT, responsable de la communication Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire ; Alexandre MARSAT, rédacteur en chef de Curieux! ; Samuel SENAVE, président France Nature Environnement Centre-Val de Loire ; Catherine SIMON, responsable départementale de La Nouvelle République du Centre Ouest pour « Foutu planète ».
LES ENJEUX
L’échelle locale recouvre de nombreuses problématiques environnementales, des transports à l’aménagement du territoire. Les lecteurs sont de plus en plus attentifs à ces questions et sont en demande d’informations. Les journalistes locaux doivent produire des contenus qui informent de la complexité des différents phénomènes. Il faut simplifier et travailler en réseau avec les chercheurs, les associations environnementales, les naturalistes etc. Il s’agit aussi de toucher d’autres publics, notamment les jeunes, très sensibles au sujet de l’urgence climatique, avec des nouveaux formats.
CE QU’ILS ONT DIT
Sophie Casals : « Le prisme de solution n’est pas un journalisme de bonnes nouvelles, on questionne nos experts. Le journalisme de solution, ce n’est pas rester sur le constat. Les lecteurs nous interpellent sur des sujets prospectifs. Notre impact est d’autant plus fort qu’on est en interaction avec nos lecteurs. »
«Beaucoup d’enjeux se jouent au niveau local. Tout ne se joue pas dans les métropoles, au contraire elles sont peut-être lourdes à faire bouger. »
Pauline D’Armancourt : « Il faut acculturer l’ensemble de la population, réussir à faire comprendre la complexité des phénomènes environnementaux et ensuite agir. »
« Parfois, il y a des retranscriptions qui font que le propos scientifique n’y est pas, il y a des contre-sens. C’est le fruit du travail du scientifique qui a été manqué. »
Alexandre Marsat : « Curieux! a été créé en septembre 2018 pour déconstruire les fake news. Presque tout est lié aux sciences. On va sur le front, là où ça se passe, donc sur les réseaux sociaux. On est un média populaire, généraliste qui traite de sciences, et non pas un média scientifique. »
« On a des journalistes spécialisés dans le sport dans toutes les rédactions mais il y a pas de journalistes spécialisés environnement partout, alors qu’il y a une urgence climatique. C’est vraiment important de former les journalistes à l’environnement. »
Samuel Senave : « Ce qu’on attend, ce qui nous importe, c’est une restitution factuelle, qu’on retranscrive notre opinion sans biais. Ce n’est pas forcément ce qu’on retrouve. »
Catherine Simon : « Notre expérimentation s’appelle « Foutu planète ». C’est un groupe Facebook créé en avril 2019, pour faire avancer la place de l’environnement dans notre journal. On voulait créer une dynamique avec nos lecteurs, avoir une communauté. Dans le groupe, il y a des gens qui sont très pointus sur certains sujets. Cela permet d’identifier des experts et de pouvoir faire appel à eux. »
À RETENIR
Les journalistes s’approprient de plus en plus les questions sur l’urgence climatique mais doivent jongler entre pédagogie, simplification et restitution de faits complexes. Ils doivent composer avec les différentes ressources qui cherchent à diffuser les connaissances et expériences. Les lecteurs, eux, sont en quête de compréhension des enjeux contemporains et peuvent être mobilisés à l’échelle locale avec les médias.
Camille Granjard
30 Sep 2021 | Les articles, Les résumés
Photo : Alexis Gaucher/EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Médias, climat : quatre initiatives en Europe ».
Animé par Véronique Auger, présidente de l’Association des Journalistes Européens, avec Ségolène Allemandou, rédactrice en chef de ENTR (France Médias Monde) ; Gwenaëlle Dekegeleer, journaliste à la RTBF ; Hanna Lundquist, journaliste et spécialiste des médias à Journalisten (Suède) ; Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’espoirs.
LES ENJEUX
La médiatisation des enjeux environnementaux est croissante. Un phénomène qui demeure toutefois insuffisant aux yeux de nombreux publics. Les quatre journalistes ont évoqué les initiatives autour du climat qui voient le jour dans les médias européens. Dans ce contexte, le journalisme de solutions suscite de plus en plus d’intérêt.
CE QU’ILS ONT DIT
Ségolène Allemandou : « ENTR, c’est la jeunesse européenne qui s’adresse à la jeunesse. On propose toutes les semaines des thématiques différentes pour créer du lien entre ces jeunes. »
« On est portés par France Médias Monde, on essaye d’être innovants en termes de storytelling en adaptant les formats ou en créant des contenus communs. »
Gwenaëlle Dekegeleer : « On essaye toujours d’avoir une approche de plus en plus constructive. Mais les initiatives prises à la RTBF manquent encore de visibilité et de synergie. Il faut rassembler les acteurs pour créer une émulation positive. »
« Il y a des informations de fond qui manquent, il faudrait faire émerger une plateforme qui permettrait de décrypter les enjeux et pas uniquement de mettre en avant des initiatives. »
Hanna Lundquist : « Il se passe beaucoup de choses concernant le journalisme climatique en Suède. Un journal a décidé de ne plus diffuser de publicités qui concerneraient des énergies fossiles. Et le nombre d’abonnés a augmenté de 40 %. »
Gilles Vanderpooten : « Ce qui nous intéresse à Reporters d’espoirs, ce sont les angles constructifs. La base de notre réflexion, c’est de faire un état des lieux pour ensuite faire autre chose. »
« Il se passe beaucoup de choses grâce à des subventions issues d’appels à projets comme le programme européen d’échange et de formation Stars4Media. »
A RETENIR
Les publics recherchent avant tout des solutions et un traitement de l’information plus innovant. Les intervenants ont mis en avant l’importance de la mutualisation des moyens éditoriaux. Chacun prône une approche constructive des enjeux environnementaux et climatiques. L’idée d’une plateforme commune d’information, au niveau européen, prend de l’ampleur. Les projets collaboratifs apportent de multiples perspectives en fonction des pays.
Alexis Gaucher
30 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Retrouvez l’essentiel de l’évènement « Risquer sa vie pour le climat »
Photo : Romain Leloutre/EPJT
Animé par Eric Valmir, secrétaire général de l’information de Radio France, avec Morgan Large, journaliste chez Radio Kreiz Breizh, Hugo Clément, présentateur de l’émission « Sur le Front » diffusée sur France 2 et Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.
LES ENJEUX
« Alerte rouge pour le « journalisme vert » », publiait Reporter Sans Frontières en août 2020 alors que 10 journalistes avaient été tués en cinq ans pour avoir enquêté sur des questions environnementales. Pour les journalistes qui traitent de ces questions, la question de l’engagement est particulièrement prégnante. Faire leur travail, parfois, entraîne des menaces de mort à leur encontre, comme ça a été le cas pour Morgan Large. Défendre le métier et la mise en lumière de la vérité est au centre de leur combat.
CE QU’ILS ONT DIT
Hugo Clément : « Les journalistes sont pas les premières victimes. Les militants écologiques partout dans le monde se font assassiner. On est dans une situation de guerre de certaines institutions et de certaines industries contre ces militants. Et en tant qu’être humain, on est en guerre contre ce qui se passe et contre notre mode de vie. La déforestation, c’est une guerre contre les peuples d’Amazonie, sa faune et sa flore. Quand on sera le dernier maillon de la chaîne du vivant on tombera, je pense que le mot guerre n’est pas du tout usurpé. »
« Quand on voit tout ça de nos yeux, forcément ça change notre façon de voir le monde. J’ai pris conscience de tout ça et je pense que c’est nous les journalistes qui pouvons transmettre les informations entre les gens qui sont sur le terrain, les scientifiques et le grand public. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas agir. Pour le savoir, il faut montrer les choses. Les chiffres ne suffisent pas, c’est pour ça que les lanceurs d’alerte vont dans les élevages par exemple. »
Morgan Large : « Le danger, c’est l’autocensure. C’est difficile de choisir d’être précaire parce qu’on nous retire des subventions ou d’entendre parler de journalistes qui ont été brûlés vifs. Ce qui permet de continuer, c’est de voir l’exemple d’autres journalistes opiniâtres, de voir des jeunes aussi. Qu’on puisse bien travailler aussi dans des petits médias et s’emparer de ces sujets là. »
« Je suis journaliste, pas activiste. J’aimerais être plus engagée pour l’écologie. Mais si je milite pour quelque chose, c’est pour mon métier. C’est important qu’on puisse continuer d’enquêter, de montrer ce qui se passe et de pouvoir le faire librement. Je n’étais pas dans une démarche militante, j’ai reçu des menaces pour avoir fait mon métier. »
Christophe Delorme : « Le fait de rendre public un cas, ça protège. Le fait de susciter des réactions dans l’écosystème local, d’éviter l’autocensure de consœurs, de confrères, ça protège. Et puis dans le cas de Morgan Large, le fait qu’il y ait une enquête, et Reporters Sans Frontières sera entendu, a fait aussi cesser les menaces. »
« L’enjeu qui nous concerne tous, c’est d’apporter des éléments factuels à un plus grand nombre de lecteurs pour que les institutions agissent en conséquence. »
A RETENIR
La question de la neutralité journalistique a vite été éludée lors des différentes prises de parole. Travailler sur les questions environnementales est un engagement en soi et vu comme tel par les lecteurs. L’enjeu est alors de rendre compte de la situation telle qu’elle est sur le terrain, de donner des faits et de pouvoir continuer à le faire. Hugo Clément n’hésite pas à faire appel au champ lexical de la guerre pour parler de la crise climatique, mais le combat des journalistes qui s’intéressent à ces questions est avant tout un combat pour la défense de leur métier comme le souligne Morgan Large.
29 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Hervé Brusini, président du Comité Albert Londres (Photo : Romain Leloutre/EPJT)
Hervé Brusini, président du Comité Albert Londres, a dévoilé mercredi 29 septembre les nominés de ce prestigieux prix journalistique pour 2021.
Depuis 1933, le prix Albert Londres récompense les meilleurs « grand reporters » français et le fruit de leur travail. Chaque année, 3 catégories sont mises en valeur : le prix de la presse écrite, le prix de l’audiovisuel et le prix du livre. Ce 29 septembre étaient dévoilés les nommés pour l’édition 2021.
19 productions présélectionnés
Les présélectionnés en presse écrite sont :
- Margaux Benn (Le Figaro)
- Zineb Dryef (M le magazine du Monde)
- Wilson Fache (Libération/Causette)
- Ghazal Golshiri Esfahani (Le Monde)
- Caroline Hayek (L’Orient – Le Jour)
- Louis Imbert (Le Monde)
- Josiane Kouagheu (Le Monde Afrique)
- Willy Le Devin (Libération)
- Léna Mauger (XXI).
Dans la catégorie audiovisuelle, six reportages ont été nommés :
- Nicolas Ducrot ( « Pour ne pas les oublier » – France 3, Babel doc)
- Bryan Carter (« Les Routes de la discorde » – RTBF, Pokitin productions)
- Alex Gohari et Léo Mattei (« On the line, les expulsés de l’Amérique » – France 2, Public Sénat, Brotherfilms)
- Jules Giraudat (« Projet cartel-Mexique, le silence ou la mort » – France 5, Forbidden films)
- Céline Rouzet (« 140km à l’ouest du paradis » – BE ciné, Reboot films)
- Solène Chalvon-Fioriti / Margaux Benn (« Vivre en pays taliban » – Arte, Caravelle)
Enfin, pour le prix du livre, cinq projets sont retenus :
- Flic, un journaliste a infiltré la police, de Valentin Gendrot
- Les Serpents viendront pour toi, d’Emilienne Malfatto
- La Honte de l’Occident, de Antoine Mariotti
- Toxique de Sébastien Philippe et Tomas Statius.
« Albert Londres est l’âme du journalisme »
Hervé Brusini a notamment rappelé les critères de sélection et l’importance d’Albert Londres
- « Les critères pour recevoir le prix Albert Londres forment une alchimie. Tout d’abord l’expression d’un style. Puis l’originalité d’une approche, l’opiniâtreté pour aller chercher des informations, le courage de la dénonciation, la sincérité de l’engagement et la capacité à séduire un jury hétérogène en matière d’âge. Il faut qu’on arrive tous à se dire : ça c’est Albert Londres. »
- « Nous avons reçu cette année 90 projets en presse écrite, 34 sujets audiovisuels et 20 livres, de la part de nombreux pays. Cela montre la sincérité de l’engagement d’Albert Londres, dont le nom fédère toujours aujourd’hui au-delà des frontières françaises. »
-
« Albert Londres est allé documenter des sujets encore inconnus du grand public : le traitement des malades psychiatriques, le dopage dans les pelotons cyclistes, les conditions de vie au bagne de Cayenne, la misère du système colonial… Il rassemble les valeurs du journaliste : curiosité, disponibilité, engagement, opiniâtreté et le courage face aux coups encaissés lorsqu’on dénonce des choses. »
- « Albert Londres est l’âme du journalisme. Surnommé le prince des reporters par la journaliste Andrée Violis, il est un des grands héros de l’information. Le grand reportage qu’il a popularisé est une vraie réponse aux questions démocratiques actuelles. Albert Londres y alliait l’art de la langue et l’art du récit. D’où sa devise : porter la plume dans la plaie. »
En 2020, le reporter du Monde Allan Kaval avait décroché le prix Albert Londres dans la catégorie presse écrite. Cédric Gras, pour son livre Alpiniste de Staline, avait remporté le prix de l’édition tandis que les journalistes Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard avaient été couronnés dans la catégorie audiovisuel. Qui seront leurs successeurs ? Réponse le 15 novembre prochain.
Antoine Comte
29 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Alexandre Camino/EPJT
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Parler du genre »
Animé par Marc Mentré, vice-président de Journalisme et Citoyenneté, avec Pascale Colisson, responsable pédagogique et journaliste à l’IPJ Dauphine PSL ; Béatrice Denaes, journaliste formatrice et autrice ; Mejdaline Mhiri, coprésidente de l’association Femmes journalistes de sport, rédactrice en chef Les sportives ; Pauline Talagrand, adjointe au chef réseaux sociaux et fact-checking à l’AFP.
LES ENJEUX
Les quatre journalistes se sont réunies pour échanger autour de la question du genre dans les médias. Cette thématique pose en effet de nouveaux enjeux, notamment de renouvellement de vocabulaire ou de représentativité dans les colonnes. Un défi médiatique de taille dans un contexte de revendications féministes et sociales.
CE QU’ILS ONT DIT
Pascale Colisson : « Nous devons avoir conscience de nos biais. C’est l’essence du métier. Nous devons caractériser les personnes pour ce qu’elles sont et pas pour ce qu’on projette sur elles »
« J’ai confiance en la nouvelle génération de journalistes. Elle est radicale dans le bon sens du terme »
Béatrice Denaes : « Par méconnaissance, on ne fera pas avancer la société. Les journalismes contribuent à faire évoluer les réactions stéréotypées. Nous sommes là aussi bien pour diffuser l’information que la culture, qui feront évoluer les mentalités »
Mejdaline Mhiri : « Certes, nous connaissons les difficultés qui touchent les femmes journalistes dès le début de leurs carrières. Le journalisme est un métier génial, ne lâchez-pas l’affaire. J’ai à cœur de transmettre cette détermination. »
Pauline Talagrand : « Je veux lancer un message. La responsabilité incombe certes aux structures et aux hiérarchies, mais elle incombe surtout aux journalistes. Ce sont eux qui feront bouger les rédactions et qui feront changer les choses »
« Une fois la réorganisation des effectifs entamée, il faut rentrer dans l’éditorial. Il faut donner des lignes directrices aux rédactions, des règles, des références pour que les erreurs ne soient pas faites »
À RETENIR
Les intervenantes qui ont pris part à ce débat ont fait état des difficultés que pouvaient notamment connaître les femmes journalistes au cours de leur carrière. Elles ont également évoqué l’impact que pouvaient avoir des erreurs ou approximations sur la question du genre auprès du lectorat. Elles ont appelé les journalistes et les rédactions à interroger leurs pratiques, pour traiter l’actualité avec le moins de biais possibles.
Alexandre Camino
29 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
(Léobin de la Cotte/EPJT)
Animée par Stéphanie Wenger, journaliste pour Le Monde et Rue 89 Strasbourg, la table-ronde réunissait plusieurs journalistes : Véronique Badets, cheffe de rubrique Environnement à l’hebdomadaire Le Pèlerin ; Macha Binot, rédactrice en chef des médias Mouvement Up ; Carine Mayo, vice-présidente des Journalistes écrivains pour la nature et l’écologie (JNE) ; François Pitrel, journaliste environnement de BFM TV.
LES ENJEUX
Discuter d’urgence climatique a longtemps été l’apanage d’une branche du journalisme, le journalisme d’engagement. Si ce monopole est obsolète, les questions d’environnement étant désormais discutées par tous, le journalisme qualifié d’engagé reste un acteur majeur dans la sphère médiatique. Aujourd’hui, à l’heure de la prise de conscience de l’urgence, quels sont les avantages, les enjeux, les inconvénients de ce journalisme ? Réception par le public, méfiance des lecteurs, résistance des rédactions, tels ont été les enjeux évoqués lors de cette conférence.
CE QU’ILS ONT DIT
Véronique Badets : « Il y a un impact affectif très fort sur ces sujets. En tant que journaliste, on a envie d’en parler plus même si le média pour lequel on travaille n’y est pas accueillant. Au début, il y a une frustration. Un décalage entre sa conscience et celle de sa rédaction qu’il faut gérer. »
« Il est important de rester journaliste, de poser le débat et ne pas transiger sur les faits scientifiques. Il faut que l’environnement reste un sujet comme les autres. »
Carine Mayo : « Être étiqueté comme trop engagé, c’est ne plus être considéré comme journaliste par certains acteurs. Mais au contraire, c’est bien le même métier. On croise, on hiérarchise comme n’importe quel journaliste. »
« C’est une gymnastique de trouver la façon de persuader que ces questions concernent les lecteurs. L’être soi-même aide à porter ces sujets, à être convaincant. »
Macha Binot : « Les médias ont une mission d’information mais pas d’engager les lecteurs. Ce n’est pas notre rôle. Notre mission est de faire connaître des informations vérifiées, des faits pour qu’ils puissent s’en saisir, se responsabiliser. »
« Avec ce principe de journalisme de solution, on passe pour des bisounours auprès des rédactions généralistes. Il y a une acculturation sur cette méthode d’investigation et cette ligne éditoriale qui doit être réalisée. »
François Pitrel : « Le problème derrière ces sujets environnementaux, c’est que si cela faisait de l’audimat, on en parlerait davantage. Beaucoup de gens préfèrent ne pas en entendre parler parce que c’est une information qui peut être anxiogène. Mais le journalisme de solution peut être une réponse. »
« L’inconvénient du journalisme engagé est de ne prêcher qu’auprès de convaincus. Face à lui, on ne trouve pas le public qui ne se sent pas concerné par la question environnementale. »
À RETENIR
L’engagement des journalistes dans des questions environnementales a été moteur et il doit encore l’être face à l’urgence climatique. Il cherche surtout à se démystifier pour faire face à ces critiques. Les acteurs de cette table-ronde ont voulu réaffirmer la frontière entre engagement personnel et pratique journalistique. Être un journalisme comme les autres qui fait face aux mêmes enjeux, la dictature de l’audimat, les influences financières, les réticences des rédactions, etc. Autant d’inconvénients contrebalancés par l’avantage de donner des informations concrètes pour que nos concitoyens s’en saisissent.
29 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021

Animé par Agnès Vernet, présidente de l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information (AJSPI), la discussion réunissait journalistes et chercheurs : Jennifer Galé, journaliste de The Conversation ; Pierre-Henri Gouyon, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot ; Eric Guilyardi, climatologue au CNRS et président de l’Office for climate education ; Juliette Nouel, journaliste indépendante.
LES ENJEUX
Dans la médiatisation de l’urgence climatique, chercheurs et journalistes travaillent en étroite collaboration. Les premiers apportent leur expertise scientifique, les seconds participent à sa transmission auprès du public. Une discussion toujours plus présente dans l’espace public et les questionnements de notre Cité. Autour de la table, réunissant les deux corps de métiers, le projet est de revenir sur ce dialogue : ses formes, ses failles, ses réussites et ses perspectives pour l’avenir de cette discussion et de notre planète.
CE QU’ILS ONT DIT
Agnès Vernet : « En tant que journaliste, nous ne savons pas toujours à quelles connaissances nous fier. Nous avons donc besoin des scientifiques, de leur médiation. Mais nous avons aussi nos propres délais, des contraintes différentes de celles des scientifiques. Cela questionne le dialogue entre journaliste et chercheur.
Jennifer Gallé : « Le principe fondateur à The Conversation : les journalistes ne vont pas écrire mais être des médiateurs, aider des spécialistes à toucher le grand public. Ils essayent d’éclairer l’actualité comme un journaliste de quotidien mais avec le regard d’un spécialiste, un scientifique pour nous donner cette éclairage. »
« Il y a des choses que les journalistes peuvent faire, pas les chercheurs, et inversement. Le journaliste peut enquêter, passer des coups de fils, être désagréable, prendre son temps, avoir cette posture du « je ne connais rien » et voir ce qui se passe. Le scientifique peut amener toute sa connaissance, la hiérarchisation des problématiques. Cette idée de collaboration est essentielle, ils sont très complémentaires. »
Pierre-Henri Gouyon : « La demande est réciproque, pour les journalistes comme pour les chercheurs. Lorsqu’un chercheur se rend compte que notre science prouve que certaines décisions ne sont pas les bonnes, il se retrouve dans une situation complexe. Il se place dans une position que certains appellent militante et nous sommes considérés comme militant à chaque fois que l’on n’est pas en accord avec ce qui se passe. Notre seul recours, à ce moment précis, ce sont les journalistes. Nous avons besoin d’eux lors de ces situations, sur la question des OGM ou du climat. »
Juliette Nouel : « L’explosion des réseaux sociaux a modifié ces relations entre scientifiques et journalistes. Les exemples de chercheurs qui reprennent des journalistes pour des approximations ou des erreurs sont quotidiens. Il y a une vigilance aujourd’hui et cela monte en puissance. Cela force les journalistes à ne pas dire n’importe quoi. »
Eric Guilyardi : « Il y a foison de médias et les scientifiques doivent apprendre auquel ils s’adressent. Sortir de son laboratoire ne va pas de soi et il faut comprendre comment les médias fonctionnent lorsque l’on est chercheur. »
« La science recouvre différents éléments : la science établie, qu’on ne questionne plus, la science qui est en train de se faire et enfin l’expertise en soutien à une décision de société. Plus on va vers l’expertise, moins le scientifique peut être neutre. Lorsque cette décision doit être prise, l’expertise du scientifique ne doit être qu’un élément d’une co-construction. Il y a une éthique de responsabilité que l’on doit se poser lorsque l’on a un micro face à soi. »
À RETENIR
Terme clé de cette table-ronde, c’est la collaboration qui doit régler les relations entre journalistes et chercheurs dans la médiatisation de l’urgence climatique. Deux corps complémentaires qui doivent travailler à la mise en exergue de ces enjeux auprès du grand public. La vision de ces journalistes spécialisés dans les questions scientifiques et ces chercheurs familiers de cet exercice reste optimiste. Mais la tâche n’est pas aisée. Le discours médiatique implique autant de souffrance pour le chercheur que le journaliste a de difficultés à trouver ses interlocuteurs. La question de la neutralité du chercheur comme du journaliste pose aussi question. Le débat est loin d’être clos et il est nécessaire.
29 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Laure d’Almeida/EPJT
Retrouver l’essentiel de l’évènement « EMI : comment les médias jeunesse traitent-ils du climat ? »
Animé par Aurélie Kieffer, journaliste à France Culture, avec Raphaëlle Botte, journaliste à Mon Quotidien et rédactrice en chef de Dong ! ; Malicia Mai Van Can, directrice éditoriale du pôle Planète de Milan Presse ; David Groison, directeur des titres ados de Bayard jeunesse ; Juliette Loiseau, cheffe de rubrique au Monde des Ados.
LES ENJEUX
Les médias jeunesse sont confrontés aux questions que se posent leurs lectrices et lecteurs, à leurs inquiétudes face à l’avenir mais aussi à leur désir de s’engager. S’il est incontournable pour eux de parler de la crise climatique, reste à trouver la meilleure façon de le faire en fonction de leur public. Quelle place donner au climat dans leurs pages ? Comment rendre compte de la complexité de ces questions ? Quelles pistes donner aux jeunes pour passer à l’action sans verser dans l’injonction à agir ? Autant de questions auxquelles ils tentent de répondre.
CE QU’ILS ONT DIT
Raphaëlle Botte : « Dans Dong ! on a trois doubles pages de brèves sur les infos qu’il ne fallait louper dans l’actualité environnementale des trois derniers mois. Et dans nos reportages, on parle d’écologie et des politiques environnementales. Comme on est un trimestriel, on profite de pouvoir travailler sur le temps long. »
« Avec nos ateliers dans les collèges, on se rend compte que les lecteurs qui nous écrivent ne sont pas représentatifs de tous les jeunes. On ne s’adresse pas qu’à des ados qui ont la volonté de s’engager et c’est important de le prendre en compte dans notre façon de traiter de ces sujets. »
Malicia Mai Van Can : « L’essence même de Wapiti, c’est l’environnement et toutes ses problématiques. On a pris le parti de montrer une nature résiliente, sur le temps long. Faire parler la nature, ne pas être anthropocentré. »
« Depuis deux ans, il y a beaucoup plus de lanceurs d’alerte dès 8 ans. On voit une forme de désespérance, d’extra-lucidité. Beaucoup de pourquoi et de comment auxquels on essaie de répondre en restant optimistes. »
David Groison : « Ce qui est important, c’est d’éduquer à la complexité. Et l’autre chose qui nous guide, c’est de sortir du désespoir et de montrer à la jeunesse qu’elle peut passer à l’action. Que certains le font. Comprendre la mécanique de l’action, c’est inspirant. »
« On est journaliste jeunesse, mais avant tout journaliste. On n’est pas là pour esquiver les sujets compliqués. On se met à la bonne hauteur en fonction des âges et on fait très attention de parler avec les bons mots, qu’ils puissent être absorbables. Le pire c’est de laisser les jeunes écouter les infos sans leur expliquer. Ça c’est générateur de stress et d’anxiété. »
Juliette Loiseau : « Le Monde des ados se base beaucoup sur le courrier des lecteurs et les questions sont nombreuses sur le climat. Par nos réponses, on leur apprend la complexité et l’importance de dépasser les écogestes, d’agir plus largement. Il ne faut pas prendre les jeunes pour des bébés. Cette période où la puberté est compliquée est surtout une période propice à l’engagement. En tant que presse jeunesse, il faut reconnaître leur lucidité et les aider à utiliser leur énergie pour s’engager. »
À RETENIR
Ce moment d’échange a permis de mettre en avant l’importance de la pédagogie dans le traitement de sujets complexes comme la crise climatique et l’écologie. Quelque soit le titre de presse jeunesse, l’idée de faire comprendre la complexité prime, même si les perspectives changent en fonction des publics visés. Face à des lectrices et lecteurs de plus en plus lucides quant à l’avenir de notre planète, les médias jeunesse sont confronté à de nombreuses questions. Il en ressort notamment une envie d’agir que les journalistes essaient d’accompagner au mieux. Pas question pour eux de ne pas traiter de ces questions complexes : « Les médias adultes peuvent s’inspirer de nous qui sommes irrigués par ces questions », conclut Malicia Mai Van Can.
Laure d’Almeida
29 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
Photo : Antoine Comte / EPJT
Animé par Steven Jambot, producteur et animateur de « L’atelier des médias » pour RFI ; avec Jeane Clesse, podcasteuse indépendante et hôte de Basilic ; Justine Davasse, autrice et conférencière et productrice du podcast « Les mouvements zéro » ; Grégory Rozières, journaliste du service « science et environnement » au Huffington Post et présentateur de L’en(vert) du décor.
LES ENJEUX
Trois créateurs pour trois projets novateurs. Jeane Clesse, Justine Davasse et Grégory Rozières ont tous lancés leur podcast consacré à l’écologie. Leur défi : raconter par le son et la voix les enjeux climatiques et les initiatives écologiques, dans le but de toucher un auditoire de plus en plus à l’écoute des thématiques environnementales. Il s’agit de ne pas tomber dans le pessimisme mais plutôt de mettre en valeur des personnalités et des initiatives pouvant inspirer les auditeurs.
CE QU’ILS ONT DIT
Jeane Clesse : « J’ai créé Basilic en 2017 en partant d’un constat : on ne parlait pas assez d’écologie dans les médias traditionnels. On sentait une envie chez les citoyens de faire les choses différemment, de parler de projets environnementaux positifs sans tomber dans le dramatique. J’ai donc décidé de mettre sur le devant de la scène des acteurs qui pensent l’écologie différemment, sous la forme de podcast ».
Justine Davasse : « À la suite d’un voyage en Finlande, j’ai décidé de m’investir personnellement dans le 0 déchet. Cette cause m’a passionné et étant bénévole à Radio Campus depuis 12 ans, j’ai eu envie d’y consacrer une émission radio, qui est devenue par la suite un podcast. Aujourd’hui, je travaille avec différents formats comme l’interview ou le reportage qui reviennent tous sur des initiatives » 0″ : les consommations 0 déchet, des agriculteurs n’utilisant pas de produits phytosanitaires, des constructions sans béton… »
Grégory Rozières : « Au Huffington Post on a fondé L’en(vert) du décor en 2020 car on voulait surfer sur la développement du podcast. On a vu que l’écologie n’était pas le thème le plus traité dans ce format, et on a donc décidé d’allier son et environnement. Notre règle, c’est l’humour. Il faut aborder des sujets écologiques assez complexes comme si nous étions dans une discussion entre collègues, à la machine à café. On prend des idées reçues pour les expliquer de façon humoristique. »
Jeane Clesse : « Aujourd’hui Basilic en est à 123 épisodes, ce qui veut dire qu’il y a beaucoup d’initiatives positives. Chaque jour je découvre de nouvelles personnes et ma liste d’interlocuteurs potentiels ne désemplit pas. C’est pour cela que j’interviens assez peu dans mon podcast, pour laisser parler mes invités. Au niveau des thèmes, j’essaye de faire très diversifié : je peux parler de la finance durable, des slow cosmétique ou de l’alimentation locale. Je veux que mes auditeurs puissent piocher comme bon leur semble dans mes épisodes. »
Grégory Rozières : « On a la chance d’avoir derrière nous le Huffington Post qui nous soutient financièrement. Nos podcasts sont intégrés sur le site du média, ce qui leur assurent une visibilité auprès d’un public parfois peu habitué aux formats audios. Nous sommes conscients que les blagues ne doivent pas être trop lourdes. On doit aussi bien se moquer gentiment des écolos ultra-convaincus que des personnes réfractaires au changement. On essaye de faire de l’improvisation, mais préparée (rires). »
À RETENIR
Jeane Clesse, Justine Davasse et Grégory Rozières ont chacun voulu traiter à leur façon de l’écologie de façon positive. Et cela par différents moyens : mettre la lumière sur une initiative atypique, jouer sur l’humour pour décrypter des situations compliquées… L’idée est d’amener l’auditeur à réfléchir sur ce qu’il pourrait faire de son côté en s’inspirant des histoires contées dans les formats audios. Le mariage entre un sujet comme l’écologie, omniprésent dans l’actualité, et un format podcast, qui se démocratise, semble gagnant puisque les 3 créations ont toutes des projets pour les années à venir : des déclinaisons vidéos, des livres ou des rencontres en live avec les auditeurs. Longue vie à l’écologie audio !
Antoine Comte
29 Sep 2021 | Les articles, Les résumés, Tours 2021
(Photo : Alexandre Camino/EPJT)
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Des médias « 0 carbone », est-ce possible ? La responsabilité des journalistes »
Animé par Olivier Monod, journaliste scientifique pour Libération, avec Jon Henley, correspondant Europe pour The Guardian ; Hanna Lundquist, journaliste spécialiste des médias pour Journalisten (Suède) ; Cédric Ringenbach, fondateur de La Fresque du climat ; Gilles Van Kote, directeur délégué aux relations avec les lecteurs au journal Le Monde.
LES ENJEUX
Quatre journalistes de plusieurs pays ont échangé sur la question du traitement de l’urgence climatique dans leurs rédactions. Le but : faire un état des lieux des pratiques en vigueur dans différentes rédactions et s’interroger sur la façon dont les journalistes peuvent encore, à leur échelle, aborder l’environnement dans leurs colonnes.
CE QU’ILS ONT DIT
Jon Henley : « Au Guardian, nous avons par exemple décidé de changer tout notre vocabulaire lié à l’urgence climatique. Le changement climatique est le sujet majeur des années à venir. Nous avons un souci de transmettre au lecteur l’urgence de la situation. »
« Nous essayons, dans notre journal, de montrer comment la crise climatique peut impacter les futurs événements politiques, sociaux ainsi que les cours migratoires. Notre travail journalistique est de fournir une clarté, un résultat précis sur cette thématique, sans erreur. La responsabilité journalistique, elle est là. »
Hanna Lundquist : « En Suède, le journalisme climatique va bien. Il se porte mieux que jamais dans le pays de Greta Thunberg. Entre 2018 et 2019, la présence du climat dans les médias du pays a augmenté de 100 %. Dans les journaux, toutes les sections traitent un peu de cet enjeu. »
« Je pense qu’à l’avenir, nous devons développer le contenu d’investigation sur ces sujets. »
Gilles Van Kote : « Les questions du climat, de l’exploitation des ressources, du lien entre l’activité humaine et la nature par exemple ne sont plus remises en cause. »
« Notre boulot, c’est d’aider nos lecteurs à tout comprendre pour qu’ils puissent prendre des décisions de citoyens. Et ce travail, nous devons le faire le mieux possible pour que les publics retrouvent confiance dans les médias »
Cédric Ringenbach : « Dans la presse, la formation est un mot tabou. Nous parlons de sujets techniques. Nous n’avons pas la science infuse. Il y a une nécessité pour les journalistes de se former. »
« Il y a un vrai enjeu de préparer l’opinion publique aux fake news environnementales ainsi qu’à un climato-scepticisme qui risque de s’accroître. »
À RETENIR
Entre aménagement éditorial, choix des sujets et relation avec les lecteurs, les intervenants ont comparé leurs pratiques dans leurs journaux. Ce moment d’introspection journalistique a mis en exergue des pistes de réflexion pour développer le traitement médiatique de la crise climatique. Les professionnels présents à cette conférence ont notamment évoqué le besoin de développer la formation scientifique des journalistes, ainsi que la nécessité de promouvoir du contenu d’investigation environnemental.
Alexandre Camino
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Mélina Rivière)
Retrouvez l’essentiel de l’événement « « Parlons info » avec les journalistes de Radio France »
Animé par Eric Valmir, secrétaire général de l’information à Radio France, avec Frédéric Carbonne, présentateur du 21/Minuit de FranceInfo ; Philippe Collin, producteur de l’oeil du tigre sur France Inter ; Pierre Haski, géopolitique sur France Inter ; Marie-Ange Lescure, journaliste France Bleu Touraine et Fabienne Sintes, productrice du 18/20 FranceInter.
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Alice Blain)
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Carte blanche à Gérald Bronner »
Animée par Gérald Bronner, sociologue, professeur à l’université Paris-Diderot et membre de l’Institut.
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Alice Blain)
Le ministre de la Culture, Franck Riester, était présent ce vendredi matin aux Assises du journalisme à Tours. Arrivé peu avant 11h45, à Mame, il a déambulé dans les travées de l’Agora, accompagné du président des Assises, Jérôme Bouvier. Il a terminé sa visite par un discours
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Gaël Turpo)
Retrouvez les résultats des Prix Jeunesse de la ville de Tours.
Depuis 2016, la Ville de Tours décerne le Prix Jeunesse de la Ville de Tours (docu-fictions et documentaires d’actualité) qui vise à récompenser les ouvrages d’actualité destinés au jeune public.
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Crédits photo : Alice Blain
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Carte blanche à Guy Lagache »
Animée par Guy Lagache, directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France.
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Benjamin Baixeras)
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Culture du cœur : la marginalité dans les médias »
Animé par Édouard Zambeaux, journaliste quartier populaire et questions sociales, auteur de film et de documentaire ; avec Serge Gasselin, témoin du quotidien ; Filipe Marques, animation sociale et éducation aux médias ; Bruno Morel, directeur général Emmaüs ; Emilie Salvat, docteur en sociologie.
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Alice Blain)
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Le blues du fact-checkeur et les moyens d’y remédier »
Animé par Gilles Bruno, rédacteur en chef de L’Observatoire des médias. Avec Laurent Bigot, responsable presse écrite à l’École publique de journalisme de Tours et responsable du projet Factoscope ; Alexandre Capron, journaliste spécialiste de la vérification des images pour Les Observateurs France 24 ; Mathilde Cousin, journaliste à 20 minutes, rubrique Fake off ; Guillaume Daudin, responsable du blog Factuel de l’AFP ; Mathieu Dehlinger, chef des infos à Franceinfo.fr en charge de « Vrai ou fake » ; Rodriguez Katsuva, journaliste à Congocheck.
LES ENJEUX
Le fact-checking s’est aujourd’hui imposé dans de nombreuses rédactions françaises et sur tous les supports (presse écrite, radio et télévision). Les citoyens soutiennent globalement cette volonté de vérification permanente de la part des journalistes. Problème : les artisans du fact-checking, les fact-checkeurs, eux, n’ont pas le moral.
CE QU’ILS ONT DIT
Mathilde Cousin : « Nous n’avons pas le blues à Fake off. L’impact de notre travail est visible de plusieurs manières, nous recevons souvent des mails de remerciement. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont aussi un bon indicateur. Sur Facebook, les gens taguent leurs amis sur nos articles de fact-checking pour leur montrer que telle ou telle information s’avère vraie ou fausse. »
Guillaume Daudin : « Si j’étais venu aux Assises l’année dernière, j’aurais pu dire que j’avais le blues. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les choses évoluent, AFP Factuel se développe. On arrive à faire travailler les spécialistes du fact-checking à l’AFP avec nos autres journalistes. Cette collaboration fonctionne. Au bout d’un an d’existence d’AFP Factuel, le constat est positif, même s’il y a toujours des choses perfectibles. »
Rodriguez Katsuva : « Au Congo, avoir internet coûte très cher, la plupart des informations sont consultées sur Facebook et WhatsApp. Les fake-news ne peuvent donc pas être vérifiées car la plupart des gens n’ont pas accès à Google. Lors des dernières élections, les politiques se sont servi des fake-news. Ils les ont instrumentalisées. C’est pour ces raisons que nous avons créé Congocheck. Nous voulons donner accès au fact-checking à tous les congolais, de la manière la plus simple possible. »
Alexandre Capron : « En tant que fact-checkeur, je n’ai pas le blues. On sent une volonté de vérification de la part du public. Notre format participatif, alimenté par des vidéos amateurs, fonctionne bien. Il faut néanmoins faire un constat : toutes les intox qui circulent sont beaucoup plus partagées que tous nos articles de fact-checking rassemblés. Une question d’efficacité se pose. Le deuxième point est qu’il ne faut pas faire de marketing avec le fact-checking. Certains politiques s’en servent. Il faut faire attention à l’utilisation de ce terme. »
Laurent Bigot : « Factoscope a été pensé avec les étudiants en les faisant réfléchir à des méthodes de vérifications plus poussées. En matière de rumeurs et de propos tenus par les politiques, on retrouve très souvent les mêmes arguments. Si un fact-checking a été fait sur une déclaration d’un politique, il ne va pas pour autant la délaisser. Les effets du travail des fact-checkeurs sont très difficiles à mesurer. Par exemple, il est compliqué de voir ce qu’à apporté le fact-checking à la suite d’une élection présidentielle. La difficulté avec Factoscope est d’avoir une visibilité aux yeux du grand public, mais cela reste un projet pédagogique. Nous avons néanmoins lancé une application pour apprendre au public à jouer avec le fact-checking. Le site du journal Le Monde abrite également une rubrique Factoscope. »
Mathieu Dehlinger : « À France Info.fr, nous avons décidé de nous baser sur les questions posées sur le live du site. Nous recevons parfois des invectives mais beaucoup de gens nous remercient pour nos explications. C’est plutôt satisfaisant et cela montre que notre travail plait. Notre plateforme « Vrai ou fake » qui rassemble l’ensemble du fact-checking accompli dans l’audiovisuel public, nous a permis d’être plus efficaces. »
À RETENIR
Globalement, le fact-checking se porte bien. Le constat est unanime : les citoyens sont demandeurs de vérification, qu’elle soit sur la question politique ou non. Aujourd’hui, le fact-checking s’est imposé comme format à part entière dans les rédactions françaises et aux yeux du public. Selon la plupart des invités, les fact-checkeurs n’ont pas le blues. AFP Factuel, tout comme France Info et Fake off, se diversifie, à l’image du fact-checking en général qui évolue en tant que pratique. Le travail pédagogique accompli dans les écoles sur la question du fact-checking semble, lui aussi, satisfaisant. Cependant, tout le monde n’est pas égal sur la question des financements. Tandis qu’AFP Factuel dispose de bons moyens financiers, à Congocheck la situation est plus compliquée. Le site de fact-checking ne dispose d’aucun financement de la part du gouvernement et ne fonctionne qu’avec ses propres fonds.
Les fact-checkeurs vont devoir faire face à de nombreux défis à l’avenir et répondre à une problématique d’efficacité. Alexandre Capron dresse un constat plutôt parlant : « Toutes les intox qui circulent sont beaucoup plus partagées que tous nos articles de fact-checking rassemblés. »
Emmanuel HADDEK-BENARMAS
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo: Benjamin Baixeras)
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Europe : quel traitement éditorial en régions »
Animé par Romain Hugon, journaliste délégué de l’Union des clubs de la presse ; avec Xavier Delcourt, ancien responsable de la formation « eurojournalisme » du CUEJ, Marc Duminy, journaliste responsable d’édition à France 3 Nord Pas de Calais en charge du suivi du Brexit et des élections européennes, Pierre France, journaliste et fondateur de Rue89 Strasbourg, Jean-Yves Vif, ancien rédacteur en chef de la Montagne Centre France, journaliste et professeur associé d’université en particulier au DUT journalisme à Vichy.
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Benjamin Baixeras)
Retrouvez l’essentiel de l’atelier « Francophonie : Après Tunis, 2e rencontre du réseau des journalistes »
Animé par David Servenay, journaliste indépendant, avec Ignace Sossou, journaliste à Bénin Web TV ; Kouadio Noël Konan, journaliste à l’Eléphant Déchaîné ; Sandrine Sawadogo, journaliste d’investigation pour l’Economiste du Faso ; Chadia Khedhir, directrice de la chaîne nationale 2 de la télévision tunisienne.
LES ENJEUX
L’atelier « Francophonie : Après Tunis, 2e rencontre du réseau des journalistes » revenait sur l’initiative lancée lors des premières Assises du journalisme à Tunis, en novembre 2018 : le réseau Initiative, Impact, Investigation. Ce projet a pour dessein de réunir des journalistes d’investigation des deux rives de la Méditerranée pour mener des enquêtes communes. L’atelier réunissait des journalistes d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb. L’objectif : discuter des difficultés à exercer le journalisme d’investigation de l’autre côté de la Méditerranée et trouver des solutions via le réseau 3I (Initiatives, Impact, Investigation).
CE QU’ILS ONT DIT
Chadia Khedhir : « Le journalisme d’investigation, c’est montrer ce qu’on veut cacher. En Tunisie, il est de plus en plus possible de mener des enquêtes. Lors des premières années de la révolution, les journalistes manquaient encore d’audace et d’expérience. Une loi sur la liberté d’expression qui est passé à ce moment a beaucoup changé les choses, même si les politiques et les lobbies tentent toujours d’intimider les journalistes en les menaçant de procès et en les intimidant sur les réseaux sociaux. En Tunisie, il suffit de gratter un peu pour trouver un sujet d’enquête, je pourrais enquêter sur tout. La Tunisie est un grand chantier. »
Ignace Sossou : « Le projet de réseau Initiative, Impact, Investigation permettrait de connecter trois sphères : l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et l’Europe pour mutualiser les moyens et pour donner de l’écho aux enquêtes. J’espère que ce réseau pourra donner un impact international à nos enquêtes. Si notre travail est relayé par les médias internationaux, l’écho sera plus grand et les conséquences aussi. Cela permettrait d’avoir des retombées. »
Sandrine Sawadogo : « Une des principales difficultés dans mon métier, c’est la pression des confrères. Pour de la dernière enquête que j’ai publié, un plateau de télévision a été organisé pour décrédibiliser mon enquête. Mais les journalistes n’ont pas parlé de mon travail mais plutôt de mes habitudes, de mes fréquentations… ils essayaient de saboter mon enquête en décrédibilisant ma personne. On nous a également souvent proposé de laisser tomber telle ou telle investigation et, en échange, on obtiendrai tant d’années de publicité. Et la pression économique c’est une chose mais on subit aussi une pression de la part des juges. »
Kouadio Noël Konan : « Si on ne fait pas notre travail, on cautionne ce qu’il se passe. Mais pour bien enquêter, nous avons besoin de plus de ressources financières. Il y a quelques mois, j’ai mené une enquête sur la société d’État de la forêt en Côte d’Ivoire, et j’ai dû solliciter mes propres ressources. »
À RETENIR
Le réseau Initiative, Impact, Investigation est l’occasion de contourner de nombreuses difficultés que rencontrent les journalistes des médias d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb. Parmi celles-ci : la collecte d’informations et de sources fiables, des moyens financiers, et surtout, une meilleure considération des travaux des journalistes d’investigation de l’autre rive de la méditerranée. Car les sujets qui concernent les trois zones géographiques regroupées par ce réseau ne manquent pas : environnement, question djihadiste, trafiques d’armes et d’êtres humains… Comme rappelé par David Servenay qui animait l’atelier, après la déclaration d’amour entre ces journalistes, il faut désormais montrer des preuves d’amour pour instaurer une confiance au sein du réseau.
Lorène BIENVENU
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Alice Blain)
Retrouvez l’essentiel du débat « Attentats, suicides, maladies graves : traiter du sensible »
Animé par Sophie Massieu, journaliste, avec Caroline Langlade, journaliste et auteure de Sortie de Secours ; Anne-Pierre Noël, journaliste et fondatrice de l’Association de Journalistes et anciens journalistes pour une information responsable en psychiatrie ; Nathalie Pauwels, chargée de déploiement national du programme Papageno et Marie-Christine Lipani-Vayssade, maîtresse de conférences à Bailly-Université Bordeaux-Montaigne.
LES ENJEUX
Suicide, terrorisme, maladies graves, tous ces sujets font partie du domaine de sensible, et peuvent impacter le public et les journalistes qui couvrent ces actualités. Composante à part entière du métier, la recherche de l’émotion et du sensationnalisme vient souvent en premier lieu dans ce domaine. Pourtant, les mots ont un poids et peuvent avoir des répercussions. Alors quelle attitude adopter et comment prévenir ces situations ? Et surtout, comment ne pas banaliser ces thématiques ?
CE QU’ILS ONT DIT
Caroline Langlade : « Le soir du 13 novembre, la première chose que je vois en sortant du Bataclan est un mur de journalistes, de flashs d’appareils photos. C’était trop tôt. Le lendemain, une ancienne collègue m’appelle pour me demander de témoigner. Je lui ai raccroché au nez. »
Anne-Pierre Noël : « Les maladies psychiques sont de plus en plus traités dans les médias mais cela reste une niche. On les retrouve notamment dans les faits divers, lorsqu’un malade commet un crime. Mais les médias oublient souvent que ces personnes peuvent être des victimes. Car certains abusent des faiblesses des malades psychiques. Il n’y a pas d’empathie vis-à-vis de ces personnes, ceux qui ne sont pas touchés ne se sentent pas concernés. »
Nathalie Pauwels : « Lorsque les médias parlent du suicide, il peut y avoir un impact, qui est scientifiquement prouvé. C’est un phénomène très peu connu par les journalistes. Après le suicide de Marylin Monroe, il y a eu une augmentation du taux de suicide d’environ 12% . Une augmentation en lien avec le traitement médiatique du suicide de l’actrice. Certains articles peuvent agir comme désinhibiteurs sur certains personnes ayant des envies suicidaires. »
Marie-Christine Lipani-Vayssade : « Depuis toujours, montrer la souffrance et la violence est une composante à part entière de l’activité journalistique. Les objectifs économiques empiètent sur les pratiques journalistiques. En haut de la chaîne, les employeurs demandent des sujets avec de l’émotion. Cela fait vendre du papier. »
À RETENIR
Le sensible est un sujet traité partiellement dans les médias. Sous-médiatisation, problèmes de hiérarchie, d’éthiques, les mauvaises pratiques journalistique sont nombreuses dans ces situations. « J’ai dû faire face à une déformation de mes propos dans un papier. Quelques mois plus tard, nous avons refusé la diffusion d’un reportage » explique Caroline Langlade, présente au Bataclan lors des attentats du 13 novembre. Le thème du suicide est aussi un sujet propice à des dérives. « Lorsque le suicide est banalisé, voir-même glorifié, il peut être perçu comme une solution » explique Nathalie Pauwels.
Face à ces dérives journalistiques, des préventions sont mises en place, et ce dès les écoles de journalisme. « Pour avoir un meilleur traitement du sensible, il faut faire de la prévention dans les écoles et s’immiscer au sein des rédactions » précise Marie-Christine Lipani-Vayssade. Mais l’entre soi ainsi que la hiérarchie peuvent freiner ces initiatives. « La nouvelle génération est plus ouverte à ces sujets et à travailler avec des professionnels de la santé » tempère la maîtresse de conférence.
Camille MONTAGU
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Benjamin Baixeras)
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Droits voisins, un combat partagé »
Animé par Céline Schoen, correspondante à Bruxelles de la Correspondance de la presse, avec Pablo Aiquel, journaliste SNJ-CGT ; David Assouline, sénateur socialiste de Paris, vice-président du Sénat ; Jean-Christophe Boulanger, P.D-G de Contexte et président du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) et Hervé Rony, directeur général de la Scam.
LES ENJEUX
Un débat avait lieu concernant la réforme du droit qui sera très prochainement mise en place. La question était de savoir si ce changement marque une progression de la reconnaissance par les grandes entreprises de diffusion d’information du travail réalisé par les journalistes ou si la réforme ne va pas inciter les médias à faire du sensationnalisme pour engendrer plus de revenus.
CE QU’ILS ONT DIT
Jean-Christophe Boulanger : « Les droits voisins vont nous rendre encore plus dépendants des GAFA. C’est comme donner la clé de l’édition aux GAFA. »
Hervé Rony : « On a fait un pas en avant, mais il faut maintenant forcer les éditeurs de presse à prendre des décisions dans l’intérêt réels des journalistes. La négociation collective est la seule façon d’y parvenir. »
Pablo Aiquel : « Au-delà de l’enjeu juridique, la question à se poser, c’est comment faire profiter la presse de cette somme d’argent qu’elle reçoit. »
David Assouline : « Le droit d’auteur, que ce soit pour les artistes ou les journalistes, est fondamental puisque ceux qui tirent tous les bénéfices du travail d’autres tuent la créativité. »
À RETENIR
Cette nouvelle réforme a certainement le potentiel d’offrir aux journalistes une reconnaissance énorme des efforts qu’ils mettent dans la réalisation de leur travail qui, à l’heure actuelle, ne profite qu’aux GAFA qui reprennent allègrement toutes les informations de la presse dont ils ont besoin afin d’en tirer profit. Ils devront remettre aux entreprises de presse les 300 millions d’euros qui lui sont dus, mais le combat n’est pas terminé.
Par Pierrick PICHETTE
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Suzanne Rublon)
Retrouvez l’essentiel du débat « Le grand débat : #les médias tous les mêmes ? »
Avec les résultats du baromètre Vivavoice/Les Assises présentés par Aurélien Preud’homme, directeur d’études Vivavoice.
Animé par François Ernenwein, rédacteur en chef La Croix, avec Patrick Apel-Muller, directeur de la rédaction de l’Humanité ; Raphaelle Bacqué, grand reporter au journal Le Monde ; Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde ; Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro ; Daniel Schneidermann, journaliste à Arrêts sur image.
(suite…)
15 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Mélina Rivière)
Retrouvez l’essentiel de l’événement « Soirée de remise des prix des Assises internationales du journalisme de Tours »
Animé par Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué, grandes reporters pour Le Monde et présidentes du Jury des Assises 2019.
La cérémonie de remise des prix des Assises du journalisme, animée par Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué, a récompensé Ivan Chupin. Il a reçu le prix « recherche » pour son ouvrage Écoles du journalisme, Les enjeux de la scolarisation, publié en 2018 aux éditions PUR et questionnant notamment la sélection des étudiants, futurs journalistes, à l’entrée des établissements. « C’est une belle récompense que de remporter le prix des Assises internationales de journalisme. C’est l’aboutissement d’un travail d’association entre le journalisme et le métier de chercheur. »
- Prix de la meilleure enquête ou du meilleur reportage
Ce prix récompensant la meilleure enquête ou le meilleur reportage a été décerné à Charlotte Chaffanjon. Elle a reçu cette récompense pour son écrit Emmanuel Macron et la presse, histoire d’un mépris. Ce prix a été décerné par un jury d’étudiants des quatorze écoles de journalisme reconnues. L’un d’eux a par ailleurs expliqué leur choix : « Nous avons considéré que ce reportage, ce récit, était très agréable à lire, comme un roman, passionnant, et qui dessine surtout en creux la façon dont travaillent les journalistes et les rapport rugueux qu’ils entretiennent avec les pouvoirs. » Charlotte Chaffanjon a quant à elle exprimé sa joie : « Je remercie Vanity Fair qui permet de faire ce genre de papier très long. Je suis contente qu’il ait pu toucher. Cette histoire dit beaucoup de l’époque et du macronisme. »
- Prix du livre du journalisme
Le prix a été attribué à Daniel Schneiderman pour le livre Berlin,1933 aux éditions du Seuil. « C’est au fond une enquête dans l’histoire », s’est exprimée Ariane Chemin. « Ce livre fait écho au monde d’aujourd’hui, aux inquiétudes que l’on peut avoir. Il faut recommander ce livre à tous les étudiants en journalisme. » Et Raphaëlle Bacqué de confirmer : « Cela renvoie à l’expérience intime des journalistes. C’est l’angoisse d’être au cœur d’un évènement et d’être incapable d’en saisir la portée. Ce livre fait réfléchir. » « C’est seulement maintenant que j’arrive à comprendre le livre que j’ai fait et les leçons que l’on peut en tirer », a finalement plaisanté l’auteur. « Un système médiatique peut être complètement aveugle à un phénomène hors-norme. »
- Le grand prix de journalisme de l’année
Le grand prix du journalisme de l’année a été décerné a David Dufresne. Il récompense son travail d’investigation sur les violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. « Chaque fois qu’il repérait une violence policière, il la postait sur son compte Twitter. Ces tweets nous ont permis de réaliser l’ampleur des blessures infligées. C’est une forme nouvelle de journalisme qui a éclos et c’est cela que nous avons voulu récompenser », a précisé Ariane Chemin.
Élise GILLES
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Emmanuel Haddek)
Retrouvez l’essentiel du workshop « Le storytelling à la AJ+ »
Animé par Kheira Tami, rédactrice en chef d’AJ+ français.
LES ENJEUX
L’objectif était de présenter au public présent les valeurs et la méthodologie d’AJ+, un média présent exclusivement sur Internet qui produit des vidéos s’adressant essentiellement à la génération Y. Les différents principes fondamentaux sur lesquels AJ+ français se base pour produire du contenu y ont été exposés.
CE QU’ILS ONT DIT
Kheira Tami : « Notre audience est avec nous chaque matin dans la salle de rédaction. C’est elle qui nous dicte ce que l’on doit faire. »
« C’est avec des visuels, des témoignages et des images qui frappent qu’on produit l’émotion et qu’on fait réagir les gens. »
« Il est inutile de faire une vidéo qui ne fait pas parler l’audience. »
À RETENIR
AJ+ est un média dont la vocation principale est de produire du contenu choc pour attirer l’œil de l’internaute, qui cherche le plus souvent à tuer le temps et n’effectue souvent que du scrolling (Consiste à défiler une page vers le bas NDLR). L’équipe de ce média ressemble presque en tout point à son audience composée majoritairement des Millenials de partout dans le monde, c’est-à-dire qu’ils sont composés d’autant d’hommes que de femmes en plus d’avoir une grande diversité culturelle au sein de leurs employés. Leur mission primaire : générer l’émotion.
Par Pierrick PICHETTE
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019
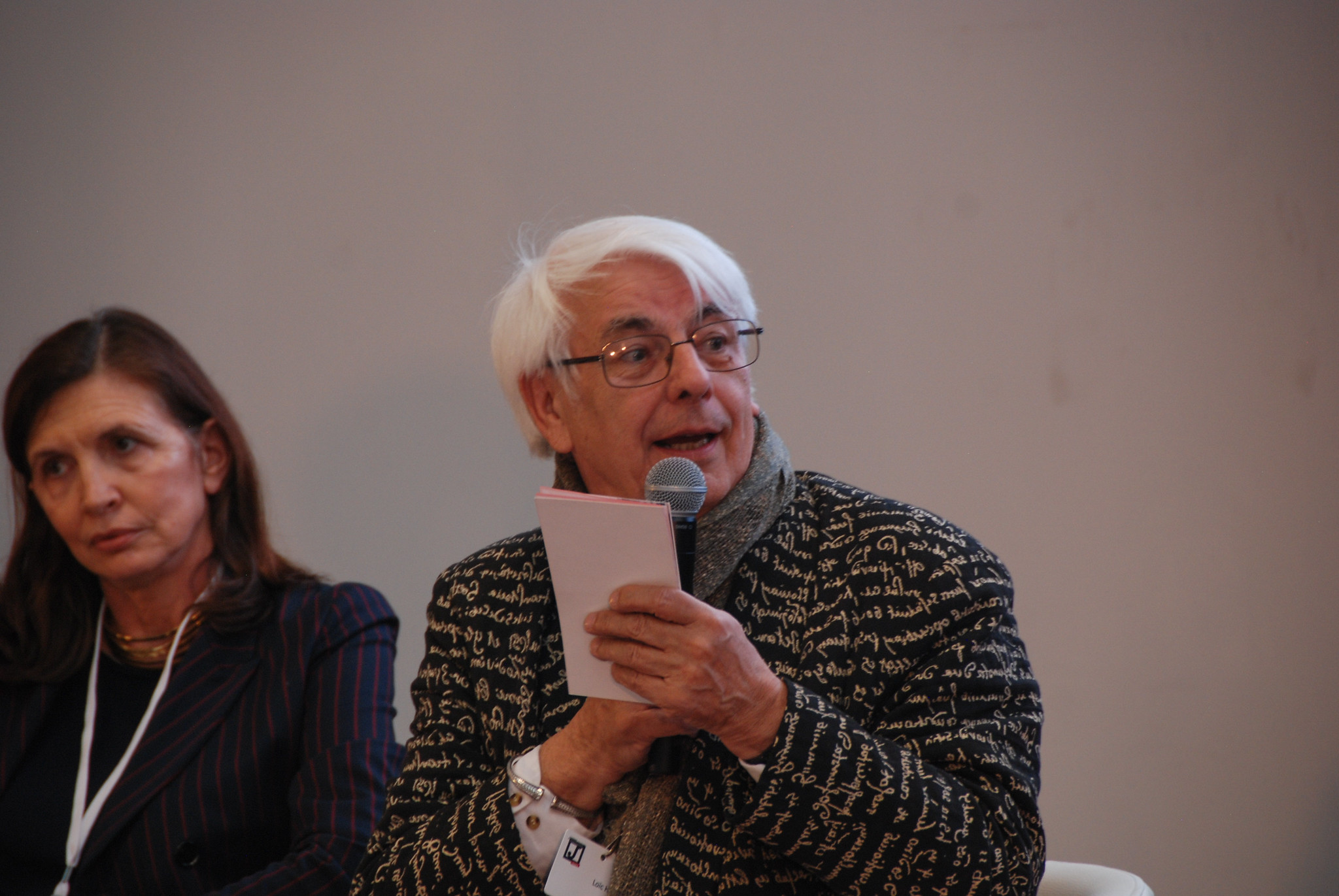
(Photo : Laurent Théoret)
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Un comité d’éthique des médias d’information en France ? »
Animé par Loïc Hervouet, ancien directeur de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et ex-médiateur de RFI ; avec Patrick Eveno, président de l’Observatoire de la déontologie de l’information ; Emmanuel Hoog, ancien PDG de l’INA et de l’AFP, chargé de mission sur la création d’un conseil de déontologie de la presse ; Michèle Leridon, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et Vincent Lanier, premier secrétaire général du SNJ.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019
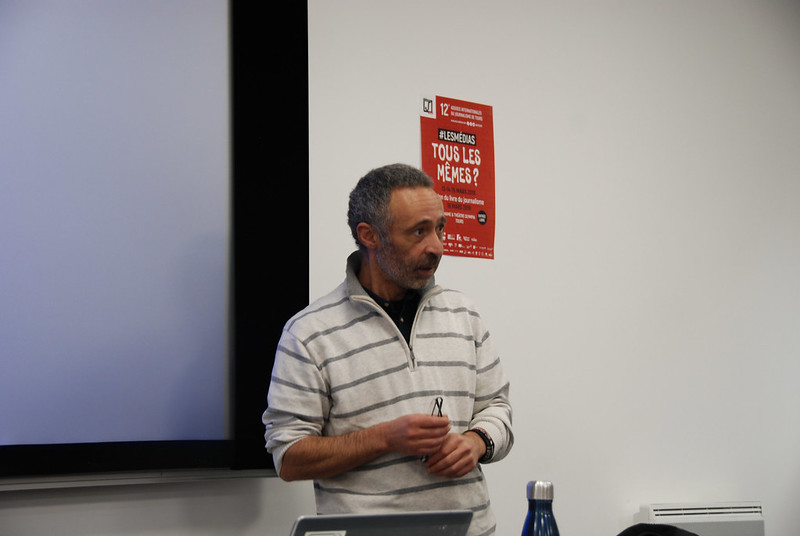
( Photo : Laurent Théoret )
Retrouvez l’essentiel du workshop « Osint, une aide précieuse pour le journalisme »
Animé par Jean-Marc Bourguignon, co-fondateur et secrétaire général de Nothing2Hide.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Emmanuel Haddek)
Retrouvez l’essentiel de la conférence Femmes dans les médias : bientôt l’égalité et la fin du harcèlement ?
Animé par François QUINTON, chef de service à INA Global. Avec Béatrice DAMIAN-GAILLARD, professeure d’université en info-com à Rennes ; David DOUKHAN, chercheur en informatique à l’INA ; Léa LEJEUNE, présidente du collectif Prenons la Une et journaliste chez Challenge ; Elsa FREYSSENET, journaliste aux Échos. (suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence « Présentation du rapport 2019 de l’Observatoire de la déontologie de l’information »
Animé par Patrick Eveno, président de l’Observatoire de déontologie de l’information, avec Pierre Ganz, vice-président de l’Observatoire de déontologie de l’information ; Christel Leca, journaliste et Véronique Richard, membre de la Société des lecteurs du Monde.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Écrit par Anne-Sophie Novel et co-réalisé par Flo Laval.
SYNOPSIS
Dans ce film documentaire, la journaliste Anne-Sophie Novel explore les raisons du malaise exprimé par le public face aux médias. Elle explore la manière dont les journalistes façonnent notre monde à travers ses rencontres avec des professionnels dans le monde entier. Elle tente aussi de donner espoir en ce métier en pleine mutation en présentant différentes façons de faire pour changer notre rapport à l’actualité.
LES RÉACTIONS
Une passante : « Je suis dégoutée des médias, je ne m’informe pas. »
Yves Citton, théoricien de la littérature : «Nous sommes perdus dans cette surabondance de choses et on ne sait plus faire la différence. »
Sean Dagan Wood, éditeur au journal Positive News : « Je suis excité que les anciens modèles journalistiques ne fonctionnent plus, car cela nous force à nous renouveler et à nous engager avec notre public. »
Damien Allemand, chef du service digital Nice-Matin : « On invite nos lecteurs à choisir le thème de nos grands dossiers et à participer à l’enquête. Dans les premiers temps, on n’a pas réussi à diagnostiquer une seule fois le thème choisi par les abonnés et ça pose des questions sur le métier de journaliste. »
Ulrik Haagerup, journaliste : « On pense que notre travail est de seulement parler des malheurs, des famines et des guerres. »
Ann-Sophie GRAVEL
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence « Intelligence artificielle : Les robots sont-ils nos amis ? »
Animé par Capucine Cousin, journaliste économique, avec Benoît Raphaël, journaliste et éleveur de robots ; Claude de Loupy, co-Fondateur de Syballis et Éric Scherer, directeur de la prospective à France Télévisions.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Laurent Théoret)
Retrouvez l’essentiel de la conférence: «Présentation de trois initiatives médias / quartiers populaires»
Animé par Latifa Oulkhouir, directrice du Bondy Blog, avec Éric Briat, adjoint du directeur de la ville et de la cohésion urbaine au CGET ; Driss Ettazaoui, président de Villes & Banlieues ; Maxime Daridan, journaliste à BFM TV ; Erwan Ruty, directeur du Medialab93 et fondateur de Presse & Cité ; Guillaume Villemot, cofondateur de Bleu Blanc Zèbre. (suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence « Le département invité des assises 2019 : Mayotte »
Animé par Nassira Elmoaddem, journaliste, avec Kalathoumi Abdil-hadi, journaliste et cofondatrice de 101Mag, Abby Said Adinani, directrice du magazine May’People et correspondante locale du Bondy Blog, Chamsudine Ali, journaliste Mayotte la première, Pierre Bellusci, journaliste reporter d’images et rédacteur en chef de Kwezi TV, Laurent Canavate, co-fondateur et directeur de Somapresse.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence « #lesmédias. Atelier Recherche : Diversité des journalismes et pluralisme de l’information. »
Animé par Béatrice Damian-Gaillard, professeur des universités en sciences de l’information et de la communication à l’université Rennes 1, avec Faïza Nait-Bouda, maître de conférences en sciences de l’information et de l’information à l’université Nice Côtes d’Azur et au sein du Laboratoire Sic.Lab ; Mathieu Maire du Poset, directeur Le Tank Média ; Jérôme Pacouret, postdoctorant à l’IRMECCEN (Institut de recherche Médias, Cultures, Communication et Numérique) (université Paris 13) et docteur associé au CESSP (Centre européen de sociologie et de science politique) ; Olivier Pilmis, chargé de recherches au CNRS et chercheur au Centre de sociologie des organisations (Sciences Po / CNRS). (suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Laurent Théoret)
Animé par Isabelle Marcin-Garrou, professeure en sciences de l’information et de la communication à Sciences po Lyo ; avec Claire Blandin, professeure en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris 13 ; Gilles Bastin, professeur de sociologie à l’université Grenoble Alpes et Alexis Levrier, maître de conférences à l’université de Reims, chercheur associé et spécialiste de l’histoire de la presse.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Emmanuel Haddek)
Retrouvez l’essentiel de l’atelier «La data au service de l’investigation»
Animé par Marthe Rubio, journaliste responsable de la région francophone chez Global Investigative Journalism Network. Avec Karen Bastien, datajournaliste et cofondatrice de Webodata. Jean-Marc Bourguignon, cofondateur et secrétaire général de Nothing2Hide. Edouard Perrin, journaliste à Premières lignes. Sandrine Sawadogo, journaliste d’investigation à l’Economiste du Faso.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019, Uncategorized

Retrouvez l’essentiel de la conférence « Quel récit éditorial ultramarin en métropole ? »
Animé par la journaliste Nassira El Moaddem, avec Dominique Fossé, rédacteur en chef de l’actualité ultramarine de France Télévisions ; Nathalie Sarfati, grand reporter à France O, Faïd Souhaïli, journaliste à 101Mag ; Memona Hintermann, grand reporter et Cécile Azzaro, journaliste à l’AFP.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence « Débat : #lesmédias. Les réseaux sociaux contre la démocratie ? »
Animé par Amaëlle Guiton, journaliste à Libération, avec Valérie Jeanne-Perrier, enseignante et chercheuse au Celsa, Samuel Laurent, responsable des Décodeurs du Monde, Tristan Mendès-France, enseignant au Celsa et maître de conférences à Paris Diderot spécialisé dans les cultures numériques, Marie Turcan, rédactrice en chef adjointe à Numerama.
(suite…)
14 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence #LESMÉDIAS. JOURNALISME ET « GILETS JAUNES »
Animé par Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde et présidente du jury des Assises. Avec Rémy Buisine, reporter pour BRUT ; Gabin Formont, fondateur de Vécu, le média du gilet jaune ; Arnaud Mercier, professeur en communication université Paris 2-Assas, directeur des études de l’IFP, chargé de mission au HCERES ; Coralie Pierre, journaliste et membre du collectif « Paye toi un journaliste » ; Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM. (suite…)
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Dis huit nommés pour recevoir un des six prix émis et décernés par les Assises et ses partenaires. Une belle occasion de découvrir la diversité des initiatives, de les partager, de s’en inspirer ou de s’y associer. Après discussion avec le Jury et ses partenaires, la décision est prise. Le président du jury, Harry Roselmack a commencé par un petit discours en citant Victor Hugo, avant de passer aux délibérations.
« Comme a dit Victor Hugo : « Je porte un toast à la presse chez tous les peuples, à la presse libre, puissante, glorieuse, et féconde, (…) la presse est la clarté du monde social. De tous les cercles, de tous les rayonnements humains, la presse en est le centre. Là ou la presse libre est interceptée, la nutrition du genre humain est interrompue. La presse est la force parce qu’elle est l’intelligence. (…) Je le sais la presse est haïe, c’est là une raison de l’aimer ». »
Prix éducation aux médias et à l’information pour la meilleure initiative associative et citoyenne :
Traces d’Italie. « La solidarité intergénérationnelle très forte arrive à transmettre l’Histoire parfois oubliée. » (Jury)
Prix éducation aux médias et à l’information pour la meilleure initiative dans un média francophone :
Rue 89 Strasbourg. « L’éducation à double sens réussi : les journalistes apprennent autant que les particuliers apprennent des journalistes. Interviewer des habitants de quartiers souvent stigmatisés montre la volonté de casser les clichés. » (Jury)
Prix éducation aux médias et à l’information pour la meilleure initiative hors-école :
Cartooning for peace, déjà présent sur France Inter en direct pour illustrer l’actualité, ils reçoivent leur premier prix des Assises.
Prix éducation aux médias et à l’information pour la meilleure initiative dans le milieu scolaire :
Jeunes reporters en Europe. (non présents)
Prix éducation aux médias et à l’information pour la meilleure initiative en région Val de Loire :
Club de presse Ecole de Jean Zay : « C’est une grande fierté d’avoir dans cette région une jeunesse qui n’est pas passive mais dynamique ambitieuse et talentueuse, contrairement à ce que certains pourraient dire. » (Jury)
Prix éducation aux médias et à l’information pour la meilleure initiative sur la rive Sud de la méditerranée :
Hicham Houdaïfa « Openchabab ». « Ces valeurs d’égalité homme-femme, de mixité sociale et de volonté de progrès social sont en adéquation avec celle du journalisme que nous promouvons » (Jury)
Benjamin Baixeras
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Lorène Bienvenu)
Retrouvez l’essentiel de la pièce de théâtre « Infox, rumeur et dépendance : une création originale des assises et de la ligue d’improvisation de Touraine ».
Animé par la Ligue d’Improvisation de Touraine et l’association « Journalisme & Citoyenneté ».
(suite…)
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence « #lesmedias Tous les mêmes ? » côté sud
Animé par la journaliste Stéphanie Wenger, avec Assil Frayha, journaliste à Mégaphone (Liban), Omar Belhouchet, propriétaire d’El Watan (Algérie), Hasna Belmekki, journaliste freelance (Maroc), Younes Boumehdi, animateur à Hit Radio (Maroc), Rym Ben Arous, journaliste à Le temps (Tunisie) et Malek Khadhraoui, rédacteur en chef d’Inkyfada (Tunisie).
(suite…)
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

David Dieudonné de Google News Initiative (Photo : Lorène Bienvenu)
Retrouvez l’essentiel du workshop «Quels outils de fact-checking pour couvrir la campagne européenne?
Animé par David Dieudonné, Google News Lab lead, France
(suite…)
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence «EMI : l’éducation populaire mobilisée»
Animé par Emmanuelle Daviet, médiatrice des antennes de Radio France, François Laboulais, responsable du Pôle Médias, Numérique, Éducation Critique et Engagement Citoyen – Cemea (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active) ; Olivier Magnin, délégué Pôle Education à l’image et aux médias Image’IN – Ligue de l’enseignement de l’Oise ; Hervé Prévost, directeur national de programme chez Fédération nationale des Francas ; Maïka Seguin, chargée de mission à la Fédération régionale ADL PACA (Animation & Développement Local Provence-Alpes-Côte d’Azur) et chargée du développement éducation aux médias et à l’information pour la CMJCF (Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France).
(suite…)
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence « #LesMédias. Podcast : Quand la presse papier monte le son »
Animé par Cyril Petit, rédacteur en chef central et secrétaire général de la rédaction du JDD. Avec Maëlle Fouquenet, journaliste et responsable des formations numériques à l’ESJ Pro. Delphine Noyon, directrice adjointe de la Nouvelle République. Thomas Oliveau, rédacteur en chef adjoint de l’Equipe. Edouard Reis Carona, rédacteur en chef délégué au numérique et à l’innovation, Ouest-France. Joël Ronez, fondateur de Binge Audio.
(suite…)
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

(Photo : Suzanne Rublon)
Retrouvez l’essentiel de la conférence « Les entretiens de l’Information: ils se sont lancés… et ça n’a pas marché »
Avec Claire Berthelemy, cofondatrice de L’imprévu, formatrice et consultante ; Candice Marchal, journaliste et cofondatrice de BoxSons ; Julien Mendez, confondateur et CEO de Vraiment ; Manuel Sanson et Gilles Triolier, confondateurs de Filfax ; Steven Jambot, ancien rédacteur en chef adjoint de Mashable. Animé par Jean-Marie Charon et Cyrille Franck, respectivement sociologue des médias et directeur de l’ESJ Pro.
(suite…)
13 Mar 2019 | Les résumés, Tours 2019

Retrouvez l’essentiel de la conférence «#lesmédias Les médias alternatifs: une information différente?»
Animé par Thierry Borde, président de Médias Citoyens, avec Sébastien Boistel, journaliste à Ravi, Lisa Giachino, rédactrice en chef à l’Age de faire, Eloïse Lebourg, journaliste à Médiacoop, Emile Palmantier, coordinateur éditorial et médiatique à Radio Campus.
(suite…)