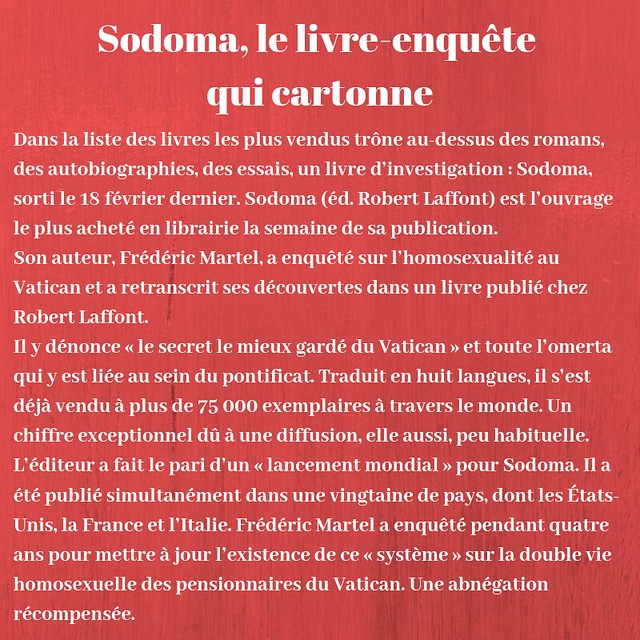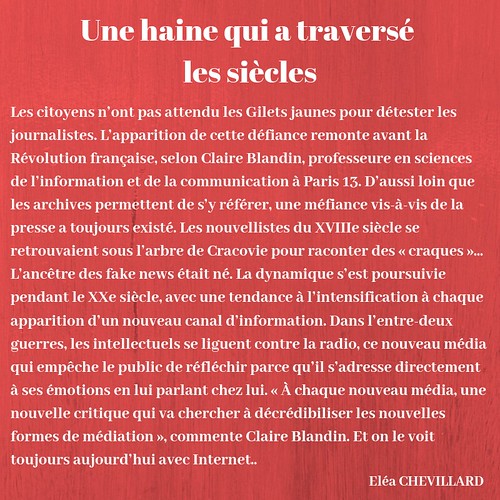28 Mar 2024 | Focus, Les enquêtes, Tours 2024
Le photojournaliste gazaoui Motaz Azaiza à Gaza le 8 octobre. Il publie cette photo dans un post Instragram dans lequel il précise « Je suis disponible pour des missions ». Photo : Motaz Azaiza/Instagram.
Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier, les médias français couvrent la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Mais l’impossible accès à la bande de Gaza et le déséquilibre entre les moyens de communication du gouvernement israélien et des Gazaouis complique le travail.
Fake news autour des 40 bébés décapités par le Hamas le 7 octobre, incertitude quant à l’origine de l’explosion de l’hôpital al-Ahli : ces deux exemples illustrent la difficulté rencontrée par les médias pour recouper l’information dans ce nouvel épisode du conflit israélo-palestinien.
Sans accès à la bande de Gaza – hormis sous la surveillance et avec l’autorisation de l’armée israélienne, les journalistes sont contraints d’adapter leur pratique pour continuer d’informer. « Nous avons étoffé notre cellule de vérification des images, explique Guillaume Debré, directeur adjoint de la rédaction de TF1. Les images que nous trouvons sur les réseaux sociaux, par exemple, y sont toutes analysées avant diffusion. » Un moyen d’éviter le relais de fausses informations autant que de pallier le manque de correspondants sur place.
Pour Patrick Sauce, du service international de BFM TV, cette authentification des images reste insuffisante. « Les images relayées par les civils ou les journalistes depuis l’intérieur de Gaza sont sujettes à la pression du Hamas. Je ne remets pas en cause le travail de tous mes confrères mais les erreurs d’attribution de l’explosion de l’hôpital al-Ahli prouvent qu’il faut se méfier des images filmées sur le terrain. » Questionné sur les images filmées par les Gazaouis et relayées par des médias comme Al-Jazeera, il questionne à son tour les moyens employés par la chaîne. Et évoque les contrats d’exclusivité d’autres chaînes qui lierait les correspondants gazaouis à certains médias.
Un biais dans la couverture médiatique ?
Patrick Sauce admet néanmoins un déséquilibre dans cette guerre de l’information. « Israël a la 5G, c’est le pays de la tech. Ils ont les moyens techniques pour communiquer. Alors qu’aujourd’hui, sans électricité, les Gazaouis peinent ne serait-ce qu’à envoyer des messages vocaux. »
Pour autant, il ne ressent pas le malaise de certains journalistes de la rédaction de TF1 elle-même, que décrivait un article du média en ligne Blast en novembre dernier. « J’ai un peu de mal avec l’idée que nous aurions un biais pro-israélien dans notre couverture, estime Patrick Sauce. Nous avons fait des reportages sur les enfants palestiniens réfugiés en France et nous parlons souvent de l’extrémisme de Benyamin Netanyahou en plateau. S’il existe un biais, il est plutôt en défaveur des Israéliens pour lesquels l’opinion a perdu en empathie. »
Un argument qui ne convainc pas Daniel Schneidermann, fondateur du média en ligne Arrêt sur images. « Il existe un biais presque irrésistible qui ne relève pas de l’intention mais plutôt de la proximité globale des médias traditionnels avec Israël. » Il dénonce ainsi un « deux poids deux mesures » dans le choix des mots utilisés par les journalistes. Tandis que les agences de presse internationales différenciaient les « civils » des « soldats » israéliens tués par le Hamas le 7 octobre, les pertes du côté palestinien dans la réplique du 8 octobre restaient indéfinies.
« Rester honnête »
Mais d’où viendrait ce biais, si tant est qu’il existe ? « Les Israéliens sont plus proches culturellement des Occidentaux, avance Daniel Schneidermann. Ils ont une démocratie comme nous, une presse libre d’expression et une société civile qui critique le pouvoir. Il est plus aisé de s’identifier à eux qu’aux Palestiniens.»
Alain Gresh, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique et fondateur du magazine Orient XXI, confirme : « Les médias parlent souvent du nombre de Palestiniens tués, mais il est difficile de s’identifier à un chiffre. Il nous faut des histoires, des portraits de famille pour comprendre ce que signifie 20 000 morts. » Diplômé de l’Ecole des hautes études en sciences sociales et spécialiste de la question israélo-palestinienne, il relève aussi un changement dans la lecture du conflit. « Depuis 2001 et le début d’une lutte mondiale contre le terrorisme, la lutte palestinienne est davantage perçue comme un phénomène terroriste par les pays occidentaux. En France, le gouvernement est passé d’un rôle de négociateur, voire de soutien aux revendications des Palestiniens, à un soutien affiché à Israël. » Et Daniel Schneidermann de compléter : « Dans toute guerre, les médias ont tendance à épouser la position diplomatique de leur pays. »
Une affirmation que réfute Patrick Sauce, qui insiste sur sa connaissance du terrain. Comme en écho, Guillaume Debré rappelle le nombre de journalistes de guerre dans sa rédaction. « Il faut avant tout traiter les faits et ne pas tomber dans l’éditorialisation. Rester honnête. » Un objectif que tous partagent. Encore faudrait-il s’entendre sur la définition du terme…
Mourjane Raoux-Barkoudah/EPJT
28 Mar 2024 | Les enquêtes, Tours 2024
Illustration : Lune ARMAND/EPJT
Trois ans après le documentaire choc de Marie Portolano, la situation des femmes journalistes de sport a-t-elle vraiment évolué? Pas si sûr… La course continue
« Le combat sera gagné quand il sera devenu inutile d’en faire un film ». C’est ainsi que Marie Portolano conclut son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste (Canal+, 2021). Mais voilà que, trois ans plus tard, elle relance la machine et sort un livre, Je suis la femme du plateau. Un livre qu’elle décrit comme un objet qui reste dans le temps, qui ne pourra pas être effacé, parce que pour elle : « Dans le milieu du journalisme sportif, oui, il y a encore des choses à dire.»
Si la parité est globalement respectée dans le journalisme, ce n’est pas le cas au sein des rédactions de sport. En 2022, une étude menée par la chercheuse Sandy Montanola démontrait que les rédactions sportives comptaient seulement 15 % de femmes. Un déséquilibre ressenti par celles qui sont présentes dans ces bureaux. Discrimination, harcèlement, décrédibilisation… Plusieurs journalistes sportives ont témoigné.
Infographie : Lucas GAULT/EPJT
En 2021, l’association Femmes journalistes de sport (FJS) décide d’occuper le terrain face aux discriminations, au manque de reconnaissance et aux nombreuses injustices que subissent les femmes dans le milieu du journalisme sportif. « Le monde du sport a historiquement été fondé par et pour des hommes. Les femmes ont toujours dû se battre pour être des athlètes, pour pratiquer, pour diriger et pour arbitrer du sport. Il en va de même pour les femmes journalistes », déplore Mejdaline Mhiri, journaliste, co-présidente et membre fondatrice de FJS. Elle ajoute que « les jeunes se détournent du sport car elles se sentent moins compétentes face à leurs homologues masculins, qui font du foot depuis 15 ans et qui regardent tous la Ligue 1 ». La peur de ne pas être à sa place en tant que femme est un facteur d’auto-censure pour les femmes journalistes. « Le documentaire a eu le mérite de souligner des faits qui étaient problématiques dans les rédactions sportives, dont on n’a pas forcément connaissance quand on est un homme », reconnaît le directeur de la rédaction de L’Équipe, Lionel Dangoumau.
Un début de changement
Dans le film de Marie Portolano et Guillaume Priou, plusieurs générations de journalistes sont présentées. Frédérique Galametz est l’une de ces défricheuses du journalisme sportif féminin. Première femme rédactrice en chef à L’Équipe, elle décrit une avancée depuis la sortie du documentaire: « Il a fait ouvrir les yeux à certains qui ne les avaient pas encore ouverts et a amené à s’interroger sur des comportements. » En effet, une charte interne a été signée dans certaines rédactions, comme à L’Équipe ou à beIN, qui vise à mieux représenter les femmes dans les médias sportifs. Des référents « harcèlement sexuel » ont également été désignés. En parallèle, l’association FJS a mis en place un système de marrainage entre journalistes expérimentées et débutantes. Margot Dumont, journaliste à beIN Sports, souligne son rôle crucial : « Maintenant, l’association FJS est là pour nous soutenir. Donc, si on perd un emploi parce qu’on a osé parler, ne vous inquiétez pas, elles sont 170 derrières à monter au créneau pour nous ! »
Mais la vraie victoire, c’est la libération de la parole dans les équipes, avec une nouvelle génération de journalistes qui débarque au sein des rédactions. Charlotte Namura, ex-journaliste chez TF1, qui a participé au documentaire, constate un nouveau souffle à Téléfoot : « Au sein de la rédaction, il y a eu un vrai roulement. Pour avoir parlé avec d’anciens collègues, ils m’ont dit qu’il y avait plus de femmes aujourd’hui. Ça s’est aussi rajeuni, on trouve des journalistes plus à même d’être à l’écoute. » De plus en plus de femmes dans les rédactions donc, c’est ce que confirme Lionel Dangoumau: « Je pense que c’est quand même plus facile d’être une femme chez nous, aujourd’hui, qu’il y a 20 ans. Parce qu’elles sont déjà plus nombreuses dans la rédaction. » Il estime à un peu moins de 20 % l’effectif de femmes dans son entreprise. Encore trop peu, malgré tout, pour cet ancien chef du service football, qui aimerait mettre des choses en place dans le recrutement.
Effort collectif
À L’Équipe, deux des dix postes de rédacteurs en chef sont occupés par des femmes. Lionel Dangoumau explique cette proportion par le poids de l’histoire : « L’Équipe est historiquement une rédaction assez masculine.» Une raison qui ne convainc pas Mejdaline Mhiri, qui pense que « les rédacteurs en chef se servent du manque de candidatures féminines comme excuse pour garder des équipes très majoritairement masculines ». Elle souffle, puis poursuit : « Les rédactions sont tellement disproportionnées qu’il faudrait que l’embauche des femmes devienne un critère lors du recrutement.»
Aujourd’hui , l’écart subsiste, mais se resserre. Toutes les journalistes se rejoignent : cela ne doit plus être un sujet. Charlotte Namura est optimiste : « J’espère pour la génération suivante de femmes journalistes sportives qu’elles n’auront plus à se poser la question de leur place. Qu’elles puissent arriver sereinement le matin au travail.» Un objectif plutôt simple, a priori, où la question du genre ne rentre plus en jeu : « Moi, je ne veux pas prendre une place, je veux juste que tu te pousses un peu du canapé. Parce que je suis assise sur l’accoudoir, en fait. Ce n’est pas normal. Le canapé, il est à partager. Donc, tout le monde doit faire un effort.»
Clara DEMAJEAN, Lucas GAULT et Emma SIKLI/EPJT
27 Mar 2024 | Focus, Les enquêtes, Tours 2024
L’Association intergénérationnelle de La Rabière est une radio locale de Joué-lès-Tours qui se veut collaborative. Nezrina Prelic, Sylvie Aliti, Karim Arbia et Bertino Pinas sont au micro. Photo : Julien Grohar/EPJT
Dans les médias, les quartiers populaires sont régulièrement racontés sous l’angle du fait divers. A Tours, des médias citoyens tentent de porter la voix des quartiers.
Depuis l’arrêt de tram Jean-Jaurès, au cœur de Tours (Indre-et-Loire), cinq minutes de transport suffisent pour arriver au Sanitas. Rien de plus simple, mais il semblerait que les journalistes trouvent difficilement leur chemin jusqu’à ce quartier populaire du centre-ville. Ingrid Chemin, employée au centre social Pluriel(le)s, le déplore. En juin 2023, lorsque les premières révoltes urbaines gagnent Tours, après la mort de Nahel Merzouk, son lieu de travail menace d’être incendié. Elle s’apprête à partir lorsque des journalistes de La Nouvelle République (NR) débarquent pour couvrir l’événement. Lorsque le calme revient, aucun reporter ne songe à l’interroger. Elle regrette que le journal ne vienne « que quand ça crame ». Excepté les faits divers, « il peut se passer des semaines sans que l’on entende parler du Sanitas ».
De l’autre côté du Cher, Burhan Aliti fait un constat similaire. Président de l’Association Intergénérationnelle de la Rabière, il a été marqué par le traitement médiatique d’un fait divers qui a touché son quartier de Joué-lès-Tours en 2014. Un jeune homme qu’il connaissait a été tué par des policiers après les avoir attaqués au couteau. BFMTV avait diffusé des témoignages de personnes se présentant comme amies du défunt. Sur la seule vidéo trouvée sur la chaîne YouTube de la rédaction, le visage du témoin est dissimulé et sa voix modifiée, mais Burhan Aliti est catégorique : « Ce n’était pas ici, ce n’est pas notre quartier, ce n’est pas dans Joué-lès-Tours. » Pour parler de juin 2023, il ne révoque par le terme d’émeutes car « ce qu’il s’est passé, c’est de l’auto-destruction […] c’est une émotion ». Il déplore en revanche que les médias ne se soient pas davantage penchés sur la dimension sociale de l’événement, rapportant essentiellement les scènes de violences et les classant dans la rubrique faits divers. « C’est comme si vous aviez quelqu’un dans votre salon qui était en train de se tailler les veines et que vous détourniez le regard », illustre-t-il.
À La Rabière, les habitants ont rebaptisé le quotidien régional « La Nouvelle répugnante » et détournent globalement leurs regards des colonnes du journal. Le manque de points de distributions de la presse papier dans les quartiers populaires et le coût du journal à l’unité (1,50 €) ou à l’abonnement (40,70 € par mois pour le print et le web) s’ajoutent à une confiance en déclin. Les quartiers populaires de la métropole tourangelle ne sont pas censés passer sous les radars de ce journal. Alexandre Métivier, journaliste pour les pages de Joué-lès-Tours de la NR, se défend : « Ceux qui pensent que la NR vient uniquement lorsque les voitures brûlent sont ceux qui ne lisent pas le journal. » Le reporter reconnaît toutefois ne « pas avoir accès à tous les interlocuteurs » lorsqu’il se rend sur le terrain, car « beaucoup de personnes ne souhaitent pas répondre aux journalistes. »
Des représentations négatives
Pour Sarah Rétif, sociologue à l’université de Tours spécialiste de l’engagement des femmes dans les quartiers populaires, « les médias classiques entretiennent des représentations négatives, stéréotypées autour de l’idée d’anomie, de dangerosité, de délinquance ou même de montée du communautarisme et de l’islamisme ». Sanitas comme La Rabière sont classés quartiers prioritaires de la métropole de Tours. Ils abritent une forte densité de population aux revenus proches du seuil de pauvreté. La spécialiste précise que la stigmatisation des quartiers populaires est aujourd’hui « contestée par les travaux sociologiques qui montrent justement l’épaisseur sociale et historique de ces quartiers ». Pour inverser la tendance, améliorer l’image de leurs quartiers et se réapproprier l’espace de parole, des habitants prennent part à des initiatives de médias participatifs. Pepiang Toufdy, le fondateur du média citoyen Wanted TV, a mis un point d’honneur à installer son nouveau projet dans un grand appartement du centre historique de Tours : « Je veux que les jeunes sortent des quartiers. »
Sa Fabrique d’images citoyenne va proposer des ateliers d’éducation aux médias (ÉMI). Il a envie d’aller plus loin, en aidant les jeunes à « mieux comprendre la fabrication médiatique. » Wanted TV est un média aux 17 000 followers sur Instagram, à la ligne éditoriale urbaine, qui comble ce que son créateur décrit comme un vide : « Les médias ne sont pas partout. Ils ne peuvent pas tout couvrir. Donc il fallait avoir un média de proximité. » Ce média diffuse aussi sur TV Tours des reportages réalisés tout au long de l’année par ces jeunes, accompagnés d’un journaliste reporter d’images.
Journal de quartier
De l’autre côté de la gare, autour de la place Neuve et des grands ensembles, Ingrid Chemin et d’autres travailleurs sociaux ont repris « le journal de quartier », le Sanitamtam, qui existe depuis 20 ans. L’objectif est de publier quatre numéros par an pour couvrir l’actualité du Sanitas différemment. Cependant, le manque de budget, les difficultés à trouver des contributeurs et des lecteurs rendent la cadence difficile à tenir. « Les médias citoyens restent fragiles car soumis à des subventions publiques aléatoires », explique la sociologue Sarah Rétif. Malgré le manque de moyens, la volonté du monde associatif de porter la parole des habitants a continué de s’amplifier depuis juin 2023. À La Rabière, Burhan Aliti envisage aussi de mener des projets avec Pepiang Toufdy et tente de faire vivre une webradio de quartier ouverte à tous. Entre médias citoyens, la solidarité prévaut sur la concurrence. « On a trop souvent parlé à notre place, dit-il. Il fallait être notre propre média. »
Camille AMARA, Susie BOUYER et Marie-Camille CHAUVET/EPJT
27 Mar 2024 | Focus, Les enquêtes, Tours 2024
Les évènements d’esport rassemblent des dizaines de milliers de personnes de façon constante. Photo : Flickr/EPJT
L’esport est un domaine en pleine explosion mais il peine encore à s’affirmer dans les rédactions de presse nationale. De leur côté, les grands médias adoptent des stratégies qui divergent.
50 000 billets en quatre jours, 12 000 spectateurs pour la finale à Bercy, victoire d’une équipe française… Mais seulement 200 signes dans le journal l’Équipe du 22 mai 2023. Avec de telles statistiques, n’importe quelle compétition sportive aurait bénéficié d’une couverture spéciale. Du moins n’importe quelle compétition de sport traditionnel… Car ces chiffres, ce sont ceux de la finale du major de Counter-Strike à Paris en mai dernier. Si l’esport a déjà conquis un public large, les grands médias de presse nationale peinent encore à y accorder un suivi conséquent.
Il serait faux de dire que ces derniers ne sont pas sensibles au raz-de-marée que représente l’esport. La finale du major représente même un marqueur de ce développement, que ce soit du point de vue des publics, mais aussi des médias. Plusieurs journalistes, y compris des rédacteurs en chef – à l’Équipe, au Monde ou au Figaro – témoignent de l’importance de l’évènement : « Il faut le voir de ses propres yeux pour se rendre compte de l’ampleur du phénomène et de la popularité des joueurs », raconte Paul Arrivé de l’Équipe, seul journaliste 100 % esport dans les médias de Presse quotidienne nationale (PQN).
L’esport comme laboratoire
Mais c’est le traitement qu’on accorde à l’esport qui pose encore question dans les rédactions. Surtout pour les grands médias de PQN, habitués aux longs textes qui peuvent faire peur au public de l’esport. « Il y a deux barrières qui se posent pour les jeunes qui suivent l’esport : l’habitude de la gratuité et la barrière psychologique des articles payants, puis le rapport à la lecture difficile pour la plupart », évoque Paul Arrivé. Pour lui, cette génération ne basculera pas vers la presse écrite : « Il faut qu’on se révolutionne. Je vois l’esport comme un laboratoire pour le journalisme, car c’est l’avenir de la profession qui se joue ici. Il faut tenter des nouveaux formats, avec de la vidéo notamment, si on veut toucher cette génération. Il faut faire le pari maintenant parce que ce sont eux les futurs consommateurs. »
Entre le journaliste, qui essaie d’anticiper, et ses supérieurs, les visions ne sont pas forcément les mêmes. « On fait nos calculs et on se méfie beaucoup de la gratuité. Oui, c’est bien mais les formats vidéo sont difficilement rentables. La presse écrite ne va pas bien mais on ne peut pas se lancer partout, embaucher plus de spécialistes esport etc. », justifie de son côté Jean-Philippe Leclair, rédacteur en chef-adjoint de l’Équipe.
La quête de la rentabilité freine beaucoup ces médias. Si l’esport dispose d’une vraie audience, ce n’est pas encore suffisant pour des journaux comme Le Figaro. « Tant que mes articles ne rapportent pas d’abonnements, on ne va pas se lancer à fond sur le sujet », souffle Cédric Cailler, qui reste très pragmatique sur la situation. « L’esport n’est pas encore assez structurant socialement et économiquement. Ça reste un domaine en construction. Même si c’est massif en audience, il y a encore beaucoup d’interrogations », ajoute Olivier Clairouin, chef du service Pixels du Monde.
Fossé générationnel
Certains médias ne cherchent pas forcément à attirer un nouveau public, mais plutôt à parler de ces thématiques à leurs lecteurs. « Les articles sont plutôt adressés aux parents, pour qu’ils comprennent ce à quoi s’intéressent leurs enfants », témoigne Olivier Clairouin. Le quotidien reste fidèle à sa ligne éditoriale quand il traite de l’esport. Les articles vont au-delà de l’aspect purement sportif et évoquent tout ce qui englobe l’univers esportif, que ce soit de façon économique, écologique, politique ou sociale. Une vision que partage Jean-Philippe Leclair : « On a l’ambition de couvrir tout le sport : du joggeur à Kylian Mbappé, en passant par le dopage et l’esport. Le fait de traiter l’esport comme n’importe quel autre sport, cela nécessite de l’évoquer sous tous les angles possibles. Pas seulement les résultats. » Cédric Cailler du Figaro s’adapte aussi à son journal : « Je cherche beaucoup l’humain dans mes sujets, sur des portraits notamment. Puis je parle souvent de chiffres, ou de « success story ». Je m’adapte à mon public. »
Cette question des publics visés est difficile. Si Le Monde ou Le Figaro s’adressent majoritairement à leurs lecteurs, Paul Arrivé a pour stratégie d’aller chercher le public de l’esport : « J’ai abandonné l’idée de toucher le grand public. C’est tellement complexe et le fossé générationnel est trop grand. Je pense qu’on ne convaincra jamais tout le monde. J’essaie de plus en plus de faire des sujets de profondeurs, qui apportent de la valeur ajoutée à ceux qui suivent l’esport. Le but, c’est de les attirer ensuite vers la marque l’Équipe, car ce public s’intéresse au sport en général. »
Mais si les articles paraissent sur le web, très peu arrivent dans les pages du journal. « Je trouve ça dommage car notre rôle est aussi d’éduquer le grand public sur ce qu’il se passe dans la scène sportive, et l’esport en fait partie. J’ai un peu arrêté de me battre pour cela, mais avoir 200 signes sur le major CS (Counter-Strike, ndlr) à Paris je ne trouve pas ça normal. Ça fait six ans qu’on ne s’est pas renouvelé sur le traitement de l’esport », se désole le journaliste de l’Équipe.
Le traitement médiatique de l’esport dans les grands médias de PQN relève d’une problématique bien plus générale à la profession : comment toucher un public jeune, qui boude ces journaux mais qui représentera bientôt la majorité de la population ? D’un sujet niche, l’esport devient petit à petit un sujet central que les rédactions observent de plus en plus près, véritable reflet de la fracture générationnelle dans les médias.
Jules Bourbotte et Florian Pichet/EPJT
27 Mar 2024 | Focus, Les enquêtes, Tours 2024
Photo : Julien GROHAR/EPJT
À quatre mois des jeux de Paris 2024, les rédactions se préparent à couvrir l’événement. Qui pourra assister aux épreuves ? Une commission composée en partie de journalistes aide à la distribution des accréditations.
Tous les quatre ans, à l’approche des Jeux olympiques, les rédactions des grands médias sont traversées d’un insoutenable suspense : à qui le CIO (Comité international olympique) distribuera-t-il les fameuses accréditations, précieux sésame pour couvrir l’événement mondial ?
À chaque édition, le CIO délivre davantage d’accréditations au pays organisateur. Sur les 6 000 délivrées pour Paris 2024, 450 sont réservées à des journalistes et photographes français. C’est trois fois plus que pour les Jeux de Tokyo en 2021. « Ensuite, c’est aux comités nationaux olympiques de choisir les modalités d’attribution des accréditations », explique Étienne Bonamy, journaliste et ancien rédacteur en chef de L’Équipe. Il est lui-même membre du comité de sélection mis en place par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui s’appuie sur l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) pour attribuer ces fameux passeports diplomatiques. « C’est une chance car dans d’autres pays, c’est le comité qui gère directement, souligne-t-il. Cela facilite le travail et cela permet une meilleure transparence. »
Dans le détail, il existe deux types de laissez-passer aux JO. D’un côté, les groupes comme France Télévisions qui payent pour diffuser les épreuves et les autres chaînes ou stations (TF1, RTL, etc.) qui achètent un droit de passage aux abords des terrains pour faire des interviews et suivre des conférences de presse. De l’autre, les rédactions de presse écrite et les photographes. Pour eux, il en existe plusieurs catégories : celles qui donnent accès à tous les sites et celles qui permettent de couvrir une seule catégorie de sport.
Représenter le plus de titres possibles
De septembre 2022 à janvier 2023, le CNOSF a demandé à toutes les rédactions le nombre d’accréditations qu’elles souhaitaient obtenir. « Ce travail d’échanges me prend un tiers de mon temps pendant les JO », reprend Étienne Bonamy, étonné d’avoir dû relancer des médias à visibilité importante qui avaient oublié d’envoyer leur demande.
Une question est primordiale pour le comité de sélection : est-ce que les journalistes de ce média ont une carte de presse ? « Il a fallu expliquer à certains que leur demande avait peu de chance d’aboutir, souligne-t-il. L’accréditation n’est pas une récompense pour assister à un événement, mais une obligation de travail. » Des influenceurs ont tenté d’obtenir des accréditations, en vain.
Plusieurs autres paramètres entrent en compte pour délivrer des accréditations, telles que la volonté de représenter le plus de titres possibles sur l’ensemble du territoire et le poids historique des médias. « Nous savons qui a l’habitude de couvrir du sport dans ses pages », complète le journaliste. Pour certains médias, les JO reviennent dans leur agenda tous les deux ans. C’est le cas de L’Équipe, seul quotidien sportif français, et du groupe France Télévisions, diffuseur officiel dans l’Hexagone. Pour d’autres, les JO à domicile sont l’occasion de couvrir cette messe sportive internationale pour la première fois ou depuis bien longtemps. « Beaucoup de médias, même non sportifs, font valoir leur volonté d’obtenir des accréditations », précise Étienne Bonamy.
Alors que chaque journal a découvert durant le mois d’octobre 2023 son nombre d’accréditations, la deuxième phase peut commencer. Elle intervient cette fois-ci du côté des rédactions qui doivent désigner nominativement les journalistes et les photographes qui couvriront les JO. « Si nous avons essayé de donner un petit peu à tout le monde, il n’y a pas assez de place », constate-t-il. Cependant, les JO ne se suivent pas uniquement dans les stades. De nombreux médias obtiendront des autorisations pour se rendre au Club France afin de suivre les conférences de presse et circuler au plus près des acteurs.
Les agences de presse ne sont pas concernées par cette démarche. À elle seule, l’Agence France-Presse a obtenu 120 accréditations pour les Jeux de Paris, bureaux français et internationaux confondus. L’Équipe n’en a eu qu’une quarantaine.
Thomas LANGEARD et Clara LEBARBEY
26 Mar 2024 | Focus, Les articles, Les enquêtes, Tours 2024
La démocratisation des outils numériques, des plateformes de partage ont nettement participé à la prise de poids des créateurs de contenus sportifs. Photo : Axel Monnier/EPJT
Le journalisme sportif est-il en danger ? C’est ce que laisse penser la mainmise croissante des clubs sur leur communication dans le football français. Des entreprises qui s’appuient sur le crédit des journalistes pour bonifier leur image et se développer comme de véritables marques.
Après une semaine éprouvante, Matthieu Lecharpentier, alias Mattcharp sur X, entame
« son deuxième boulot ». Responsable sécurité santé et environnement en Bretagne, il contribue, 35 heures par semaine, à Rouge Mémoire. Un site de référence pour les supporters du Stade Rennais, né en réponse aux railleries des finales perdues par le club breton entre 2009 et 2014. Aucun signe distinctif ne l’identifie comme un site de supporter. Un look moderne, aux couleurs rouge et noir, de Rennes qui pourrait tout aussi bien être une extension d’un journal régional.
« On collecte les infos et on les introduit sur le web. Je me demande pourquoi je ne suis pas devenu journaliste », sourit Matthieu Lecharpentier. Au total, il a récolté, recoupé et classé près de 700 000 archives sur le Stade Rennais.
« Notre but, explique Mattcharp, c’est de communiquer sur le club et d’en parler de façon positive. » Des datas infinies des effectifs, du nombre de buts, de saisons ou de scores mais aussi des « entrevues » aux allures d’interview avec des anciens joueurs mythiques, participent à cette mise en valeur. Ce qui rend la frontière entre le journalisme et la communication de plus en plus poreuse et compromet le travail et les relations des journalistes avec les clubs.
Le Paris Saint-Germain, Rennes et d’autres équipes de Ligue 1 produisent des entretiens sur YouTube. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils bénéficient d’une audience toujours plus importante et dont tout l’écosystème du football français souhaite profiter. « Nous ne sommes pas fous, les journalistes nous sauteraient dessus si on s’asseyait à leurs côtés en tribune de presse. Nous n’avons pas de lien direct avec les joueurs », assène Matthieu Lecharpentier. Aujourd’hui, les neufs contributeurs de Rouge Mémoire sont tout de même invités à chaque match. À la demande de la direction, ils ont même contribué à la création de la « Galerie des Légendes », un espace qui retrace l’histoire du club depuis 1901. « On supporte et on aide le Stade Rennais. Notre rôle est de reconstruire la narration du club mais nous ne faisons pas de journalisme », poursuit le fan des Rouge et Noir. Le Stade Rennais pose des limites claires entre créateurs de contenus et journalistes.
Des clubs juges et bourreaux
Ce qui semble plus difficile au PSG depuis le rachat par les Qataris, en 2011. Le club s’ouvre à d’innombrables marchés internationaux tout en se fermant de plus en plus aux journalistes. Une pratique classique pour Yann Philippin, journaliste à Mediapart et spécialiste de l’institution parisienne : « Verrouiller l’info pour avoir une couverture presse la plus positive possible : toutes les entreprises le font. »
La presse quotidienne régionale n’est pas épargnée, comme l’explique Frédéric Launay, rédacteur en chef des sports de La Nouvelle République. Après un match Nîmes-Tours FC, en 2017, Jean-Marc Ettori, président du club tourangeau, passe le mot à son chargé de communication : « Les joueurs ne parleront plus à Monsieur Launay. » En cause, un papier critique sur l’entraîneur Jorge Costa.
Il semble que le PSG aille plus loin dans la stratégie de « la carotte et du bâton », confie Yann Philippin. Lorsque tout se passe bien, le club récompense. Dans le cas contraire, il sanctionne. L’Équipe en a fait les frais peu après l’arrivée de Lionel Messi au club, en 2021. Après que la rédaction ait divulgué le salaire de la star argentine, les dirigeants se sont braqués et ont fermé temporairement les portes des conférences de presse et des entraînements aux journalistes de L’Équipe. Selon Yann Philippin, l’enjeu pour les journaux sportifs réside dans un échange de bons procédés. « Au foot, la presse spécialisée a besoin du club. Ces derniers ont donc un moyen de pression. Et le PSG sanctionne tous les écarts. » Un engrenage auquel il est fier d’échapper avec Mediapart, puisque le pure player ne traite pas des résultats sportifs.
Le PSG fait encore plus pour s’attirer les bonnes grâces des journalistes, a révélé Yann Philippin dans son enquête. D’abord, il permet à certains d’entre eux d’intégrer, sur invitation, le « carré vip » où se mélangent politiques, hauts-fonctionnaires et célébrités. « Une façon peu coûteuse pour le club de s’attirer les faveurs de certaines personnes », poursuit-il. Pour Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du PSG, c’est le « power of football ».
L’important c’est de participer
Après un voyage de presse organisé par le club, l’ancien rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, a écrit des articles élogieux sur le PSG et son écosystème, dont un portrait flatteur du président, Nasser Al-Khelaïfi. Aujourd’hui, l’ancien journaliste de France Football occupe le poste de responsable de la communication de l’équipe parisienne. Pour Nelson Monfort, commentateur du patinage artistique sur France Télévisions, cette pratique nuit au journalisme. « Les agences de communication, les fédérations ou autres organisateurs de tournoi engagent de plus en plus des commentateurs et chroniqueurs à leurs bottes. Il faut être très intelligent pour engager quelqu’un qui peut être amené à nous critiquer. » Le PSG n’est pas le seul à l’avoir fait. Jacques Cardoze, ancien journaliste du service public, désormais chroniqueur dans l’émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste », sur C8, a également occupé le poste de directeur de la communication à l’Olympique de Marseille.
Le football français entretient le flou entre communication et journalisme. Les clubs recrutent des influenceurs, des community managers qui ont un accès exclusif aux joueurs. Une véritable remise en question de la place et du rôle du journaliste sportif. Mais, Yann Philippin conserve tout de même l’espoir « que la communication du club ne se substitue complètement à sa couverture par les journalistes ».
David Allias, Théo Lheure et Jules Rouiller
28 Mar 2023 | Les enquêtes, Tours 2023
Photo : Kelvin Jinlack/EPJT
L’éducation aux médias et à l’information s’intensifie en classe. Mais les intervenants manquent de formation et de coopération pour que tous les élèves en profitent.
Au bout du fil, une professeure documentaliste au ton agacé. Elle a l’impression de se battre dans le vide. Presque gênée, elle s’en excuse. Enseignante dans un collège d’Indre-et-Loire, Caroline* ne mâche pas ses mots lorsqu’elle évoque l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI). Le lendemain, coup de fil à la rédaction : elle ne veut pas que son nom apparaisse, consciente d’avoir dépassé son droit de réserve. Pour elle, c’est tous les ans la même chose. Vingt ans qu’elle s’efforce de mener à bien des projets de ce type au sein de son établissement. « Je dois négocier avec chaque prof, avec chaque classe et dans chaque discipline », souffle-t-elle. Quand un enseignant ou un directeur s’en va, c’est pire encore. Il faut tout recommencer.
Cette année, elle n’a vu que trois classes sur les trente que compte son collège. L’éducation aux médias et à l’information, créée quarante ans plus tôt, fait pourtant consensus. « L’ensemble du personnel de l’Éducation nationale est concerné », assure Karen Prévost-Sorbe, référente ÉMI à l’académie d’Orléans-Tours. Le ministère est conscient de son importance.
Pas d’heures obligatoires
Si Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale, l’a décrite comme un pilier du parcours de chaque élève, ce n’est pas une discipline à part entière. En clair, les élèves n’ont pas d’heures obligatoires dédiées à cet enseignement. Les professeurs, toutes disciplines confondues, sont encouragés à l’inclure dans leurs heures de cours.
En réalité, l’ÉMI passe souvent au second plan à cause du manque de temps pour finir les programmes. Les « profs docs », responsables ÉMI au sein des établissements, en sont réduits à se greffer aux cours de leurs collègues. « Parfois, je comprends. Ils n’ont pas le temps. Le souci, c’est qu’on travaille toujours avec les mêmes », témoigne Anne Esnon, professeure documentaliste au lycée professionnel Martin-Nadaud de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). Le manque de communication et de reconnaissance accentue l’incompréhension. Un sentiment d’isolement d’autant plus fort selon la taille de l’établissement scolaire.
C’est le cas de Caroline qui est seule face à plus de 800 élèves pour mener à bien des projets d’ÉMI : « J’ai beaucoup de mal à mettre en place des projets concrets sur le long terme. » Comme le précise Anne Esnon, pour que les projets d’établissement soient réalisables, il faut que tous les acteurs de l’équipe pédagogique s’investissent : « C’est un vrai travail d’équipe, ça ne peut pas venir d’une seule personne. »
Karen Prévost-Sorbe, référente ÉMI, en conférence. Photo : EPJT
Si les professeurs ont conscience de la nécessité de l’ÉMI, ils n’y sont pourtant pas initialement formés. En effet, les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (Inspé), qui visent à préparer les futurs enseignants, n’intègrent pas l’éducation aux médias dans leurs programmes. « Dans mon établissement, il y a une collègue stagiaire en formation initiale. Elle n’a pas suivi de modules sur l’ÉMI et elle ne savait même pas ce que c’était », s’étonne Anne Esnon.
La question est de savoir comment placer l’ÉMI comme priorité dans le parcours d’un élève si les professeurs ne sont pas eux-mêmes préparés à cette discipline ? À défaut d’avoir été formés lors de leur cursus initial, les professeurs peuvent suivre une formation continue. Mise à disposition par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (Clémi), elle propose des vidéos en ligne auxquelles chacun peut s’inscrire… s’il le souhaite. Quelques heures devant l’écran permettent, par exemple, de se sensibiliser au journalisme de guerre, à la lutte contre la désinformation, ou aux réseaux sociaux.
En montant un projet d’ÉMI, les professeurs se sentent parfois démunis. Les secrets de la fabrication journalistique, sans compter les subtilités techniques, sont difficiles à appréhender. Ils se tournent vers les professionnels du secteur pour les épauler. « Le problème c’est qu’il n’y a pas de journaliste référent pour chaque projet d’ÉMI initié, regrette Karen Prévost-Sorbe. Il faut qu’ils arrivent à dégager du temps tout en sachant qu’ils ont un agenda chargé au sein de leur rédaction. »
La demande des établissements scolaires est bien plus importante que l’offre journalistique. Face à ce manque de disponibilité, une solution est souvent utilisée : se tourner vers les radios associatives.
« Par moment, c’est du bricolage »
S’ils disposent de compétences techniques, les bénévoles ne sont pas tous formés à l’ÉMI, ni au journalisme. « Il faut le dire, par moment, c’est du bricolage », reconnaît Anne Esnon. Au niveau de l’accompagnement et des formations, les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux pour les professeurs documentalistes.
L’initiative a la particularité d’allier trois compétences pour rendre l’ÉMI optimale : le journalisme, la technique et la pédagogie. Un équilibre difficile à obtenir. En Centre–Val de Loire, plusieurs personnes réfléchissent à la création d’un annuaire en ligne, qui recenserait les acteurs certifiés.
L’objectif est d’assurer la formation des intervenants et d’améliorer la qualité de l’éducation aux médias. Une idée insufflée par Élodie Cerqueira, nouvelle présidente du Club de la Presse Centre – Val de Loire. Depuis son élection en novembre 2022, elle place l’ÉMI au cœur de ses préoccupations. Même son de cloche chez Karen Prévost-Sorbe : « À terme, il y aura des journalistes et des intervenants certifiés en ÉMI qui se différencieront des autres. »
Sarah COSTES, Jane COVILLE, Arnaud FISCHER et Kelvin JINLACK
(*) Le prénom a été modifié.
25 Mar 2023 | Les enquêtes, Tours 2023
Mardi 28 mars débutent les 16e Assises internationales du journalisme à Tours. A cette occasion, les étudiants en première année du master de l’EPJT réalisent La Feuille, dont les numéros seront distribués lors des Assises mais que vous pouvez également trouver ci-dessous.
Bonne lecture
7 Mai 2022 | Les enquêtes, Tours 2022
Lundi soir débutent les 15e Assises international du journalisme à Tours. A cette occasion, les étudiants en première année du master de l’EPJT ont réalisé ce numéro de La Feuille qui sera distribué lors des Assises mais que vous pouvez également trouver ci-dessous.
Bonne lecture
29 Sep 2021 | Les articles, Les enquêtes
Les étudiants en journalisme de l’EPJT ont travaillé sur la réalisation du journal La Feuille au printemps 2021. Découvrez ce numéro exceptionnel consacré au thème « Chaud devant » de cette édition des Assises du journalisme.
“Chaud Devant”, le thème des Assises du Journalisme 2020, a été repris pour créer le journal La Feuille. L’organisation des Assises n’a pas participé à la réalisation de ce magazine, entièrement conçu par les 35 étudiants en master de l’École publique de journalisme de Tours (EPJT). L’idée était de proposer un journal qui fasse écho aux questions et débats mis en avant lors de cette nouvelle édition.
Du brainsto à l’impression, une réalisation aux petits oignons
Eco-dépression, fausses informations ou encore météorologie, le choix des sujets traités dans La Feuille a fait l’objet de multiples discussions. Le journaliste indépendant, Michel Dalloni, a été le rédacteur en chef de ce journal.
Après un brainstorming collectif et plusieurs conférences de rédaction, le chemin de fer s’est dessiné au fil des articles retenus.
Un total de 21 étudiants s’est chargé de la rédaction des papiers, 9 en tant que secrétaire de rédaction et 5 en charge de l’iconographie. Un duo de deux étudiantes s’est occupé de relire les articles avant l’envoi aux secrétaires de rédaction et de faire la passerelle entre les étudiants et Michel Dalloni.
Malgré le contexte sanitaire, des équipes se sont rendues sur le terrain. L’une a sillonné les terres bretonnes sur les traces de l’Amoco-Cadiz tandis que d’autres ont franchi les portes des rédactions à la rencontre de journalistes.
Responsabilité climatique
La principale vocation de La Feuille était d’entraîner les étudiants à la réalisation d’un journal. Distribué dans l’espace Mame lors des journées des Assises du Journalisme, nous espérons qu’il sera le plus instructif possible sur le métier de journaliste et leurs responsabilités face à la crise climatique.
Pour le retrouver : https://assises-journalisme.epjt.fr/le-journal-des-assises-2021
16 Mar 2019 | Les articles, Les enquêtes, Tours 2019
De plus en plus de journalistes prolongent leurs investigations dans des livres. Une manière, parfois, de dépasser la frustration du format court.
« On écrit sur des sujets qui nous passionnent », assure Matthieu Aron, auteur du Piège américain et journaliste à L’Obs. Écrire un ouvrage offre une plus grande liberté dans le choix des sujets, moins présente au sein d’une rédaction dépendante de l’actualité. Romain Capdepon, avec son ouvrage Les Minots (éd. JC Lattès), a décidé de parler des jeunes guetteurs qui participent aux trafics de drogues : « Dans mon travail de tous les jours, à La Provence, c’est l’angle qui m’intéresse le plus. Malheureusement, je le traite très peu dans mes articles, souvent par manque de temps. Je reste plutôt sur le trafic en général. »
Travail au long cours
Le journaliste possède bien souvent un antécédent avec le sujet, parfois la frustration de ne pas être allé au bout des choses par manque de temps. « J’interviewais des interprètes afghans et mes articles se terminaient en disant que le ministère des Affaires étrangères n’avait pas souhaité me répondre », raconte Quentin Müller, auteur de plusieurs articles sur les interprètes afghans abandonnés par la France, avant de cosigner un livre sur le sujet (Tarjuman. Une trahison française, éd. Bayard). Sa rencontre avec Brice Andlaeur aura été décisive, les deux ont pu croiser leurs sources et les informations qu’ils avaient amassées chacun de leur côté. Ces deux ans d’enquête leurs auront permis d’obtenir les réponses qu’ils cherchaient.
Matthieu Aron a entendu le coach de rugby de son fils parler d’un haut dirigeant d’Alstom emprisonné aux Etats-Unis. Cette histoire a éveillé sa curiosité. « J’ai enquêté pendant plus de quatre ans sur cette affaire. Je savais que ça allait être très long, raconte celui qui a écrit Le Piège américain. Alors que je faisais aussi des sujets pour France Inter ou L’Obs. »
Les pages d’un livre offrent plus d’espace qu’un article de presse pour approfondir un sujet. L’exercice demande néanmoins beaucoup de temps et se fait parfois en parallèle d’un travail en rédaction. C’est ce qu’a vécu Isabelle Roberts, co-autrice avec Raphaël Garrigos de La Bonne Soupe (éd. Les Arènes) sur le 13-heures de Jean-Pierre Pernault, en même temps qu’elle travaillait à Libération. « Il fallait regarder tous les JT, chaque soir pendant trois ans, nous avons vraiment souffert [rires]. On devait aussi trouver des moments pour écrire, le week-end ou après le boulot. » Les jours de repos et de RTT, deviennent alors des jours consacrés au livre.
Et l’investissement financier peut aussi être important. « On a pris beaucoup de plaisir mais pour l’instant, ça a été un gouffre financier », confie Brice Andlauer, coauteur de Tarjuman. Une trahison française, publié le 6 février dernier. Les journalistes-auteurs ne sont pas tous logés à la même enseigne par les éditeurs : certains touchent une avance, plus ou moins élevée, généralement en fonction de leur notoriété.
Mais les bénéfices tirés d’une telle expérience peuvent être nombreux : elle permet par exemple de développer ses contacts et d’affûter son regard sur un sujet au point d’en devenir expert. « Avec mon enquête, j’ai pu mieux comprendre les guetteurs que je serai peut-être amené à recroiser dans mon travail », explique Romain Capdepon, également chef de la rubrique police-justice de La Provence.
La rédaction d’un livre et le travail au sein d’un média peuvent très bien s’allier, comme le fait Les Jours. Le site raconte des faits d’actualité, leurs « obsessions », qu’ils divisent en épisodes. Certaines sont parfois publiées sur papier. « On trouvait cohérent que l’enquête sur Bolloré se retrouve chez un libraire », confirme Isabelle Roberts, coautrice de L’Empire : Comment Vincent Bolloré a mangé Canal+. Ici, l’éditeur est arrivé après la rédaction mais dans d’autres cas de figure, il peut aussi être présent pendant la rédaction du livre. Il lui arrive alors de donner des indications quant à l’écriture.
un lectorat différent
Dans le cas de Romain Capdepon : « Les éditions JC Lattès ne voulaient pas d’un texte trop journalistique, plutôt d’un texte qui ressemblait à un roman inspiré de faits réels, précise-t-il. Je travaille depuis treize ans dans la presse quotidienne régionale donc j’ai dû adapter mon écriture. » Brice Andlauer, lui, nous confie qu’il n’a eu que peu de modifications de fond à faire sur son manuscrit. « L’éditeur nous a laissé plus de marge de manœuvre qu’un rédacteur en chef. »
Les livres, aussi, s’adressent à un lectorat différent des médias. « Aux Jours, on est lu surtout par des jeunes. Avec les livres, on touche un public plus large et plus âgé, attaché au papier en tant que support », affirme Isabelle Roberts.
Les livres du média dont elle est cofondatrice se vendent très bien. Environ 80 000 exemplaires pour les quatre ouvrages publiés avec les éditions du Seuil, dont Les Revenants de David Thompson ou Le 36. Histoires de poulets, d’indics et de tueurs en série, de Patricia Tourancheau. Romain Capdepon est formel, l’écriture de son enquête a servi à sa rédaction. « Dès qu’on parle du livre, on dit qu’il a été écrit par un journaliste de La Provence. » Malgré la fatigue accumulée lors de ses d’investigations, le travail d’une année a porté ses fruits. « J’espère que mon livre permettra à certains d’avoir un regard plus humain quand un jeune se fait tuer dans les quartiers Nord », conclue-t-il. Car c’est le but d’un livre d’investigation, aller au fond des choses et, pourquoi pas, faire évoluer les mentalités.
Victor FIEVRE
15 Mar 2019 | Les articles, Les enquêtes, Tours 2019
Violence, méfiance, méconnaissance… La relation entre les médias et les Français est parfois conflictuelle. Des solutions existent pourtant.

Des journalistes pourchassés et insultés, leurs agents de sécurité roués de coups… Les violences envers les journalistes se sont intensifiées ces derniers mois. Selon un baromètre commandé par La Croix, datant de janvier 2019, 19 % des Français considèrent que ces insultes et agressions sont compréhensibles et justifiées. Les causes de cette haine sont nombreuses. Il est notamment reproché aux professionnels de l’information un certain manque de neutralité, un manque de proximité avec le public et un décalage avec la réalité. Pour lutter contre cette défiance, la profession cherche des solutions. Voici trois d’entre elles.
Renouer le contact avec le public
Presque toutes les rédactions possèdent désormais leur propre service de vérification de l’information appelé « fact-checking ». Si ce système existe depuis longtemps, la manière de procéder a évolué. Libération est, par exemple, passé de la simple vérification d’informations à la réponse aux questions directement posées par les internautes. « Cela crée un lien direct avec le lecteur et permet également au journaliste de sortir de sa bulle », précise Pauline Moullot, journaliste de Checknews. Par souci de transparence, la rédaction est allée jusqu’à révéler le scandale de la Ligue du LOL, qui concernait deux de ses rédacteurs. Dans les écoles de journalisme, des cours sont dispensés sur le sujet. Pour Laurent Bigot, journaliste, maître de conférence et responsable de la presse écrite à l’École publique de journalisme de Tours (EPJT), « le but du fact-checking est d’aider les étudiants à acquérir des réflexes de vérification avec des standards plus pointus que ceux qui sont généralement mis en œuvre dans les rédactions ». Le Parisien a lui aussi créé Le labo des propositions citoyennes, une passerelle qui répond aux questions des lecteurs. Créée dans le cadre du Grand Débat, elle propose des informations vérifiées, développées et contextualisées.
Créer de nouveaux formats
Pour lutter contre le manque de diversité des médias traditionnels, certains journalistes innovent avec des nouveaux modèles de diffusion. Brut, créé en 2016, utilise les réseaux sociaux pour partager ses reportages vidéo. La formule fonctionne : en 2018, plus de 400 millions de vues ont été dénombrées sur Facebook. Lors de la crise des Gilets jaunes, Rémy Buisine, journaliste à Brut, s’est démarqué en réalisant de nombreux Facebook live des manifestations. « L’avantage des directs sur les réseaux sociaux, ce sont les commentaires des internautes. C’est une valeur ajoutée car on est connecté directement avec notre audience », détaille-t-il. Mais le direct n’enlève rien à la véracité du contenu selon lui : « Ce n’est pas parce que je suis en direct que je ne peux pas avoir de recul sur les événements. Je suis en contact permanent avec ma rédaction et les autorités compétentes. »
D’autres médias sociaux sont également de plus en plus présents et importants, comme le témoigne l’essor de la chaîne YouTube Hugo Décrypte, lancée en 2015 par Hugo Travers, alors étudiant à Sciences Po. L’objectif de son format est d’expliquer l’actualité à des jeunes, âgés de 15 à 25 ans. « L’une des causes de la défiance, c’est que beaucoup de jeunes ne suivent pas les informations. Avec ma chaîne, j’essaie de leur apporter un certain contenu d’information », explique le jeune homme de 21 ans.
Sensibiliser les jeunes
Former pour comprendre de quelle manière les médias fonctionnent est également un enjeu pour lutter contre cette haine. Créé il y a quarante ans, le Centre de liaisons pour l’éducation aux médias et à l’information (Clémi), promeut l’éducation aux médias sous différentes formes. « Zéro Cliché », par exemple, est un concours ouvert aux écoliers, collégiens et lycéens, qui prône la déconstruction des stéréotypes sexistes à travers la production de contenus journalistiques. Serge Barbet, directeur du Clémi, placé sous la tutelle du ministère de l’éducation, estime la mission nécessaire. « Quand on apprend à faire la différence entre une bonne information et une manipulation, on évite déjà un certain nombre de pièges. C’est ce qui permet de devenir un citoyen éclairé. » Des initiatives existent aussi localement. En Indre-et-Loire, l’association Jeunes reporters (8-13 ans et 13-18 ans) a été créé en juin 2017, suite à un projet scolaire datant de 2007. Le but est de « faire découvrir le journalisme, apprendre à écrire pour les autres, mais aussi aller jusqu’au bout de leur démarche », explique Gaëtan Després, qui encadre les jeunes. Les médias prennent également des initiatives pour l’éducation. Estelle Cognacq, directrice adjointe de la rédaction à France Info, insiste sur cette thématique, selon elle « incontournable ». « On organise de nombreuses rencontres entre les journalistes et les classes. Il y a une nécessité pédagogique de la part des médias d’aller vers les jeunes et de démystifier notre métier. »
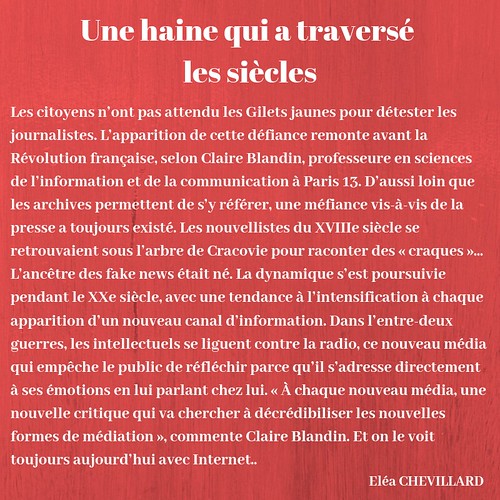
Mélina RIVIERE et Suzanne RUBLON
14 Mar 2019 | Les articles, Les enquêtes, Tours 2019

Le conseil de la presse : un outil de régulation magique à brandir à loisir pour faire respecter les règles de démocratie. (Photo : Suzanne Rublon)
La création d’un conseil de presse fait de nouveau débat chez les journalistes et les éditeurs. Certains plébiscitent un outil de régulation. D’autres craignent la censure.
Entre les médias et leur public, le climat est délétère. Les journalistes sont régulièrement pris pour cible dans l’espace public. Une fracture symbolisée par le mouvement des Gilets jaunes. Alors comment rétablir la confiance entre la profession et la population ? Une proposition revient souvent dans les débats : l’autorégulation des médias, avec l’instauration d’un conseil de presse déontologique. Jean-Luc Mélenchon avait porté cette idée dans son programme lors de l’élection présidentielle de 2017, avant, quelques mois plus tard, de lancer une pétition en ligne qui avait recueilli plus de 190 000 signatures. En 2014, Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture, avait lancé une mission sur le sujet qui avait conclu à l’absence de consensus entre syndicats de journalistes, ouvertement favorables, et éditeurs.
« Sujet sensible »
En octobre 2018, le ministère de la Culture s’est réemparé du dossier en confiant une mission sur le sujet à Emmanuel Hoog. Initialement prévue en janvier, la publication du rapport, qui n’engage pas le processus de création d’un conseil de presse, devrait être faite d’ici quelques jours.
Franck Riester, le ministre de la Culture, se dit « prudent » quant à cette démarche, parlant même de « sujet sensible » dans les colonnes du JDD du 10 mars. « Le rapport et ses conclusions pourront être une base de travail pour les journalistes, mais sa vocation première sera de faire de la pédagogie : expliquer ce qu’est un conseil de presse. C’est aux professionnels de s’entendre sur le périmètre d’action », précise Emmanuel Hoog.
La déontologie occupe d’ores et déjà une place importante au sein du paysage médiatique du pays. La presse française se réfère à différents textes déontologiques, comme la Charte de Munich, quand les rédactions n’ont pas leur propre code, à l’image de Ouest-France ou France Télévisions. Radios et télés, quant à elles, relèvent du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui peut, dans les cas les plus extrêmes, émettre des sanctions.
Mais la France demeure une exception sur le Vieux continent. Une vingtaine de pays européens se sont déjà dotés d’un conseil de presse, parmi lesquels figurent la Belgique, la Suède, le Danemark ou la Norvège, membres du top 10 du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Soupçon de corporatisme
« La présence d’un conseil de déontologie de la presse n’entraîne pas automatiquement une montée au classement, mais cela peut expliquer en partie la bonne place qu’y occupent certains pays comme le Danemark », analyse Paul Coppin, le responsable des activités juridiques de l’organisation. Selon les pays, les priorités de ces instances diffèrent. Régulièrement mis en avant, le traitement des plaintes du public n’est pas forcément la tâche principale de ces conseils conçus pour être des médiateurs forts entre le public et les journalistes.
Leur composition varie également selon les pays. La plupart ont une représentation tripartite, avec des journalistes, des éditeurs et des représentants de la société civile, afin d’éviter les soupçons de corporatisme. Une particularité que le futur conseil de presse français pourrait présenter. « Ceux qui se sont montrés favorables à un conseil de presse ont tous dit qu’il fallait une représentation de la société civile au sein de cette instance », confirme Emmanuel Hoog. Le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) se dit ouvert au principe d’un conseil de presse. Tout comme le Syndicat national des journalistes (SNJ) qui revendique la « création d’une instance nationale de déontologie » et demande l’inscription de la Charte de Munich dans la convention collective des journalistes. Jean-Marie Charon, sociologue au Centre national de la recherche scientifique et spécialiste des médias, estime que cette dernière requête suffit. « Reconnaître un texte qui soit opposable par les journalistes serait beaucoup plus intéressant que d’avoir un conseil au-dessus de tout », juge-t-il, considérant comme « inutile » la création d’un conseil de presse. « On peut envisager la médiation d’une autre manière, comme par exemple avoir des structures au sein des rédactions », argue encore Jean-Marie Charon. Mais la création de ce conseil ne solutionnerait pas tout. Plusieurs critiques reviennent souvent sur la mission d’Emmanuel Hoog.
La principale : que l’État soit à l’initiative du projet. « Même s’il n’aura aucun pouvoir dans le conseil une fois celui-ci créé, cette démarche n’envoie pas un bon signal », estime par exemple Jean-Christophe Boulanger, président du Spiil. Emmanuel Hoog tempère : « Ce n’est pas parce que l’État me missione qu’il jouera un rôle dans le futur conseil de presse. Sa place sera nulle. »
La solution aux problèmes déontologiques pourrait d’abord passer par les rédactions et par des journalistes qui se remettent quotidiennement en question. En janvier 2018, le quotidien La Voix du Nord a officiellement mis fin à la relecture de ses papiers par les interviewés. Une pratique imposée par certains hommes politiques, mais aussi, parfois, par ceux qui militent pour la création d’un conseil déontologique…

Ariel GUEZ et Camille MONTAGU
12 Mar 2019 | Les articles, Les enquêtes, Tours 2019

Les écoles de journalisme reconnues fabriqueraient-elles des clones qui inondent ensuite les médias ? C’est oublier que seuls 19 % des titulaires de la carte de presse sont passés par une école de ce type… (Photo : Alice Blain)
De gauche, europhiles, parisiens…Les journalistes sont-ils tous pareils ? Dans un contexte de défiance, la profession cherche des solutions. Collabos », « macronistes », « journalopes »… Les mots pour dénigrer les journalistes ne manquent pas. Pour ceux qui les critiquent, les journalistes sont tous les mêmes, au point de tenir le même discours. Comment expliquer une telle perception ?
Pour certains, la formation pourrait être l’une des causes de l’uniformisation des troupes. Mais pour Cédric Rouquette, directeur des études du Centre de formation des journalistes (CFJ), les écoles de journalisme ne mènent pas forcément à l’homogénéisation des profils. « Nous ne donnons aucun prêt-à-penser, assure-t-il. Nous leur transmettons une méthode de travail et de la rigueur. » Certains avancent aussi que les écoles reconnues par la profession ne dispensent pas les mêmes enseignements. « On ne forme pas de la même façon dans les DUT de Tours, de Cannes ou de Lannion que dans les masters des autres grandes écoles », considère Claude Cordier, président de la CCIJP (Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels).
Diversité à l’école
Pour certains, c’est la sélection des étudiants qui ne favoriserait pas la diversité. C’est le point de vue de Denis Ruellan, sociologue des médias et directeur adjoint des études du Celsa : « Les écoles de journalisme prennent les meilleurs, qui sont en fait ceux qui possèdent les valeurs des classes sociales dominantes, analyse-t-il. C’est ce qui conduit ensuite à avoir une homogénéité blanche et originaire de la classe moyenne supérieure dans les rédactions. » Pourtant, certaines écoles de journalisme ont mis en place des mesures destinées à diversifier les promotions. L’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) a par exemple créé sa propre prépa « Égalité des chances ». Des jeunes « avec un bon dossier scolaire et universitaire, mais issus de familles à revenus modestes », selon le site de l’ESJ, se voient chaque année offrir l’opportunité d’intégrer l’une des meilleures écoles de journalisme de France. Il existe également des dispositifs externes aux écoles. Depuis 2007, l’association La Chance aide des étudiants boursiers à préparer les concours des écoles de journalisme gratuitement. Cette démarche porte ses fruits : 80 % de ses anciens étudiants travaillent dans le journalisme. Mais un problème persiste : certaines classes sociales ne se dirigent pas naturellement vers le journalisme. « Beaucoup de jeunes sont faits pour ce métier, mais n’osent pas tenter les concours, déplore Cédric Rouquette du CFJ. La majorité de ceux qui se présentent proviennent de la classe moyenne supérieure. » Denis Ruellan trouve une explication logique à ce phénomène : « Dans ces milieux, les gens ont tendance à être très portés sur les médias. Donc forcément, ça aide à aller vers le journalisme. »
Le fossé
Ces inégalités se retrouvent dans le profil des professionnels, à la télévision en particulier. Selon le baromètre annuel de la diversité dans les médias publié par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en janvier 2018, les catégories socio-professionnelles supérieures occupent 74 % de la représentation à la télévision alors qu’elles ne représentent que 27 % des Français, d’après l’Insee. Pour autant, il serait faux de penser que les journalistes sont formés dans le même moule. Les écoles de journalisme ne représentent pas la seule voie d’entrée dans la profession. En réalité, cette origine est même très minoritaire. « Seulement 19 % des journalistes professionnels sont issus de ces écoles reconnues », atteste Claude Cordier, de la Commission de la carte de presse. N’en déplaise à ses plus ardents détracteurs, la profession ne se résume pas aux quelques figures médiatiques qui occupent les plateaux de télévision ou qui signent des tribunes à succès. Du pigiste pour M6 à la localière de Ouest-France à Bayeux, en passant par le secrétaire de rédaction de L’Humanité : les statuts sont divers. De multiples fractures existent, comme celles concernant la rémunération et les types de contrat (lire ci-dessous). Un journaliste en contrat indéterminé exerçant pour un quotidien national gagne, en moyenne, deux fois plus qu’un journaliste en contrat déterminé. Alors pourquoi les journalistes continuent-ils de renvoyer une image éloignée de la réalité ? « C’est trop facile de chercher une explication de type purement sociologique. Quand les gens parlent de cet éloignement entre les journalistes et la société, ils prennent pour exemple Jean-Michel Aphatie. Pourtant, ce journaliste politique a un parcours complètement différent du reste de la profession », pointe Jean – Marie Charon. Après son brevet des collègues, Jean Michel Aphatie a arrêté l’école pour enchaîner les petits boulots. Il a repris ses études plus tard et passé à son bac à 24 ans, avant de s’orienter vers le journalisme.
Les médias, conscients du problème de représentativité, placent désormais la diversité au cœur de leurs priorités. Chacun tente de recruter des profils plus représentatifs de la société. France Télévisions accueille par exemple dans ses rédactions des stagiaires boursiers ou issus de zones urbaines sensibles. Radio France réserve un nombre de places défini pour les boursiers et favorise la formation en alternance. Ces efforts semblent porter leurs fruits, avance Jean Marie Charon. « Le journalisme est aujourd’hui une profession hétérogène en termes d’origines sociales. Cela permet une meilleure représentation de l’ensemble des Français », considère le sociologue des médias. Mais le chemin, de l’avis de tous, est encore long.

Lorène BIENVENU, Léa SASSINE et Théo TOUCHAIS