Marianna Thiam raconte sa visite dans un centre de migrants au Niger. Elle y a rencontré un migrant camerounais, traumatisé par son voyage, qui a eu ces mots qui l’ont marquée : « Pendant le voyage, on a « plus de frère, plus de sœur, plus d’amis ».
Ali Mahfoud raconte, lui, son parcours de journaliste en Libye à demandeur d’asile en France.
Eleonora Camilli développe son travail journalistique sur la migration. Elle suit depuis 2015 la question de la migration en Europe notamment en Grèce, dans les Balkans, à la frontière franco-italienne. Elle étudie aussi la politique migratoire européenne qui cherche à tenir les migrants loin de ses frontières. Elle s’est également rendue aux frontières de l’Ukraine pour voir, avec la guerre, comment était gérée cette migration-là, et la comparer aux autres. Elle relève que, pour le cas de l’Ukraine, le choix d’aider les migrants est politique et que les Ukrainiens sont mieux traités que d’autres dans la même situation. Elle note par exemple que rien n’a changé depuis pour ceux de l’ile de Lampedusa par exemple : « On a créé un système où les réfugiés ne sont pas les mêmes, où les droits ne sont pas les mêmes ».
Sarah Frère a travaillé sur la question de la migration « légale » en Belgique (étudiants, travailleurs) et notamment sur la question des procédures. Ces dernières sont externalisées ce qui donne un service public de l’immigration inaccessible. Cette situation se voit sans réponse politique concrète.
Amara Makhoul, de par son travail pour Infomigrants, rappelle que les migrants sont une audience particulière. Elle rappelle aussi l’importance du vocabulaire qui, dans son cas, participe de la confiance dans le média.
Première piste de réflexion : l’importance du vocabulaire pour la couverture du sujet.
Marianna Thiam distingue différents enjeux. Les termes utilisés par les gouvernements répondent souvent à des enjeux politiques. Donc les États retiennent des définitions qui sont en accord et facilitent leurs propres politiques migratoires. C’est pour cela que les pays ne sont pas d’accord sur les définitions. Ensuite, les termes utilisés par les journalistes se font les véhicules de certains stéréotypes. Elle cite comme exemple le terme migrant, qui connote « l’Africain qui vient en Europe », qu’elle oppose à « l’expatrié européen qui va travailler aux États-Unis ». Une personne qui utilise ces termes peut mal les utiliser, de manière active à des fins de désinformation ou de manière passive comme conséquences de préjugés. Elle rappelle que le journaliste est influencé par sa communauté et son milieu d’origine et qu’il se doit de faire attention à cette question du vocabulaire.
Sarah Frère raconte qu’il existe en Belgique des recommandations terminologiques faites par le Conseil de déontologie journalistique. Ces recommandations ont été formulées dans les années quatre-vingt-dix, suite à une poussée électorale de l’extrême droite. Elles posent un cadre aux journalistes, leur permet d’éviter des termes qui ne veulent rien dire, comme par exemple « migrant illégal ». Ces termes sont d’autant plus dangereux qu’ils nourrissent un imaginaire souvent mensonger chez le lecteur ou la lectrice.
Eleonora Camilli souligne l’importance de la réflexion sur la narration faite de la migration. Pour elle, les journalistes peuvent avoir tendance à dépeindre les migrants comme des « victimes » ou des « ennemis » et non pas comme des sujets de droit. Elle met en lumière un piège qui peut être présent : présenter les migrants comme objets plutôt que comme sujets de la narration.
Pour Ali MAHFOUD le problème de vocabulaire vient aussi de l’État, des administrations qui emploient et définissent des termes dans leur référentiel propre, sans penser à leur utilisation par d’autres acteurs. Ainsi, en Libye, la question de l’identification des migrants est un enjeu phagocyté par les administrations et le vocabulaire qu’elles emploient.
Deuxième piste de réflexion : comment parler de la migration autrement ? Comment sortir de l’aspect « événementiel » ?
Amara Makhoul propose de faire un suivi rapproché de la question. Par exemple en adoptant une approche plus régulière, comme le fait Infomigrants. Mais se pose la question de l’intégration de cette régularité dans un journal généraliste.
Sarah Frère complète le propos en analysant l’effet évènementiel comme étant lié non pas à la question de la migration, mais au caractère nouveau des évènements (d’un naufrage, d’une noyade). Pour elle, l’enjeu est alors de raconter la même chose, mais autrement, afin d’éviter des histoires qui se répètent, qui tournent en boucle. Une solution qu’elle met en pratique est de replacer les personnes au centre de l’histoire, plutôt que les faits. Chaque personne étant unique, son parcours différent des autres, on peut donc traiter la question avec une multitude d’histoires différentes.
Pour Marianna Thiam, le traitement évènementiel des informations sur les migrants est lié à la fonction du journaliste et au fait, qu’en fin de compte, il doit produire une valeur économique afin que le média puisse se vendre. Et le sensationnel vend plus. Pour elle, une solution à ce sensationnalisme est la production d’investigations. Cela permet d’aller au fond du problème, d’aller chercher les informations et de proposer un contenu moins sensationnel, mais plus complet et abouti. En effet, selon elle, les journalistes ont souvent tendance à produire du journalisme factuel, de remplissage, plus sensationnel, qui s’accommode parfois mal de problématiques liées à la question migratoire.
Troisième temps du débat : le témoignage du migrant dans le travail du journaliste
Ali Mahfoud partage son expérience en Libye où il est impossible d’obtenir des témoignages. En effet, il est interdit d’avoir des contacts avec les migrants pour des raisons politiques et sécuritaires. Seules quelques ONG le peuvent mais seulement sur 10 % du territoire environ. Il poursuit en rappelant que même s’il est difficile d’entendre les récits de migrants en Belgique, il est nécessaire et important d’avoir un espace de liberté où la parole peut se libérer.
Pour Eleonora Camilli, l’importance des témoignages est capitale. Mais le recueil est difficile car il faut composer avec la psychologie du migrant qui peut avoir des difficultés à revivre les évènements ou peut être incapable de les raconter. Pour elle, la question de la psychologie des migrants est difficile à aborder mais c’est une problématique centrale pour avoir une narration juste.
Sarah Frère pose un impératif de respect des personnes et de leur parole. Elle rappelle aussi l’importance de l’honnêteté dans la démarche du journaliste : il ne faut pas faire croire aux migrants que leur témoignage va changer leur vie. Mais il faut aussi faire attention, à force d’absorber des histoires tragiques, à ne pas déshumaniser les témoignages, à ne pas mettre l’empathie de côté.
Amara Makhoul souligne l’importance du recul pour le journaliste. Un constat partagé par Ali Mahfoud, qui rappelle que ce recul fait partie du travail de journaliste.
Marianna Thiam met l’accent sur l’importance de la connaissance de la culture des migrants pour appréhender leur posture face au journaliste. Elle rappelle que le migrant apporte au journaliste son histoire, mais aussi ses troubles, ses traumatismes . Il peut donc être amené à manipuler son interlocuteur.
Dernier point : l’aspect passionné et passionnel du sujet, qui génère des tensions. Quelle est donc la responsabilité des journalistes ?
Sarah Frère raconte l’expérience de la Belgique qui a mis en place un « cordon sanitaire médiatique » qui empêche l’extrême droite de prendre la parole en direct dans les médias. Ce qui permet de faire de la vérification d’informations avant publication. Elle pose ensuite la question de la reprise dans les articles d’extraits twitters de personnalités politiques. En effet, la citation de messages incitatifs à la haine dans des articles participe de leur publicité. Se pose alors la question de comment rendre compte de certains discours, sans se constituer porte-parole de politiques ou d’organisations. Un exercice qu’elle confie trouver parfois compliqué.
Marianna Thiam et Ali Mahfoud rappellent chacun à leur tour l’importance du débat contradictoire pour permettre une meilleure compréhension des enjeux et comme solution pour éviter les pièges tendus par les extrêmes.
Irénée JAUJAY/MRI

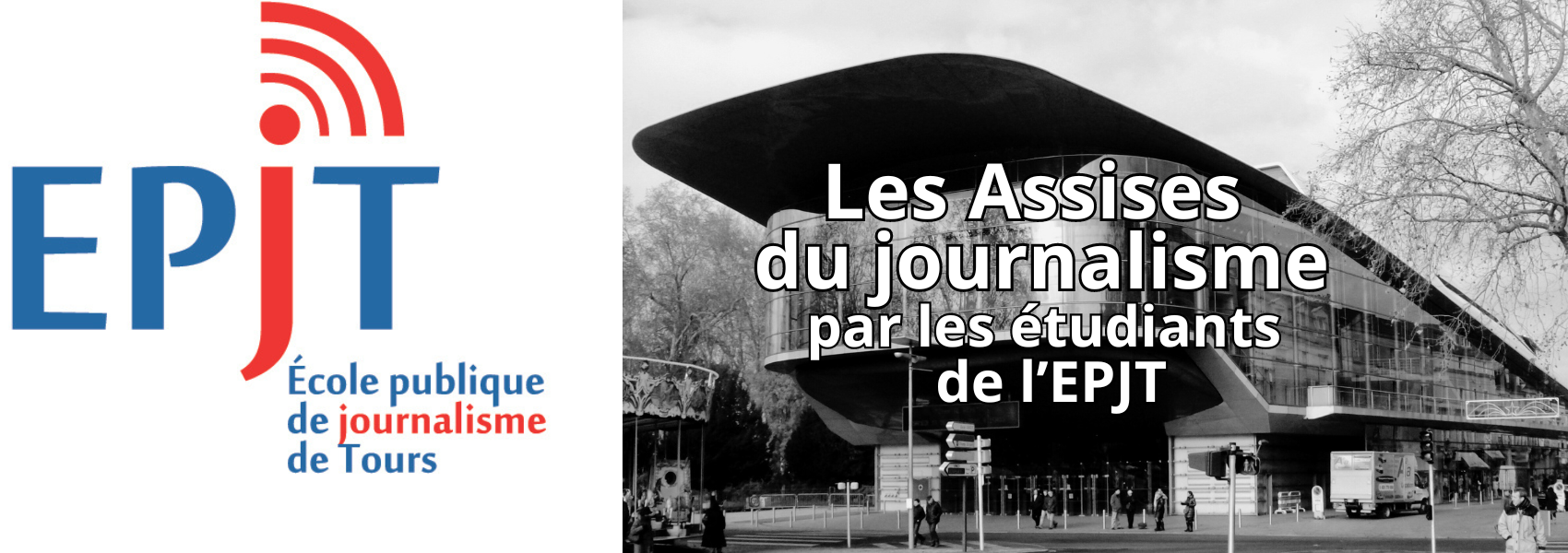












































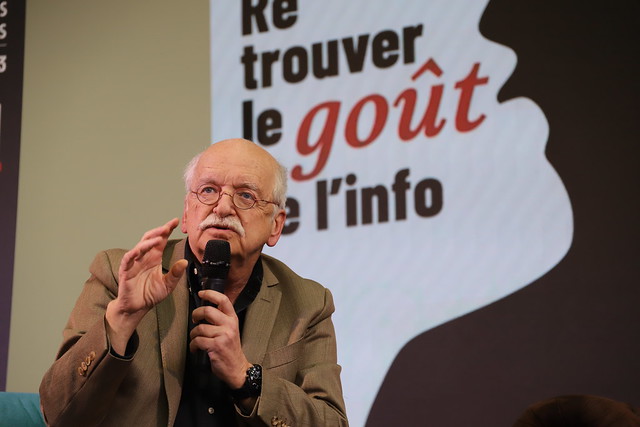






















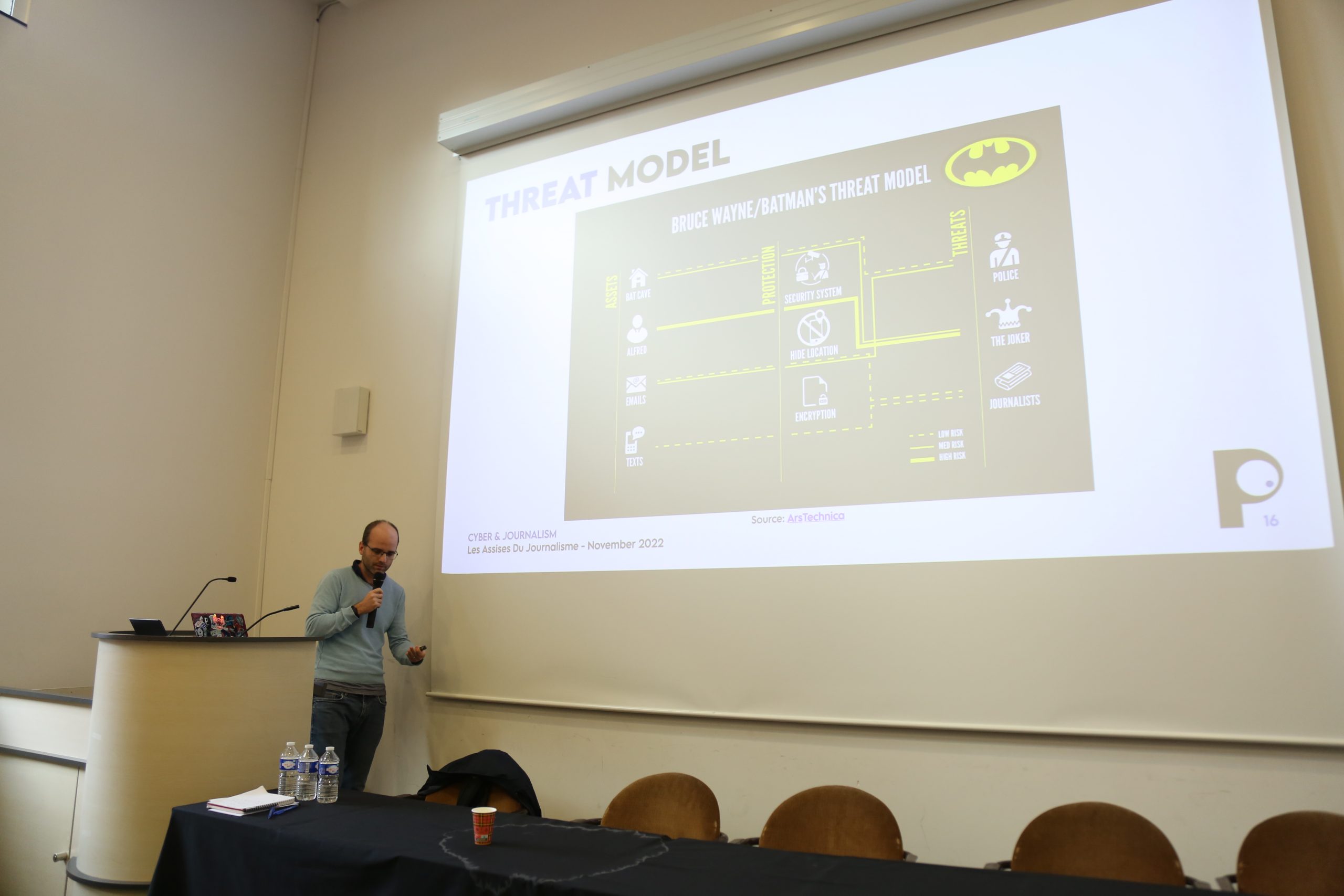







![20221124_142917[3372]](https://assises-journalisme.epjt.fr/wp-content/uploads/2022/11/20221124_1429173372-scaled.jpg)

















